« Il est facile de se forger une bonne conscience grâce à l’amour du lointain » (La vie quotidienne). Il ne fait pas de doute que l’auteur de cet aphorisme apparaît comme un profil singulier dans le paysage littéraire du XXe siècle et son œuvre, riche et diverse, en est l’illustration.
Jean Grenier est né à Paris mais c’est à Saint-Brieuc, en Bretagne, qu’il passa son enfance et son adolescence ; il fut reçu à l’agrégation de philosophie en 1922, et occupa de nombreux postes de professeur à l’étranger avant d’obtenir la Chaire d’esthétique et de sciences de l’art en Sorbonne où il finit sa carrière en 1968, l’année même où lui fut décerné le Grand Prix national des lettres. Quant à son entrée en littérature, on peut la dater de 1927, avec les premières contributions qu’il donna à La Nouvelle Revue française au moment où Jean Paulhan prenait la succession de Jacques Rivière.
Le maître d’Albert Camus

 On ne connaît sans doute pas assez le rôle que Jean Grenier a joué auprès d’Albert Camus, son brillant disciple et grâce auquel d’ailleurs l’existence du maître perdure dans la mémoire littéraire. L’on sait que Grenier fut le professeur de philosophie de Camus à Alger en terminale et en classes préparatoires (entre 1930 et 1933), et qu’à l’apogée de sa carrière, l’auteur de L’étranger redisait à l’envi quelle était sa dette à l’égard de son initiateur, qu’il mettait au premier rang des écrivains français. C’est surtout dans la préface qu’il avait donnée pour la réédition des Îles, en 1959, juste avant de trouver la mort, que Camus exprime l’importance que prit pour lui le premier livre de Jean Grenier, paru en 1933 : « […] un homme […] né sur d’autres rivages, amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeur des corps [venait] nous dire, dans un langage inimitable, que ces apparences étaient belles, mais qu’elles devaient périr et qu’il fallait alors les aimer désespérément. […] Les îles venaient, en somme, de nous initier au désenchantement ; nous avions découvert la culture ». Voilà qui semble annoncer un titre comme L’exil et le royaume (1957). L’hommage est également présent au fronton des ouvrages L’envers et l’endroit (1937), L’homme révolté (1951), dédiés à Jean Grenier, tout comme « Le désert » dans Noces (1959) ; l’estime est bien sûr réciproque, ce qui fait dire à Grenier dans ses Entretiens avec Louis Foucher (1969) : « Personne n’a parlé du soleil et de la mer – entendons : la Méditerranée – comme Albert Camus. Il l’a fait avec un accent pénétrant, c’est-à-dire qu’on ne lit pas ce qu’il écrit avec admiration seulement, mais avec émotion. Le lecteur est touché au sens propre du mot ». Les spécialistes de Camus ont établi précisément quelles relations fécondes les deux écrivains ont entretenues et quelles ont été leurs divergences, la plus importante tenant à la négation opposée par l’auteur de La peste à la possibilité de croire à une transcendance non humaine.
On ne connaît sans doute pas assez le rôle que Jean Grenier a joué auprès d’Albert Camus, son brillant disciple et grâce auquel d’ailleurs l’existence du maître perdure dans la mémoire littéraire. L’on sait que Grenier fut le professeur de philosophie de Camus à Alger en terminale et en classes préparatoires (entre 1930 et 1933), et qu’à l’apogée de sa carrière, l’auteur de L’étranger redisait à l’envi quelle était sa dette à l’égard de son initiateur, qu’il mettait au premier rang des écrivains français. C’est surtout dans la préface qu’il avait donnée pour la réédition des Îles, en 1959, juste avant de trouver la mort, que Camus exprime l’importance que prit pour lui le premier livre de Jean Grenier, paru en 1933 : « […] un homme […] né sur d’autres rivages, amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeur des corps [venait] nous dire, dans un langage inimitable, que ces apparences étaient belles, mais qu’elles devaient périr et qu’il fallait alors les aimer désespérément. […] Les îles venaient, en somme, de nous initier au désenchantement ; nous avions découvert la culture ». Voilà qui semble annoncer un titre comme L’exil et le royaume (1957). L’hommage est également présent au fronton des ouvrages L’envers et l’endroit (1937), L’homme révolté (1951), dédiés à Jean Grenier, tout comme « Le désert » dans Noces (1959) ; l’estime est bien sûr réciproque, ce qui fait dire à Grenier dans ses Entretiens avec Louis Foucher (1969) : « Personne n’a parlé du soleil et de la mer – entendons : la Méditerranée – comme Albert Camus. Il l’a fait avec un accent pénétrant, c’est-à-dire qu’on ne lit pas ce qu’il écrit avec admiration seulement, mais avec émotion. Le lecteur est touché au sens propre du mot ». Les spécialistes de Camus ont établi précisément quelles relations fécondes les deux écrivains ont entretenues et quelles ont été leurs divergences, la plus importante tenant à la négation opposée par l’auteur de La peste à la possibilité de croire à une transcendance non humaine.
Méditerranée et océan

En effet, donnant volontiers dans la polémique, s’en prenant à l’« esprit d’orthodoxie » ou à l’existentialisme sartrien, Grenier a prôné, s’inspirant du taoïsme – qu’il a contribué à introduire en France –, l’« inexistentialisme », à savoir le retour à la nature. Et chantre de la nature comme source de la sagesse, il l’a été à travers ses textes narratifs qui présentent cette forme curieuse d’être des récits, d’enfance ou de voyages, mais largement entrecoupés de développements que l’on peut attribuer à une réflexion philosophique.
Cette relation entretenue avec la nature est régie par le temps – ontologique, historique et climatique – dans un premier ordre et, dans un second, par une inquiétude métaphysique. L’élection d’un paysage est d’abord la recherche d’un accord avec soi-même, dans la nostalgie de l’unité perdue : « Il existe je ne sais quel composé de ciel, de terre et d’eau, variable avec chacun, qui fait notre climat. En approchant de lui, le pas devient moins lourd, le cœur s’épanouit. Il semble que la Nature silencieuse se mette tout d’un coup à chanter. Nous reconnaissons les choses. On parle du coup de foudre des amants, il est des paysages qui donnent des battements de cœur, des angoisses délicieuses, de longues voluptés. […] Pour moi, ces paysages furent ceux de la Méditerranée » (Inspirations méditerranéennes, 1940).
Pour le Breton qu’il fut depuis l’âge de deux ans, il apparaît que Grenier a vu dans l’espace méditerranéen l’antidote au milieu océanique. Certes, l’auteur des Grèves (1957) reconnaît la subjectivité de sa perception : « C’est en qualité d’homme du Nord que j’aimais déjà les pays du Midi ». Mais son choix de la Méditerranée a des raisons plus profondes que la disposition psychologique : il y va surtout d’une représentation du monde qui privilégie l’équilibre au désordre. Dans ses Entretiens avec Louis Foucher, Grenier définit les « grèves », terme qui a donné son titre au récit de 1957 : « Ce sont de grandes étendues au bord de la mer, recouvertes de galets, de rochers, de boue, sur lesquelles viennent se déposer les goémons apportés par le flot. Pour moi, c’est le symbole de l’indétermination. La Méditerranée, c’est au contraire le symbole de l’exactitude, cette exactitude dont les Grecs ont même fait un prénom : Akrivie. Aussi l’Océan est-il en perpétuel mouvement, impossible à fixer. Je ne vois pas en lui ce bel horizon qui délimite si bien à l’œil les caps et les golfes de la Méditerranée ».
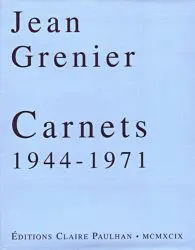
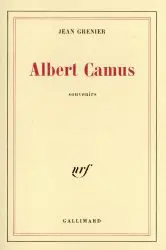 Il se dégagerait donc du spectacle de cette mer « du milieu des terres » la bienfaisante impression que l’homme peut jouir d’une existence calme et tranquille dans un rapport unique à la contemplation et à la pensée. Cependant, ce serait ignorer le caractère profond d’une sensibilité qui, depuis Les îles (1933) jusqu’à l’ouvrage posthume Voir Naples (1973), n’a cessé d’être hantée par la mort comme représentation ultime de la déréliction : « Les plus beaux sites, les plus beaux rivages sont plantés de cimetières qui ne sont pas là par hasard ; on y voit le nom de ceux qui, trop jeunes, ont été pris de panique devant tant de lumière projetée en eux-mêmes » (Les îles). Ainsi l’image offerte de la beauté par un paysage propice à combler l’avidité sensuelle est-elle essentiellement incitatrice à considérer le néant de toute existence : l’inspiration méditerranéenne de Jean Grenier, entre imaginaire et méditation, est placée sous le signe d’un paradoxe qui est le principe même de son écriture.
Il se dégagerait donc du spectacle de cette mer « du milieu des terres » la bienfaisante impression que l’homme peut jouir d’une existence calme et tranquille dans un rapport unique à la contemplation et à la pensée. Cependant, ce serait ignorer le caractère profond d’une sensibilité qui, depuis Les îles (1933) jusqu’à l’ouvrage posthume Voir Naples (1973), n’a cessé d’être hantée par la mort comme représentation ultime de la déréliction : « Les plus beaux sites, les plus beaux rivages sont plantés de cimetières qui ne sont pas là par hasard ; on y voit le nom de ceux qui, trop jeunes, ont été pris de panique devant tant de lumière projetée en eux-mêmes » (Les îles). Ainsi l’image offerte de la beauté par un paysage propice à combler l’avidité sensuelle est-elle essentiellement incitatrice à considérer le néant de toute existence : l’inspiration méditerranéenne de Jean Grenier, entre imaginaire et méditation, est placée sous le signe d’un paradoxe qui est le principe même de son écriture.
Finitude et absolu
De façon symétrique, l’idée que se fait Grenier du monde végétal oppose le concept, plutôt banal, de la fugacité à celui, moins convenu, de l’adhésion des êtres à leur principe. Dans son Lexique (1955), Grenier cite Kierkegaard : « Toutes les fleurs de mon cœur tournent en fleurs de givre » et rapporte que le philosophe danois refusait que les fleurs qui lui étaient envoyées à l’hôpital fussent mises dans l’eau, « car le destin des fleurs est de s’épanouir, de répandre leur parfum et de mourir ». Ce constat revient à plusieurs reprises dans les textes de Grenier, notamment dans Inspirations méditerranéennes : « Cette fleur des champs que j’ai cueillie, il y a un quart d’heure, s’est déjà flétrie et fanée ; je vais la jeter. Et tout est pour moi comme cette fleur des champs ». De fait, dans les Entretiens sur le bon usage de la liberté (1948), il établit une comparaison entre les végétaux et les humains : « Pourquoi les plantes semblent-elles se réaliser mieux dans leur plénitude, elles qui sont si attachées à la terre, que les êtres à qui il est permis de courir dans tous les sens ? […] Ne pourrait-on pas demander aux hommes de s’efforcer de faire comme [elles] ? Notre devoir n’est-il pas avant tout d’accomplir notre devoir d’état ? Et ce devoir, de se conformer à notre nature propre ? La connaissance de sa propre existence est alors le fondement de sa propre liberté ». La conformité de l’être à sa nature, représentation de l’idéal existentiel, Grenier l’a surtout déduite de son observation des arbres : « Il semble que l’arbre ne puisse être autrement qu’il n’est, soumis à toutes sortes de fatalités, celles du climat, du sol, du milieu, auxquelles l’animal échappe en partie. Il ne connaît pas cette mobilité, cette hésitation entre deux contraires qui caractérise les autres êtres, disons cette liberté qui est un privilège mais qui les rend malheureux parce qu’elle crée un vide » (Entretiens avec L. Foucher). La nature, sous son aspect géographique ou biologique, a permis à Jean Grenier de donner à sa conception de l’humain une vision projetée : la Méditerranée lui a servi de « livre d’images » favorisant le rêve autant que la réflexion sur l’inscription de l’être dans la Création ; le végétal lui a fait mesurer le poids relatif de l’action individuelle dans l’économie du vivant.
 Par ailleurs, le thème insulaire sert à illustrer une philosophie de l’écart, terme qui revient constamment sous la plume de Grenier ; « Les îles, ce sont les isolements, les différentes manières d’être seul – entendons : seul sans l’avoir voulu – en faisant la différence entre la solitude volontaire et l’isolement involontaire. J’avais d’abord pensé intituler ce recueil d’essais : Un homme seul » (Entretiens avec L. Foucher). Et dans La dernière page (1988) : « J’admets notre solitude – et tout ce que j’ai écrit jusqu’ici n’est que l’expression de cette solitude » ou dans Voir Naples : « Nous sommes donc condamnés à rester seuls ». À l’évidence subie de cette solitude, Grenier va opposer, sur le mode d’une contradiction qui n’est qu’apparente, le désir d’un retrait volontaire en soi, et en soi seul, afin d’y creuser la vie intérieure, d’y trouver « quelque chose d’impossible à nommer et qui devait être à la fois la Nature et plus que la Nature » (Albert Camus, 1968), et de parvenir, depuis l’existence singulière, à rejoindre un absolu qui se dérobe à la perception.
Par ailleurs, le thème insulaire sert à illustrer une philosophie de l’écart, terme qui revient constamment sous la plume de Grenier ; « Les îles, ce sont les isolements, les différentes manières d’être seul – entendons : seul sans l’avoir voulu – en faisant la différence entre la solitude volontaire et l’isolement involontaire. J’avais d’abord pensé intituler ce recueil d’essais : Un homme seul » (Entretiens avec L. Foucher). Et dans La dernière page (1988) : « J’admets notre solitude – et tout ce que j’ai écrit jusqu’ici n’est que l’expression de cette solitude » ou dans Voir Naples : « Nous sommes donc condamnés à rester seuls ». À l’évidence subie de cette solitude, Grenier va opposer, sur le mode d’une contradiction qui n’est qu’apparente, le désir d’un retrait volontaire en soi, et en soi seul, afin d’y creuser la vie intérieure, d’y trouver « quelque chose d’impossible à nommer et qui devait être à la fois la Nature et plus que la Nature » (Albert Camus, 1968), et de parvenir, depuis l’existence singulière, à rejoindre un absolu qui se dérobe à la perception.
« Les Japonais ne commencent à dessiner une figure que lorsque, l’ayant longuement observée, ils peuvent la tracer d’un trait. Tout est donné d’un coup » (Lexique). Ce « tout d’un coup » n’abolit peut-être pas le hasard mais il pourrait être un premier pas vers l’harmonie qui fond en une seule figure créateur et créature ou, en des termes plus modestes, la pensée et le verbe, l’intention et l’accomplissement : telle fut, de près et de loin, la vocation de Jean Grenier.
* Jean Grenier tenant un masque copte (1970). ©Daniel Wallard
Jean Grenier a publié, entre autres :
Récits : Les îles, Gallimard, 1933 et 1959, « L’imaginaire », 1977 ; Inspirations méditerranéennes, Gallimard, 1940 et 1961, « L’imaginaire », 1998 ; Les grèves, Gallimard, 1957 et 1980 ; Voir Naples, Gallimard, 1973 et « L’Imaginaire », 1997.
Essais : Essai sur l’esprit d’orthodoxie, Gallimard, 1938 et 1961 ; Entretiens sur le bon usage de la liberté, Gallimard, 1948 ; Lexique, Gallimard, 1955 ; Albert Camus, Gallimard, 1968 ; La vie quotidienne, Gallimard, 1968 et 1982 ; Entretiens avec Louis Foucher, Gallimard, 1969 ; La dernière page, Ramsay, 1988.
Aux éditions Claire Paulhan : Carnets 1944-1971, 1999 ; Sous l’Occupation, 1997 et 2014.
EXTRAITS
L’homme qui ne reconnaît pas de valeurs est parfaitement libre. Cet homme, suivant Lao-Tzeu, considérant le laid comme corrélatif du beau et le mal comme corrélatif du bien, demeure à l’écart et laisse devenir les êtres ce qu’ils doivent devenir sans les contrecarrer. Rien ne vaut à ses yeux, et même rien n’existe à l’état de nature distincte. C’est de l’inexistentialisme, puisque les termes de l’équation du monde finalement s’annulent. Plus de valeurs.
C’est bien de retour à la Nature qu’il s’agit dans cet inexistentialisme.
Entretiens sur le bon usage de la liberté, p. 73.
C’est en qualité d’homme du Nord que j’aimais déjà les pays du Midi. Une brume se tendrait donc toujours devant mes yeux d’hyperboréen et les paysages lumineux, non comme un rideau opaque mais comme un léger voile qui ajouterait aux images quelque poésie et les rendrait irréelles en quelque sorte, prêtes à se former et à se dissiper, toujours belles, trop belles, pas assez belles, bonheur refusé mais proposé, parfois accepté, toujours désiré, pas toujours voulu, constamment aimé.
Les grèves, p. 298.
Il est vrai que certains spectacles, la baie de Naples, par exemple, les terrasses fleuries de Capri, de Sidi-Bou-Saïd, sont des sollicitations perpétuelles à la mort. Ce qui devrait nous combler creuse en nous un vide infini. Les plus beaux sites, les plus beaux rivages sont plantés de cimetières qui ne sont pas là par hasard ; on y voit le nom de ceux qui, trop jeunes, ont été pris de panique devant tant de lumière projetée en eux-mêmes. […]
Pourquoi dit-on d’un paysage ensoleillé qu’il est gai ? Le soleil fait le vide et l’être se trouve face à face avec lui-même – sans aucun point d’appui. Partout ailleurs le ciel interpose ses nuages, ses brouillards, ses vents, ses pluies et voile à l’homme sa pourriture sous prétexte d’occupations et de préoccupations…
Les îles, p. 86-87.
[…] je me rappelle ce jour d’été où j’avais cueilli des fleurs des champs qui venaient de s’entrouvrir, éclatantes et parfumées. Je les admirais comme les symboles de cette poésie qui jaillit à travers tous les pores de la terre, à tout moment et à jamais. Et voilà qu’elles se fanaient tour à tour entre mes doigts et que j’étais obligé de les jeter les unes après les autres. […] Je croyais n’avoir jamais qu’à étendre la main pour cueillir de nouvelles fleurs, et je n’avais même plus le courage de le faire ; elles se ressemblaient toutes dès ce moment par leur néant. Croyant toujours pouvoir posséder tout, je ne tenais plus rien. Courant à travers ce labyrinthe de glaces que me paraissait maintenant l’Univers, je désespérais maintenant de saisir cette rose sans épines qu’est la plénitude lyrique de l’instant. Et je me souvins alors, mais alors seulement, de ce petit jardin d’Assise où, ivre de renoncement, François se jeta sur des rosiers pleins de ronces et où ceux-ci perdirent instantanément, et continuèrent à perdre tous leurs piquants. L’expérience religieuse se révèle inverse de l’expérience poétique. François avait désiré l’épine et il a obtenu la rose, pour toujours.
Pourquoi faut-il que nos voies soient si diverses ?
Inspirations méditerranéennes, p. 159-160.
Quel âge avais-je ? Six ou sept ans, je crois. Allongé à l’ombre d’un tilleul, contemplant un ciel presque sans nuages, j’ai vu ce ciel basculer et s’engloutir dans le vide : ç’a été ma première impression du néant, et d’autant plus vive qu’elle succédait à celle d’une existence riche et pleine. […]
Au vide se substitue immédiatement le plein. Quand je revois ma vie passée il me semble qu’elle n’a été qu’un effort pour arriver à ces instants divins. Y ai-je été déterminé par le souvenir de ce ciel limpide que je passais si longtemps dans mon enfance, couché sur le dos, à regarder à travers les branches et que j’ai vu un jour s’effacer ?
Les îles, p. 24-29.











