En parcourant la liste des œuvres de fiction publiées par Jack Kérouac, force est de constater que la légende dont on l’a auréolé de son vivant a desservi la considération accordée à l’œuvre elle-même.
Les nombreuses anecdotes qui entremêlaient joyeusement cette dernière et la vie de Kérouac – Proust aimait écrire dans son lit, moi sur la route, déclara-t-il un jour à un journaliste –, et le mouvement de libération générationnel, fort justement nommée beat generation pour ses liens étroits avec le jazz alors en pleine expansion dans une Amérique qui s’ouvrait au monde en même temps qu’elle se découvrait, ont pu distraire de l’essentiel : le processus créatif qui animait Kérouac et l’importance qu’a pu jouer le français au cœur de ce processus. À cela, il faut ajouter la fascination exercée par un roman qui devint rapidement le porte-étendard d’une génération qui, au sortir de la guerre, voulait donner libre cours aux élans créateurs et aux aspirations qui l’animaient, fascination exercée de surcroît par le mode d’écriture de ce roman transcrit sur un rouleau, dans un état qu’on a souvent associé à un état de transe sous influence de substances diverses. Ce mélange tout à la fois fascinant et explosif a sans doute contribué à porter ombrage à l’ensemble de l’œuvre elle-même, à ce qui constituait sa quête identitaire et littéraire, trop souvent noyée dans le périple dans lequel elle se déployait. Et c’est dommage. L’une et l’autre quête méritaient qu’on s’y attarde non seulement pour le coup de tonnerre littéraire que représenta la parution de On the Road en 1957, mais pour la dynamique linguistique qui l’animait et ses facettes plurielles, ce à quoi nous invite La vie est d’hommage1, qui réunit l’ensemble des textes inédits écrits en français par Kérouac.
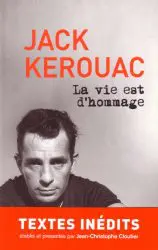 Il faut ici saluer le travail de Jean-Christophe Cloutier, professeur adjoint de littérature anglaise à l’Université de Pennsylvanie, qui a établi et présenté les textes réunis, en plus d’apporter un éclairage senti et judicieux pour en permettre une lecture qui nous entraîne enfin au-delà des anecdotes que Kérouac traînait dans son sillage. L’ouvrage se divise en deux parties inégales : la première, intitulée « Du côté de Duluoz », regroupe l’ensemble des textes de fiction, dont certains sont complets et d’autres inachevés, retrouvés et écrits en français ; la seconde, très courte, rassemble d’autres textes à caractère plus personnel sous le titre « Sé dur pour mué parlé l’Angla », résumant par cette formule lapidaire les tensions linguistiques qui caractérisent la vie et l’œuvre de Kérouac. « Langage blessé, souligne à juste titre Jean-Christophe Cloutier dans sa présentation, serré par l’étau de l’assimilation, ce français qu’il qualifie lui-même de ‘tourmenté, tordu, tranché’ se fait ici vecteur d’une poétique vagabonde se frayant un chemin à travers ce que l’intellectuel et auteur antillais Édouard Glissant appelait ‘des maquis de langues’ ».
Il faut ici saluer le travail de Jean-Christophe Cloutier, professeur adjoint de littérature anglaise à l’Université de Pennsylvanie, qui a établi et présenté les textes réunis, en plus d’apporter un éclairage senti et judicieux pour en permettre une lecture qui nous entraîne enfin au-delà des anecdotes que Kérouac traînait dans son sillage. L’ouvrage se divise en deux parties inégales : la première, intitulée « Du côté de Duluoz », regroupe l’ensemble des textes de fiction, dont certains sont complets et d’autres inachevés, retrouvés et écrits en français ; la seconde, très courte, rassemble d’autres textes à caractère plus personnel sous le titre « Sé dur pour mué parlé l’Angla », résumant par cette formule lapidaire les tensions linguistiques qui caractérisent la vie et l’œuvre de Kérouac. « Langage blessé, souligne à juste titre Jean-Christophe Cloutier dans sa présentation, serré par l’étau de l’assimilation, ce français qu’il qualifie lui-même de ‘tourmenté, tordu, tranché’ se fait ici vecteur d’une poétique vagabonde se frayant un chemin à travers ce que l’intellectuel et auteur antillais Édouard Glissant appelait ‘des maquis de langues’ ».
« La nuit est ma femme », le premier texte de fiction écrit en français par Kérouac, a été rédigé durant les mois de février et de mars 1951. Moins d’un mois après l’avoir terminé, Kérouac se serait lancé dans l’écriture de On the Road. Il est donc plausible de penser, comme le souligne Jean-Christophe Cloutier, que ce premier roman écrit en français a en quelque sorte pavé la voie au célèbre roman qui suivit. L’ouverture de « La nuit est ma femme » nous le donne à croire en raison du rythme de la phrase, de sa musicalité et de l’atmosphère qu’elle traduit et impose d’emblée : « J’ai pas aimé ma vie. C’est pas la faute à personne, c’ainque moi. Je voué ainque la tristesse tout partout. Bien des foi quand y’a bien du monde qui ri moi j’wé pas rien droll. C’est encore bien plus droll quand ils sont toute triste ensemble. J’gard leu face hypocrite et puis j’sai qui’l s’trouble pas apropos d’la tristesse. Ils peuve pas l’usé ».
La tendance subversive à bouleverser les structures narratives traditionnelles de la prose américaine et ses percées postmodernistes, comme le fait remarquer Jean-Christophe Cloutier, trouvent leur origine dans les formes narratives que révèlent les écrits français auxquels il a eu accès et qui nous sont ici livrés dans leur intégralité. À cet égard, les extraits d’un des cahiers du manuscrit de Visions of Neal, reproduits ici sous le titre de « Si tu veux parler apropos d’Neal », illustrent la dualité langagière inscrite au cœur même du processus d’écriture de Kérouac, voire de sa pensée. On pourrait s’interroger sur la pertinence d’explorer un parallèle entre Joyce et Kérouac au regard de leur rapport à la langue anglaise et dans l’utilisation qu’ils en font dans la poursuite de leur œuvre.
Pour apprécier pleinement ce roman, comme les écrits qui suivent, le lecteur doit nécessairement leur restituer la musicalité qui les porte en les récitant ; les faits et gestes rapportés jouent le plus souvent le rôle d’une portée musicale qui permet d’en retranscrire la polyphonie et l’harmonie des voix que cherche à traduire Kérouac. On a dit de ce dernier qu’il avait été fortement influencé par le rythme de la chanson afro-américaine et les musiciens de jazz, et que c’est dans la structure des partitions de ce courant musical qu’il faut chercher des correspondances pour esquisser l’architecture de ses œuvres écrites. « C’est donc le son, écrit Jean-Christophe Cloutier, le rythme de la ‘chanson’ afro-américaine qui lui rentrent dans le corps et lui donnent le goût du voyage. Et c’est exactement ce que la poétique de Kérouac offre au lecteur en retour : cette invitation à découvrir le monde, le nôtre et celui que nous partageons avec des gens que nous n’avons pas encore rencontrés, celui des merveilles auxquelles nous n’avons pas encore rêvé, des chansons que nous n’avons jamais entendues, des chemins qui ne sont pas encore indiqués sur les cartes routières ou les GPS. »
Cette musicalité n’est pas sans rappeler celle qui émanait du roman de Salinger, The Catcher in the Rye, dans lequel la voix du jeune Holden Caulfield nous restait en mémoire longtemps après avoir refermé le livre. Là est la force de ces œuvres qui s’imposent en se frayant un chemin jusqu’à nous sans solliciter notre adhésion première et inconditionnelle. Kérouac ne cherchait pas uniquement à reproduire la langue parlée de son enfance (faut-il ici rappeler qu’il n’a parlé que le français jusqu’à l’âge de six ans), le franco-américain, qu’il ne considère et ne traite nullement comme un appauvrissement du français parlé au Québec ou en France, mais il se voulait aussi le témoin, voire le chantre du désespoir vécu par ces milliers d’expatriés qui n’ont jamais oublié leur foyer d’origine et qui ont souvent vécu dans des conditions difficiles des deux côtés de la frontière canado-américaine. En cela, pour le devoir de mémoire qu’il s’imposait peut-être et la douleur qu’il ressentait en se replongeant dans son passé, Kérouac se référait à des écrivains tels que Proust et Céline pour la virtuosité et l’inventivité narratives d’À la recherche du temps perdu et du Voyage au bout de la nuit. Une fois circonscrits ces deux axes qui traversent l’œuvre de Kérouac (l’importance du lien généalogique et la souffrance humaine), ces rapprochements ne sont pas aussi fortuits qu’ils peuvent paraître à première vue.
Il faudrait pouvoir lire ces textes avec la même fougue avec laquelle ils ont été écrits : d’une seule traite, comme un train lancé sur ses rails qui ne s’arrêtera qu’une fois sa destination atteinte pour ne pas affaiblir le souffle qui les porte. Les lire comme on écoute une œuvre musicale, sans arrêt pour ne pas interrompre la ligne musicale porteuse de fureur et de beauté sauvages. L’on serait alors davantage à même d’apprécier toute la force évocatrice de la souffrance humaine livrée ici sous le masque de l’errance, du rire et de la grimace. À juste titre, souligne Jean-Christophe Cloutier, « les écrits en français de Kérouac appartiennent donc au patrimoine de la diaspora québécoise et à l’histoire de la francophonie en Amérique. On y retrouve un Kérouac pris entre l’errance et l’enracinement, d’une sincérité renversante, doté d’un grand sens de l’humour, mais aussi avec un moi intérieur abîmé – magané – par la force assimilatrice des États-Unis ».
Life is a pity, disait Kérouac. La vie est d’hommage. Entre les deux, la vision d’un homme meurtri.
1. Jack Kérouac, La vie est d’hommage, textes inédits établis et présentés par Jean-Christophe Cloutier, Boréal, Montréal, 2016, 347 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Je suis Canadien Français, m’nu au-monde a New England. Quand j’fâcher j’sacre souvent en Francais. Quand j’reve j’reve souvent en Francais. Quand je brauille je brauille toujours en Francais ; et j’dit : « J’aime pas ca, j’aime pas ca ! » C’est ma vie dans le mondeque j’veu pas. Mais j’lai.
« La nuit est ma femme », p. 54.
Omer marcha, main au poche, ti, fâcher contre lui meme, ecrochez, debauchez ; c’eta toute un rêve fou ; y ava des dents quil poigna dans les coins noires. L’amour eta toute melangez avec des spikes. Le benzedrine lui comprena le rêve de la mort, voya la terre de la grave pardessus ses yeux ; et a s t eur que Vicki etait parti, son corps se poigna de sensation pure a la pensez de Vicki. C’eta trop pour comprendre, il ava peur de perde du temp, faula allez travaillez, il chercha les horloge, dans le subway.
« Sur le chemin », p. 201.
– We were scared ; on s’morda d’peine.
Shta couchez la sur mon bord avec mon bras alentour son coup, ma main grippez sur ses seins, et j lui manja les lèvres et elle les miennes. On ne sava plus loin allez sans s’batte. Apra ca on faisa inque s’assir pis en jazza dans la noirceur du salon tandis que la famille dorma et le radio joua bas. Un soir j’attendu son pere arrivez dans le porte de cuisine –j’nava pas d’idee dansce temps la de les grosses brumes recollez des champs par la mer a Nova Scotia et les pauvre ti cottège dans l’orage perdu…
« Maggie Cassidy », p. 229.
Les aventures que j’ai eu dans ma vie avec Neal Cassady avait des partis droll, des partis fou, des partis triste, des partis mauvaise, bien des milles sur le chemin en tout cas, et tout mis ensemble une chose que je ne peu pas sortir de mon memoires, une chose qui m’appelle encore, j’pourra allez le joindre tousuite pour trouvez cosse qu’il fait ce moment. Moi je trouve qu’il savait bien des affaires, Neal, un homme un peu fou comme toutes les autres mais complètement intéressant, mon ami, mon frere, mon pauvre Hipster excitez !
« L’ouvrage de ma vie », p. 267.











