Pour ses romans relevant de la « fiction spéculative » – une appellation qu’elle préfère à celle de « science-fiction » –, Margaret Atwood est régulièrement comparée aux plus grands : Huxley, Orwell, Bradbury, Burgess. Le rapprochement n’a rien d’exagéré puisque la trilogie MaddAddam1, visionnaire et satirique à souhait, possède tout ce qu’il faut pour devenir un classique de la littérature conjecturale.
 Le meilleur des mondes, 1984, Fahrenheit 451 et L’orange mécanique ont marqué les esprits en dépeignant les dérives idéologiques de sociétés déshumanisées du futur. Avec sa série de romans post-apocalyptiques Le dernier homme (2005), Le temps du déluge (2012) et MaddAddam (2014), Atwood promène un œil ironique et lucide sur le monde terrifiant que nous sommes en train de laisser aux prochaines générations. Dans un avenir pas si lointain, les corporations ont remplacé les États. L’élite vit dans des « compounds », alors que le reste de la population occupe les « plèbezones ». L’exploitation sexuelle (notamment infantile) n’a rien d’exceptionnel. Les adeptes (et escrocs) de la « Sainte Église du PetrOleum » vouent un culte malsain à l’or noir tandis que les « Jardiniers de Dieu » – les membres d’une secte écologique – se préparent à la fin du monde. Les meurtriers doivent s’affronter dans un jeu cruel où les gagnants, appelés « les Painballers », n’ont plus rien d’humain à l’issue des combats. Dans cet univers sombre et sordide, les manipulations génétiques les plus extravagantes sont pratiques courantes. Jusqu’au jour où un savant fou nouveau genre – un jeune homme taciturne surnommé « Crake » – décide qu’il est temps de purger la planète d’une espèce nuisible : l’homo sapiens.
Le meilleur des mondes, 1984, Fahrenheit 451 et L’orange mécanique ont marqué les esprits en dépeignant les dérives idéologiques de sociétés déshumanisées du futur. Avec sa série de romans post-apocalyptiques Le dernier homme (2005), Le temps du déluge (2012) et MaddAddam (2014), Atwood promène un œil ironique et lucide sur le monde terrifiant que nous sommes en train de laisser aux prochaines générations. Dans un avenir pas si lointain, les corporations ont remplacé les États. L’élite vit dans des « compounds », alors que le reste de la population occupe les « plèbezones ». L’exploitation sexuelle (notamment infantile) n’a rien d’exceptionnel. Les adeptes (et escrocs) de la « Sainte Église du PetrOleum » vouent un culte malsain à l’or noir tandis que les « Jardiniers de Dieu » – les membres d’une secte écologique – se préparent à la fin du monde. Les meurtriers doivent s’affronter dans un jeu cruel où les gagnants, appelés « les Painballers », n’ont plus rien d’humain à l’issue des combats. Dans cet univers sombre et sordide, les manipulations génétiques les plus extravagantes sont pratiques courantes. Jusqu’au jour où un savant fou nouveau genre – un jeune homme taciturne surnommé « Crake » – décide qu’il est temps de purger la planète d’une espèce nuisible : l’homo sapiens.
Margaret Atwood avait déjà tâté du genre dystopique il y a 30 ans avec La servante écarlate2. Ce roman, couronné du Prix du Gouverneur général en 1985, a été le tout premier à recevoir le prix Arthur C. Clarke au Royaume-Uni en 1987. Il a ensuite été adapté au cinéma par Volker Schlöndorff en 1990, adaptation décevante malgré un scénario signé Harold Pinter et une distribution éclatante (Natasha Richardson, Faye Dunaway, Robert Duvall). Dans un monde totalitaire assombri par la pollution, les radiations nucléaires et une inquiétante crise de dénatalité, très peu de femmes sont capables d’enfanter. Celles qui le peuvent sont réduites à l’esclavage et appelées « les servantes écarlates ». Le roman d’Atwood rapporte l’histoire de l’une d’entre elles, Offred (Defred dans la traduction française).
Homo (quasi) disparitus
Les fictions du « dernier homme » incluent souvent la survenue d’un ou de plusieurs autres rescapés. C’est ce qui se produit pour Ann Burden dans le classique jeunesse de Robert C. O’Brien Z pour Zacharie (1974), adapté au cinéma cette année par Craig Zobel. C’était aussi la situation dépeinte humoristiquement par Fredric Brown dans sa micro-nouvelle « Toc ! » (1948) :
« Le dernier homme vivant sur Terre était assis, seul dans une pièce.
Soudain, quelqu’un frappa à la porte ».
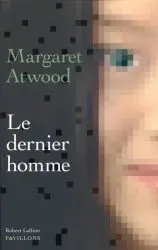 Telle est également l’expérience qui attend Jimmy, alias Snowman, le protagoniste du Dernier homme. Au début du livre, celui-ci craint d’être l’ultime représentant de l’humanité, qu’une étrange pandémie vient de rayer de la surface terrestre. Le dernier homme mais pas le dernier être vivant : Snowman vit entouré de créatures modifiées génétiquement. Les « Crakers », reconnaissables à leurs yeux verts et à leurs sexes qui bleuissent lorsque l’envie de copuler les prend, appartiennent à une nouvelle race d’êtres humains, modifiés en laboratoire pour ne plus être sujets à la violence, au fanatisme religieux ou à la rivalité amoureuse. Les autres créatures sont des animaux hybrides, tels les inoffensifs « rasconses » (nés du croisement d’un rat et d’une mouffette) et les plus menaçants « porcons » (des cochons qui se sont fait implanter des cellules humaines). Le dernier homme relate les aléas de la survie de Snowman entrecoupés de retours en arrière, Atwood privilégiant aussi bien l’avant que l’après-catastrophe.
Telle est également l’expérience qui attend Jimmy, alias Snowman, le protagoniste du Dernier homme. Au début du livre, celui-ci craint d’être l’ultime représentant de l’humanité, qu’une étrange pandémie vient de rayer de la surface terrestre. Le dernier homme mais pas le dernier être vivant : Snowman vit entouré de créatures modifiées génétiquement. Les « Crakers », reconnaissables à leurs yeux verts et à leurs sexes qui bleuissent lorsque l’envie de copuler les prend, appartiennent à une nouvelle race d’êtres humains, modifiés en laboratoire pour ne plus être sujets à la violence, au fanatisme religieux ou à la rivalité amoureuse. Les autres créatures sont des animaux hybrides, tels les inoffensifs « rasconses » (nés du croisement d’un rat et d’une mouffette) et les plus menaçants « porcons » (des cochons qui se sont fait implanter des cellules humaines). Le dernier homme relate les aléas de la survie de Snowman entrecoupés de retours en arrière, Atwood privilégiant aussi bien l’avant que l’après-catastrophe.
L’avant et l’après
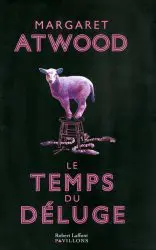 Cette approche duelle du temps narratif revient dans les deux volets suivants. Ce qui a changé, c’est le protagoniste. Ainsi le lecteur qui vient de refermer Le dernier homme et qui s’attend à lire, dans Le temps du déluge, la suite des aventures de Snowman – qu’Atwood a laissé en mauvaise posture à la fin – sera surpris de constater que celui-ci ne remplit plus qu’un rôle marginal dans le reste de la trilogie. Le temps du déluge se concentre sur deux héroïnes, deux survivantes dont chacune a également l’impression, au départ, d’être la dernière rescapée de l’humanité. Toby, une « Jardinière de Dieu », vit barricadée dans un centre de balnéothérapie. Ren, une ancienne petite amie de Snowman – le monde est petit, même dans les fictions post-apocalyptiques –, est enfermée dans un bordel de luxe. Avec une cohérence et une imagination sidérantes, Atwood continue de rapporter à la fois les événements qui ont précédé et ceux qui ont suivi la grande catastrophe annihilatrice de l’humanité, « le Déluge des Airs » (traduction discutable de « Waterless Flood »). Deux catégories de personnages interviennent dans l’histoire : les responsables du Déluge et les survivants. Dans MaddAddam, c’est avant tout du point de vue de Toby et de Zeb – frère d’Adam Premier, le fondateur de la secte des Jardiniers de Dieu – que les choses sont présentées. Tous les éléments laissés en suspens dans les deux volumes précédents s’éclaircissent petit à petit. Ambitieuse fable spéculative, la trilogie MaddAddam est irréprochable sur le plan de l’écriture : savamment construite, dense peut-être, étourdissante de trouvailles, mais toujours fluide et captivante.
Cette approche duelle du temps narratif revient dans les deux volets suivants. Ce qui a changé, c’est le protagoniste. Ainsi le lecteur qui vient de refermer Le dernier homme et qui s’attend à lire, dans Le temps du déluge, la suite des aventures de Snowman – qu’Atwood a laissé en mauvaise posture à la fin – sera surpris de constater que celui-ci ne remplit plus qu’un rôle marginal dans le reste de la trilogie. Le temps du déluge se concentre sur deux héroïnes, deux survivantes dont chacune a également l’impression, au départ, d’être la dernière rescapée de l’humanité. Toby, une « Jardinière de Dieu », vit barricadée dans un centre de balnéothérapie. Ren, une ancienne petite amie de Snowman – le monde est petit, même dans les fictions post-apocalyptiques –, est enfermée dans un bordel de luxe. Avec une cohérence et une imagination sidérantes, Atwood continue de rapporter à la fois les événements qui ont précédé et ceux qui ont suivi la grande catastrophe annihilatrice de l’humanité, « le Déluge des Airs » (traduction discutable de « Waterless Flood »). Deux catégories de personnages interviennent dans l’histoire : les responsables du Déluge et les survivants. Dans MaddAddam, c’est avant tout du point de vue de Toby et de Zeb – frère d’Adam Premier, le fondateur de la secte des Jardiniers de Dieu – que les choses sont présentées. Tous les éléments laissés en suspens dans les deux volumes précédents s’éclaircissent petit à petit. Ambitieuse fable spéculative, la trilogie MaddAddam est irréprochable sur le plan de l’écriture : savamment construite, dense peut-être, étourdissante de trouvailles, mais toujours fluide et captivante.
La disparition programmée de l’homme
La trilogie MaddAddam s’inscrit dans un contexte très actuel de pessimisme planétaire. Des scientifiques et des militants environnementaux de partout à travers le monde s’inquiètent des effets dévastateurs de l’homme sur la planète. Certains estiment même que nous nous dirigeons tout droit vers la sixième extinction de masse : celle du genre humain. Le prix Pulitzer 2015 a d’ailleurs été décerné à la journaliste Elizabeth Kolbert pour son enquête consacrée à cette question (La 6e extinction, Comment l’homme détruit la vie). Ce n’est donc pas un scénario de science-fiction que développe Atwood dans MaddAddam. S’inscrivant dans la tradition de Jules Verne plutôt que de H. G. Wells, elle décrit une vision plausible de l’avenir. Comme elle l’indique à la fin de sa série, MaddAddam « n’inclut aucune technologie ou bioforme qui n’existe pas déjà, ou qui ne soit pas en construction, ou qui ne soit pas possible en théorie ». Ça n’a rien de rassurant !
Voir aussi : Petite chronologie littéraire de la fin du monde
1. Margaret Atwood, La trilogie MaddAddam: Le dernier homme, traduit de l’anglais par Michèle Albaret-Maatsch, Robert Laffont, Paris, 2005, 398 p. ; Le temps du déluge, traduit de l’anglais par Jean-Daniel Brèque, Robert Laffont, Paris, 2012, 440 p. ; MaddAddam, traduit de l’anglais par Patrick Dusoulier, Robert Laffont, Paris, 2014, 430 p.
2. Margaret Atwood, La servante écarlate, traduit de l’anglais par Sylviane Rué, Robert Laffont, Paris, [1987] 2005.
EXTRAITS
« Maintenant, je suis seul, dit-il tout fort. Tout seul, tout seul. Seul sur la vaste, la vaste mer. »
[…] Il scrute l’horizon derrière son unique verre de soleil : rien. La mer est couleur de métal brûlant, le ciel d’un bleu délavé à l’exception du trou que le soleil y grave. Tout est tellement vide. Eau, sable, ciel, arbres, fragments d’un passé révolu. Personne pour l’entendre.
« Crake, beugle-t-il. Conard. Crétin ! »
Le dernier homme, p. 19-20.
En guise de réconfort, sachons que cette histoire sera bientôt balayée par le Déluge des Airs. Il ne restera plus rien du Monde exfernal hormis des débris de bois pourri et de métal rouillé ; et le Kudzu et autres végétaux ne tarderont pas à les ensevelir ; et les Oiseaux et autres Animaux nicheront parmi eux, comme nous l’enseigne la Parole humaine de Dieu : « Tout est abandonné aux Rapaces des montagnes et aux Bêtes du pays ; les Rapaces s’y vautreront pendant l’été, toutes les Bêtes du pays pendant l’automne. » Car les œuvres de l’Homme seront pareilles à des mots écrits sur l’eau.
Le temps du déluge, p. 318-319.
New New York était située sur la côte de Jersey, ou ce qui était maintenant la côte. Il ne restait plus grand monde dans le vieux New York. C’était une zone interdite, où on n’avait donc pas de loyer à payer, de sorte qu’un certain nombre de gens étaient encore prêts à tenter leur chance dans les buildings abandonnés et envahis par les eaux, qui se désintégraient lentement.
MaddAddam, p. 209.











