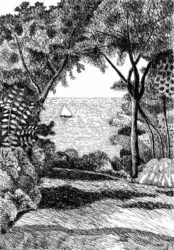Poète, romancier, nouvelliste et chroniqueur suisse romand, Pierre Girard s’est vu attacher dès le début des années 1920 l’encombrante étiquette de « Giraudoux genevois ».
Il n’en bâtira pas moins, en toute discrétion et avec le soutien de quelques amis et admirateurs français ou helvètes, comme Valery Larbaud, Jacques Chenevière, Francis de Miomandre, Edmond Jaloux ou Denis de Rougemont, une œuvre de poète-conteur éminemment personnelle, dans laquelle le réel semble perpétuellement transfiguré par le rêve et la fantaisie. Toujours méconnu malgré plusieurs rééditions en Suisse et en France, il reste à (re)lire, à (re)découvrir.
Un air de famille
En 1943, Jean-Louis Vaudoyer évoque, dans ses Beautés de la Provence, un type de livres « somme toute assez peu conforme à l’esprit et au tempérament français », où « l’art […] naît de la rêverie plutôt que de l’expérience » et où « la réalité n’[…]apparaît que nimbée de poésie, camouflée de fantaisie ». Cette veine, dont l’essayiste voit le modèle dans Voyage sentimental à travers la France et l’Italie de Laurence Sterne, se prolongerait selon lui, par l’entremise d’Alfred de Musset, Gérard de Nerval, Charles Nodier, Xavier de Maistre ou Alain-Fournier, jusque chez des auteurs contemporains. Et Vaudoyer de citer notamment parmi ces « vivants », Francis de Miomandre, Jean Cassou, Jean Giraudoux, Valery Larbaud… Une suite de noms que l’auteur prend soin de laisser ouverte, et qu’il faudrait compléter au moins par celui de Pierre Girard. Car c’est bien à cette « jolie famille […], à parentés allemande ou anglaise », qu’appartient indubitablement ce Genevois, surtout si l’on adjoint aux noms avancés par Jean-Louis Vaudoyer celui de Rodolphe Töpffer, l’auteur plein de fantaisie des Voyages en zigzag auquel Girard a rendu un bel hommage dans Un printemps avec Monsieur Töpffer.
 S’il fait de Töpffer « un compagnon » de voyage, Pierre Girard ne cache pas pour autant l’influence qu’ont pu avoir sur lui A. O. Barnabooth, Ses œuvres complètes de Larbaud, tout comme L’école des indifférents de Giraudoux, qu’il a découvert en 1918. À la parution de son premier livre de nouvelles, June, Philippe et l’amiral (1924), qui succède à plusieurs recueils de poèmes, la critique ne s’est d’ailleurs pas privée de signaler la parenté du Genevois avec l’auteur des Provinciales. On renverra par exemple à ces propos de René Crevel : « Comme Giraudoux, Pierre Girard, se plaît dans la compagnie des jeunes filles, sourit au passage des vieux tuteurs, trouve des noms charmants pour ses héroïnes et pèse ce qui s’appelait autrefois l’impondérable ». Surtout, il semble avoir retenu de la fréquentation de son « cousin » français certains procédés stylistiques, un goût marqué pour les rapprochements singuliers, les images étonnantes. Ces traits giralduciens s’estomperont assez rapidement chez Pierre Girard ; ils n’empêchent pas de distinguer clairement, dès June, Philippe et l’amiral, l’originalité de l’auteur, son individualité. Ainsi dans Europe, Aldo Dami notera très justement combien Girard « est un être plus sensible que Jean Giraudoux. Son commerce est moins sec, son dire moins sarcastique et moins tranché, sa vision moins cérébrale et moins intellectuelle ».
S’il fait de Töpffer « un compagnon » de voyage, Pierre Girard ne cache pas pour autant l’influence qu’ont pu avoir sur lui A. O. Barnabooth, Ses œuvres complètes de Larbaud, tout comme L’école des indifférents de Giraudoux, qu’il a découvert en 1918. À la parution de son premier livre de nouvelles, June, Philippe et l’amiral (1924), qui succède à plusieurs recueils de poèmes, la critique ne s’est d’ailleurs pas privée de signaler la parenté du Genevois avec l’auteur des Provinciales. On renverra par exemple à ces propos de René Crevel : « Comme Giraudoux, Pierre Girard, se plaît dans la compagnie des jeunes filles, sourit au passage des vieux tuteurs, trouve des noms charmants pour ses héroïnes et pèse ce qui s’appelait autrefois l’impondérable ». Surtout, il semble avoir retenu de la fréquentation de son « cousin » français certains procédés stylistiques, un goût marqué pour les rapprochements singuliers, les images étonnantes. Ces traits giralduciens s’estomperont assez rapidement chez Pierre Girard ; ils n’empêchent pas de distinguer clairement, dès June, Philippe et l’amiral, l’originalité de l’auteur, son individualité. Ainsi dans Europe, Aldo Dami notera très justement combien Girard « est un être plus sensible que Jean Giraudoux. Son commerce est moins sec, son dire moins sarcastique et moins tranché, sa vision moins cérébrale et moins intellectuelle ».
De fait, s’il fallait assigner à Pierre Girard un parent français parmi les « vivants » évoqués par Vaudoyer, on pourrait tout autant choisir Francis de Miomandre, sorte de grand frère en fantaisie à destination duquel le Genevois, durant de longues années, enverra, à travers ses œuvres, par le truchement de dédicaces, parfois simplement au détour d’une phrase, des signes de connivence, d’amitié. Dans June, Philippe et l’amiral, la jeune Simone se voit par exemple visitée par un rêve interprété comme un présage d’amour – le rêve « d’un être qui ressembl[e] à une souris, à une femme, avec le sourire de Francis de Miomandre ». Cet élément onirique, loin d’être anodin, constitue bien au contraire un des fondements non seulement de l’esthétique de Miomandre, mais également de celle de Girard.
Les voies du rêve
Comme l’a bien dit Jean Vuilleumier, dans sa préface à la réédition du Gouverneur de Gédéon (1947), l’œuvre de Pierre Girard relève d’« une littérature évidemment onirique » ; ses récits, souples et ondoyants comme des rêves éveillés, n’ont rien de la pesante charpente des fictions réalistes, ni de leur logique ; subtilement somnambuliques, ils entretiennent au contraire des rapports légèrement décalés avec la réalité conventionnelle. On s’en convaincra à travers le traitement que l’auteur fait subir à ses décors. Profondément Genevois, Girard situe très fréquemment ses histoires dans sa ville natale, avec ses rues, ses banques, ses parcs, son lac fameux et le non moins célèbre siège de la Société des Nations, sans oublier l’île Rousseau… Pour autant, c’est une Genève insolite qui surgit sous la plume de Girard, une Genève à la fois réelle et rêvée – une ville dans laquelle on ne s’étonne pas de voir apparaître puis s’évanouir, en pleine rue, un être merveilleux, « un dieu tout nu, au corps solaire ».
Si une telle atmosphère de rêve est possible en plein cœur du pays calviniste, c’est en grande partie dû aux personnages mis en scène par Pierre Girard : qu’ils soient genevois, anglais ou américains, ils ont en commun non seulement une certaine familiarité avec les féeries shakespeariennes, à commencer par Le songe d’une nuit d’été, mais aussi une sensibilité musicale qui les porte volontiers vers les romantiques allemands – ainsi reviennent, tout au long de l’œuvre, comme des leitmotive, les références à Beethoven, Schumann, Schubert, Wagner, autant de compositeurs qui semblent accompagner les récits de Girard… On y trouvera même des personnages en quelque sorte caractérisés « musicalement ». Ainsi dans une nouvelle de La Grotte de Vénus (1948), les jambes d’une jeune femme, Iris, sont assimilées à « une mélodie de Schubert ». Chez Pierre Girard, le romantisme septentrional est également présent de manière insistante par ses écrivains – Goethe, surtout, fréquemment convoqué, mais aussi Jean Paul, ou bien le E. T. A. Hoffmann de Princesse Brambilla. Cette dilection pour les romantiques allemands, qu’il partage avec Giraudoux et Miomandre, Girard va notamment l’exprimer dans certains de ses textes majeurs, à commencer par La rose de Thuringe (1930).
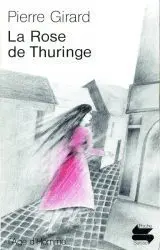 Contraint de fuir Genève après avoir provoqué un scandale en offrant une robe rouge à la jeune Virginie qui, ainsi vêtue, provoque d’irrésistibles désirs de lucre chez les Genevois, le héros-narrateur se réfugie en Allemagne, à Weimar, la ville de Goethe et de Schiller. À peine arrivé, il rencontre Ilse, une pianiste, et succombe à une « attaque de romantisme aigu ». Dans ce cadre qui a quelque chose de féerique, où le surnaturel semble si proche et où tous les êtres possèdent « on ne sait quoi de mythologique », le héros entame une lente métamorphose intérieure qui lui permettra, à la fin du roman, de trouver pleinement le bonheur avec Ilse, au sommet du Brocken. Il règne parfois dans ce récit un climat vaguement étrange qui se précisera davantage au fil d’Othon et les sirènes (1944), excellent texte où Pierre Girard dévoile le côté nocturne de son univers, faisant dire à son héros-narrateur : « J’aime le noir mélange de la ville, de l’automne et de la mi-nuit ; les mouvements du ciel, les migrations de courlis, les rais de lumière qui passent sous les portes. C’est comme si l’on surprenait un secret ». C’est lors d’une nuit, justement, que le personnage va connaître une étrange aventure : il fait la connaissance d’une jeune anarchiste russe qu’il suit jusque dans sa chambre, avant d’en être chassé par l’adolescente ; il y retourne quelques instants plus tard, mais le logement d’Illona semble avoir légèrement changé d’aspect : si le mobilier est semblable, et s’il retrouve dans l’armoire le même uniforme qu’auparavant, les vitres aux fenêtres, absentes lors de sa précédente visite, ont été remplacées, et, à la place de l’adolescente, il trouve un jeune homme qui, malgré ses questions, ne lui donne aucune explication rationnelle, tenant au contraire des propos incohérents. Lorsqu’il ressort du bâtiment, le héros, tel un personnage de conte fantastique, se voit plongé dans la plus grande incertitude : « Une fois dans la rue, j’examinai avec soin l’entrée de la maison. Je ne la reconnaissais plus aussi bien. En somme, je pouvais m’être trompé. Mais… Mais… »
Contraint de fuir Genève après avoir provoqué un scandale en offrant une robe rouge à la jeune Virginie qui, ainsi vêtue, provoque d’irrésistibles désirs de lucre chez les Genevois, le héros-narrateur se réfugie en Allemagne, à Weimar, la ville de Goethe et de Schiller. À peine arrivé, il rencontre Ilse, une pianiste, et succombe à une « attaque de romantisme aigu ». Dans ce cadre qui a quelque chose de féerique, où le surnaturel semble si proche et où tous les êtres possèdent « on ne sait quoi de mythologique », le héros entame une lente métamorphose intérieure qui lui permettra, à la fin du roman, de trouver pleinement le bonheur avec Ilse, au sommet du Brocken. Il règne parfois dans ce récit un climat vaguement étrange qui se précisera davantage au fil d’Othon et les sirènes (1944), excellent texte où Pierre Girard dévoile le côté nocturne de son univers, faisant dire à son héros-narrateur : « J’aime le noir mélange de la ville, de l’automne et de la mi-nuit ; les mouvements du ciel, les migrations de courlis, les rais de lumière qui passent sous les portes. C’est comme si l’on surprenait un secret ». C’est lors d’une nuit, justement, que le personnage va connaître une étrange aventure : il fait la connaissance d’une jeune anarchiste russe qu’il suit jusque dans sa chambre, avant d’en être chassé par l’adolescente ; il y retourne quelques instants plus tard, mais le logement d’Illona semble avoir légèrement changé d’aspect : si le mobilier est semblable, et s’il retrouve dans l’armoire le même uniforme qu’auparavant, les vitres aux fenêtres, absentes lors de sa précédente visite, ont été remplacées, et, à la place de l’adolescente, il trouve un jeune homme qui, malgré ses questions, ne lui donne aucune explication rationnelle, tenant au contraire des propos incohérents. Lorsqu’il ressort du bâtiment, le héros, tel un personnage de conte fantastique, se voit plongé dans la plus grande incertitude : « Une fois dans la rue, j’examinai avec soin l’entrée de la maison. Je ne la reconnaissais plus aussi bien. En somme, je pouvais m’être trompé. Mais… Mais… »
Un humoriste à Genève
Si les récits de Pierre Girard recèlent une part de merveille, voire d’étrangeté, ils n’en sont pas moins très drôles, et c’est généralement sous le signe de l’humour que l’on situe l’œuvre du Genevois. Selon Edmond Jaloux, cette drôlerie vient notamment de la nature même des héros de Girard : à la fois exaltés et irrésolus, ces éternels rêveurs en constant décalage avec les situations qu’ils rencontrent ont pu être comparés à Charlot. On songe par exemple au personnage principal de Connaissez mieux le cœur des femmes (1927) – sans doute une des plus belles réussites de Pierre Girard en matière de fantaisie humoristique. Grand nigaud de 33 ans, Paterne est incapable de prendre la moindre décision et pour cela même toujours prompt à se lancer tête la première dans les catastrophes. Après s’être affranchi du joug de sa tante Augustine et de son oncle Abraham grâce à l’intervention d’un parent farfelu, Paterne, installé dans un hôtel, se lance à la recherche de l’amour. Dans cette quête, il va pouvoir compter sur des amis pour le moins extravagants, à commencer par M. Piquedon de Buibuis, son singulier voisin de chambre ; pouvant apparaître et disparaître « comme un songe », il aime à se présenter de la sorte : « J’exerce une profession assez peu connue. Je parle de Weber. Oui, de l’auteur du Freischütz. Je peux en parler une heure. Je raconte tout. Sa naissance, sa carrière, sa mort. […] Il y a une foule de gens, fortunés, qui ont, une fois ou deux dans leur existence, envie de parler de Weber avec quelqu’un ».
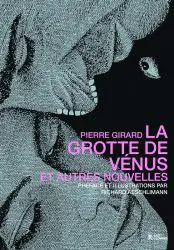 Volontiers frais et léger, l’humour de Pierre Girard peut également se faire grinçant, notamment dans des récits plus tardifs, comme Charles dégoûté des beefsteaks (1944), satire féroce de l’univers des banques suisses. Il arrive même que le rire chez lui prenne des teintes sombres, faisant ainsi apparaître au grand jour la dimension pessimiste de l’œuvre girardienne. On peut en voir un bon exemple à travers Monsieur Stark (1943). Dans ce court roman, Girard conte une fois de plus l’histoire d’une métamorphose – celle que subit le directeur d’une firme de cigarettes au contact de sa jeune et séduisante nouvelle secrétaire –, et pour ce faire il ne renonce en rien à son goût pour l’humour et la fantaisie. Mais, contrairement à son habitude, il installe insensiblement, au fil de son récit, un climat d’absurdité qui, dans les dernières pages du livre, débouche sur la violence et la mort. On retrouvera une semblable logique du pire dans certaines nouvelles de La Grotte de Vénus où, sans se départir de sa drôlerie, Girard explore une forme de grotesque tragique. On songe tout particulièrement au sort de Procope, héros du récit qui donne son titre au recueil : enfin retraité, il tombe sous le charme de Gilda, serveuse au café « La Grotte de Vénus » ; lorsque enfin, un matin, il se décide à aller lui rendre visite chez elle, il la retrouve nue en compagnie de Jéroboam, son meilleur ami, qu’il croyait mort depuis vingt ans à l’autre bout du monde, sur l’île des Serpents, d’une piqûre de mouche. Tandis que Procope sort de l’appartement après cette scène de retrouvailles passablement burlesque, il subit une attaque de frelons qui lui sera fatale.
Volontiers frais et léger, l’humour de Pierre Girard peut également se faire grinçant, notamment dans des récits plus tardifs, comme Charles dégoûté des beefsteaks (1944), satire féroce de l’univers des banques suisses. Il arrive même que le rire chez lui prenne des teintes sombres, faisant ainsi apparaître au grand jour la dimension pessimiste de l’œuvre girardienne. On peut en voir un bon exemple à travers Monsieur Stark (1943). Dans ce court roman, Girard conte une fois de plus l’histoire d’une métamorphose – celle que subit le directeur d’une firme de cigarettes au contact de sa jeune et séduisante nouvelle secrétaire –, et pour ce faire il ne renonce en rien à son goût pour l’humour et la fantaisie. Mais, contrairement à son habitude, il installe insensiblement, au fil de son récit, un climat d’absurdité qui, dans les dernières pages du livre, débouche sur la violence et la mort. On retrouvera une semblable logique du pire dans certaines nouvelles de La Grotte de Vénus où, sans se départir de sa drôlerie, Girard explore une forme de grotesque tragique. On songe tout particulièrement au sort de Procope, héros du récit qui donne son titre au recueil : enfin retraité, il tombe sous le charme de Gilda, serveuse au café « La Grotte de Vénus » ; lorsque enfin, un matin, il se décide à aller lui rendre visite chez elle, il la retrouve nue en compagnie de Jéroboam, son meilleur ami, qu’il croyait mort depuis vingt ans à l’autre bout du monde, sur l’île des Serpents, d’une piqûre de mouche. Tandis que Procope sort de l’appartement après cette scène de retrouvailles passablement burlesque, il subit une attaque de frelons qui lui sera fatale.
On le voit, l’œuvre de Pierre Girard échappe aux catégorisations simplistes ; « inclassable », l’écrivain suisse romand est avant tout, selon l’expression d’Henri de Ziegler, « un écrivain proprement inimitable » – un auteur qui, comme a pu le souligner Daniel Maggetti, « présente à un degré peu commun un ton personnel, une distance amusée, une élégance certaine ». Autant de qualités qui devraient encourager le lecteur d’aujourd’hui à (re)découvrir cet authentique enchanteur.
* Dessin de Richard Aeschlimann tiré de La grotte de Vénus (réédition L’Âge d’Homme, 2012).
Pierre Girard a publié, entre autres :
Romans et nouvelles : June, Philippe et l’amiral, Kra, 1924 ; Curieuse métamorphose de John, Kra, 1925 ; Lord Algernon, Kra, 1925 ; Histoire de Bélisaire, J. Gondrexon, 1926 ; Connaissez mieux le cœur des femmes, Kra, 1927 ; La rose de Thuringe, Calmann-Lévy, 1930 ; Syrup de cassis, Kundig, 1941 ; Amours au palais Wilson, Imprimeries réunies, 1942 ; Monsieur Stark, L. U. F., 1943 ; Othon et les sirènes, Portes de France, 1944 ; Charles dégoûté des beefsteaks, L. U. F., 1944 ; Table d’orientation, Portes de France, 1945 ; Le gouverneur de Gédéon, L. U. F, 1947 ; La Grotte de Vénus, L. U. F., 1948 ; La reine de la nuit, 13/12, 1955 ; Le major Buddle, Mermod, 1961.
Rééditions : Amours au palais Wilson suivi de Curieuse métamorphose de John – Lina – Syrup de cassis – Un printemps avec monsieur Töpffer, « Poche Suisse », L’Âge d’Homme, 1982 ; La rose de Thuringe, « Poche Suisse », L’Âge d’Homme, 1988 ; Lord Algernon, « Poche Suisse », L’Âge d’Homme, 2001 ; Le gouverneur de Gédéon suivi de Charles dégoûté des beefsteaks, « Poche Suisse », L’Âge d’Homme, 2005 ; Connaissez mieux le cœur des femmes, « Poche Suisse », L’Âge d’Homme, 2009 ; Othon et les sirènes, L’Arbre vengeur, 2012 ; La Grotte de Vénus et autres nouvelles, L’Âge d’Homme, 2012 ; Monsieur Stark, L’Arbre vengeur, 2014.
EXTRAITS
Algernon ricana. Ah ! c’était ainsi ? Ah ! la Nature se moquait ainsi de ses enfants, eh bien, il allait tout renier, imiter les autres hommes et leur cynisme. Il allait, oui, ce jour même, ce jour où il avait embrassé sa première femme, il allait s’acheter des chaussettes.
Lord Algernon, 1925 ; rééd. : L’Âge d’Homme, 2001, p. 43-44.
Je ne connaissais M. Ciappa-Ciappa que de nom, car Séréna m’en avait parlé une fois. Mais dès qu’il entra, je le reconnus. C’était lui. Il avait l’air de ces noyés qui dans les transatlantiques coulés errent, debout et blafards au gré des courants entre les tables encore servies. Une moustache pendait comme une algue sur sa figure. Il se déplaçait avec les gestes mous des cadavres sous l’eau.
« Iris et Séréna », La Grotte de Vénus, L. U. F, 1948, p. 291-292.
Un peu plus tard, Paterne vit un billet sous sa porte. « À toujours, je vous aime », avait écrit Spéranza.
Paterne lut ce billet, puis comprima son cœur de la main. Il alla à la fenêtre, l’ouvrit, s’accouda. Comme il était ému !
Eh bien, non ! Il n’était nullement ému, mais bouleversé de ne pas être ému.
Connaissez mieux le cœur des femmes, 1927 ; rééd. : L’Âge d’Homme, 2009, p. 66.