Avec son sourire engageant et cette simplicité qu’on retrouve dans ses textes, Hélène Harbec1 s’offre comme un rayon de soleil, mais un soleil qui peut luire pour mieux cacher ses inquiétudes. Elle s’affirme poète après s’être longtemps demandé quel était son véritable métier. D’un livre à l’autre, elle aborde les mêmes thèmes : enfance, mort, amour, toujours porteurs de la nécessité de fonder son écriture sur sa démarche personnelle.
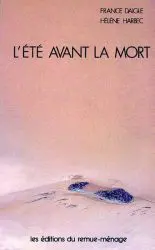 L’été avant la mort (Remue-ménage, 1986) est né de sa complicité avec France Daigle, qui l’encouragea dans la voie de l’écriture. Les quelques poèmes publiés par Harbec dans des revues littéraires annonçaient la délicatesse de sa pensée et la finesse de sa plume. Elles se sont donné comme mandat d’écrire en parallèle durant un été (1984) sur un thème commun au rythme d’une page par jour : du 5 juillet au 14 août selon les dates données dans la partie signée par Daigle. Si le texte de cette dernière, qui ouvre ce livre, est concis et presque froid, celui d’Harbec est chaud comme un soleil d’été, empreint de la vie quotidienne et de ses petits problèmes et bonheurs. Le thème, la mort qui doit survenir après cet été, est traité indirectement. Manifestement, Harbec avait plus le désir de chanter la vie que de parler de la mort. Elle oriente son sujet autour de la façon dont les deux auteures réagissent à l’écriture, de la vie du personnage principal avec ses enfants et d’une femme qui serait dans une pièce de théâtre et qui, elle, se suicide à la fin. Ce va-et-vient entre fiction et autobiographie caractérisera les œuvres suivantes, tant poétiques que romanesques.
L’été avant la mort (Remue-ménage, 1986) est né de sa complicité avec France Daigle, qui l’encouragea dans la voie de l’écriture. Les quelques poèmes publiés par Harbec dans des revues littéraires annonçaient la délicatesse de sa pensée et la finesse de sa plume. Elles se sont donné comme mandat d’écrire en parallèle durant un été (1984) sur un thème commun au rythme d’une page par jour : du 5 juillet au 14 août selon les dates données dans la partie signée par Daigle. Si le texte de cette dernière, qui ouvre ce livre, est concis et presque froid, celui d’Harbec est chaud comme un soleil d’été, empreint de la vie quotidienne et de ses petits problèmes et bonheurs. Le thème, la mort qui doit survenir après cet été, est traité indirectement. Manifestement, Harbec avait plus le désir de chanter la vie que de parler de la mort. Elle oriente son sujet autour de la façon dont les deux auteures réagissent à l’écriture, de la vie du personnage principal avec ses enfants et d’une femme qui serait dans une pièce de théâtre et qui, elle, se suicide à la fin. Ce va-et-vient entre fiction et autobiographie caractérisera les œuvres suivantes, tant poétiques que romanesques.
Avec Le cahier des absences et de la décision (D’Acadie, 1991), Hélène Harbec revisite son enfance et interroge sa relation avec sa mère, alors qu’elle-même est devenue mère. Les poèmes sont courts, précis : Harbec vise l’économie pour atteindre l’essentiel, préservant les craintes et les espoirs de l’enfance, et de la relation mère-enfant.
 On retrouve mère et enfants dans son premier roman, L’orgueilleuse (Remue-ménage, 1998). L’histoire est simple : Jeanne, la narratrice, mère de quatre enfants dont les plus âgés sont maintenant des adolescents, quitte un 30 décembre son mari et père des enfants. Elle choisit d’aller passer l’hiver dans une pension pour femmes seules où vivent également cinq femmes, dont la propriétaire, Léa. Au printemps, elle quitte cette pension et Moncton pour un retour temporaire et nécessaire dans sa ville natale, Saint-Jean-sur-Richelieu. Sa mère s’est noyée et cette mort porte en elle toute l’incertitude du choix de la vie ou de la mort, choix que se pose maintenant Jeanne dans cet hiver qu’elle traverse dans la solitude de ses lectures. Cette quête intérieure lui permettra de retrouver le sourire et de découvrir autrement son corps. Un texte d’une grande sensibilité qui annonce les œuvres suivantes.
On retrouve mère et enfants dans son premier roman, L’orgueilleuse (Remue-ménage, 1998). L’histoire est simple : Jeanne, la narratrice, mère de quatre enfants dont les plus âgés sont maintenant des adolescents, quitte un 30 décembre son mari et père des enfants. Elle choisit d’aller passer l’hiver dans une pension pour femmes seules où vivent également cinq femmes, dont la propriétaire, Léa. Au printemps, elle quitte cette pension et Moncton pour un retour temporaire et nécessaire dans sa ville natale, Saint-Jean-sur-Richelieu. Sa mère s’est noyée et cette mort porte en elle toute l’incertitude du choix de la vie ou de la mort, choix que se pose maintenant Jeanne dans cet hiver qu’elle traverse dans la solitude de ses lectures. Cette quête intérieure lui permettra de retrouver le sourire et de découvrir autrement son corps. Un texte d’une grande sensibilité qui annonce les œuvres suivantes.
Va (Perce-Neige, 2002) reprend les mêmes thèmes : enfance, mort, amour. Le recueil commence par une rupture amoureuse, et dans de très courts poèmes, toujours empreints de tendresse, de douceur, l’auteure relate son cheminement, les étapes de sa peine. Elle s’appuie sur son quotidien, sur les petites choses qui font que l’on aime vivre et dans lesquelles on se reconnaît. Elle demeure ainsi en retrait du lyrisme, lui préférant la courtepointe. Puis apparaît un nouvel amour. Le ton change avec l’espoir qui renaît dans cette passion. Cette relation occupe le cœur du recueil, de l’apprivoisement à la joie de vivre cet amour partagé. Mais il y a aussi la conscience que cela pourrait ne pas durer. Cette relation vivifie la poète, lui redonne le goût d’écrire, tandis que son regard rejoint les autres personnes qui l’entourent. Car ce chant d’amour est aussi et peut-être surtout un hymne à l’amitié, à l’ouverture aux autres. Souvent construits autour d’une anecdote, parfois relevés d’une touche d’humour, les poèmes sont toujours fins.
 Le roman Les voiliers blancs (Perce-Neige, 2004) brode en de très courts chapitres la vie de trois femmes : Florence, qui devient infirmière auxiliaire, Céleste, sa fille, et Voisine, surnommée ainsi par Céleste, qui est l’amie de la Léa de L’orgueilleuse. Céleste passera de trois à six ans, Florence vivra une relation amoureuse avec Thomas, qui mourra dans un accident, et Voisine demeurera seule. De petits faits, de petits bonheurs, de grandes tristesses. Si le roman semble s’essouffler dans le dernier quart, il n’en reste pas moins qu’on est charmé par la fantaisie de Céleste et touché par la manière toute en retenue, mais sans fausse pudeur, dont est raconté le travail de Florence avec ses patients.
Le roman Les voiliers blancs (Perce-Neige, 2004) brode en de très courts chapitres la vie de trois femmes : Florence, qui devient infirmière auxiliaire, Céleste, sa fille, et Voisine, surnommée ainsi par Céleste, qui est l’amie de la Léa de L’orgueilleuse. Céleste passera de trois à six ans, Florence vivra une relation amoureuse avec Thomas, qui mourra dans un accident, et Voisine demeurera seule. De petits faits, de petits bonheurs, de grandes tristesses. Si le roman semble s’essouffler dans le dernier quart, il n’en reste pas moins qu’on est charmé par la fantaisie de Céleste et touché par la manière toute en retenue, mais sans fausse pudeur, dont est raconté le travail de Florence avec ses patients.
Véritable suite à Va, Le tracteur céleste (Perce-Neige, 2005) en a les mêmes qualités : délicatesse des sentiments et des émotions et cet humour qui naît dans les hasards de la vie. Dans Les voiliers blancs, Thomas, qui était écrivain, travaillait à un roman qu’il voulait appeler Le tracteur, en précisant que ce nom vient du verbe latin « trahere », qui signifie « tirer ». Dans Les voiliers blancs, Harbec transpose ce qui compose la vie quotidienne, petits détails et petites anecdotes, en réussissant à en faire jaillir une poésie du quotidien. L’intérêt est dans la façon dont elle met ses préoccupations en situation. Par exemple, les oiseaux (souvent identifiés par leur espèce) sont nombreux à venir l’inspirer. Fragiles et graciles, légers et gracieux, ils sont là, souvent victimes d’accidents, de la chasse, d’une fenêtre même, mais aussi appel à l’ouverture, à l’espace, au grand large. Et on mange beaucoup dans ce recueil. La nourriture sert de cadre, d’assise au texte, lui donnant réalité, facilitant l’aveu, comme si le contexte permettait de mieux saisir l’émotion, la relation entre la poète et l’être aimé. Car il s’agit d’amour ici. Amour ambigu, amour mis en péril, amour ponctué par les Saint-Valentin de 2001 et de 2002 qui enracinent le texte dans le temps, dans l’expérience humaine, amour heureux, enfin.
 Dans Chambre 503 (David, 2009), Harbec nous fait partager la dernière année de vie de son père, qu’elle a accompagné durant son hospitalisation. Ce récit est fondé sur les notes qu’elle prenait après chacune de leurs rencontres, qu’elle a ensuite transposées pour en créer une émouvante œuvre littéraire. Elle reprend en l’approfondissant la façon d’écrire qu’elle avait explorée dans Les voiliers blancs. L’écriture est tour à tour chirurgicale, impressionniste, tendre, descriptive, toujours juste. Même si le centre où elle se rend est voué aux soins palliatifs, c’est la vie qui anime la plume d’Harbec. On apprend à connaître un personnel toujours dévoué, quoique parfois débordé, et d’autres personnes qui « vivent » la fin de leur vie. La plume d’Harbec saisit les instants, les fixe et les transcende : cet accompagnement devient un témoignage universel d’amour entre un père et sa fille, une réflexion sur la vie et la mort. Elle assiste à la lente dégradation du corps et de l’esprit de son père atteint d’un cancer du cerveau, tout en cherchant à comprendre, mais sans se laisser aller à des raisonnements philosophiques ou moralistes. Elle décrit les gestes des infirmières, les selles, les plaies de lit, l’amaigrissement, les repas, ce qu’il mange, boit, ses réactions aux visites, ses rêves éveillés et le monde imaginaire qu’il voit, son désir de retourner chez lui. Mais ce caractère presque clinique n’est ni répétitif ni ennuyant. Bien au contraire, il nous permet d’accompagner son père, d’être témoin d’une certaine façon de cette mort.
Dans Chambre 503 (David, 2009), Harbec nous fait partager la dernière année de vie de son père, qu’elle a accompagné durant son hospitalisation. Ce récit est fondé sur les notes qu’elle prenait après chacune de leurs rencontres, qu’elle a ensuite transposées pour en créer une émouvante œuvre littéraire. Elle reprend en l’approfondissant la façon d’écrire qu’elle avait explorée dans Les voiliers blancs. L’écriture est tour à tour chirurgicale, impressionniste, tendre, descriptive, toujours juste. Même si le centre où elle se rend est voué aux soins palliatifs, c’est la vie qui anime la plume d’Harbec. On apprend à connaître un personnel toujours dévoué, quoique parfois débordé, et d’autres personnes qui « vivent » la fin de leur vie. La plume d’Harbec saisit les instants, les fixe et les transcende : cet accompagnement devient un témoignage universel d’amour entre un père et sa fille, une réflexion sur la vie et la mort. Elle assiste à la lente dégradation du corps et de l’esprit de son père atteint d’un cancer du cerveau, tout en cherchant à comprendre, mais sans se laisser aller à des raisonnements philosophiques ou moralistes. Elle décrit les gestes des infirmières, les selles, les plaies de lit, l’amaigrissement, les repas, ce qu’il mange, boit, ses réactions aux visites, ses rêves éveillés et le monde imaginaire qu’il voit, son désir de retourner chez lui. Mais ce caractère presque clinique n’est ni répétitif ni ennuyant. Bien au contraire, il nous permet d’accompagner son père, d’être témoin d’une certaine façon de cette mort.
 La solitude est au cœur de L’enroulement des iris (Le Noroît, 2013). La poète est seule face à elle-même et elle apprend à s’apprivoiser alors qu’elle s’installe dans un nouvel appartement. Sans céder à la panique qu’elle sait n’être pas loin, elle fait lentement le tour d’elle-même dans ses émotions et dans son environnement. Les poèmes, tous aussi courts que ceux des recueils précédents, n’ont plus cette légèreté qui lui venait d’une vie avec l’être aimé. Les traits d’humour, les anecdotes, les personnages ont disparu. Harbec tente de définir l’insondable de ce qu’elle ressent, se servant de la poésie comme d’un miroir devant lequel elle se regarde en se demandant si elle est vivante ou morte. Elle redécouvre la fonction du geste, celle des sens, toujours un peu surprise de ses découvertes. Les iris évoqués dans le titre peuvent tout aussi bien représenter la fleur et son symbolisme (Iris, la messagère) que l’œil et sa capacité de discerner. Et l’enroulement n’est pas sans évoquer un resserrement, voire un repli sur soi comme si la poète ressentait le besoin de faire le vide autour d’elle pour mieux se saisir. En ce sens, L’enroulement des iris est l’œuvre du dévoilement. Tous les livres précédents tendaient vers cet aboutissement. Du moins, jusqu’au prochain.
La solitude est au cœur de L’enroulement des iris (Le Noroît, 2013). La poète est seule face à elle-même et elle apprend à s’apprivoiser alors qu’elle s’installe dans un nouvel appartement. Sans céder à la panique qu’elle sait n’être pas loin, elle fait lentement le tour d’elle-même dans ses émotions et dans son environnement. Les poèmes, tous aussi courts que ceux des recueils précédents, n’ont plus cette légèreté qui lui venait d’une vie avec l’être aimé. Les traits d’humour, les anecdotes, les personnages ont disparu. Harbec tente de définir l’insondable de ce qu’elle ressent, se servant de la poésie comme d’un miroir devant lequel elle se regarde en se demandant si elle est vivante ou morte. Elle redécouvre la fonction du geste, celle des sens, toujours un peu surprise de ses découvertes. Les iris évoqués dans le titre peuvent tout aussi bien représenter la fleur et son symbolisme (Iris, la messagère) que l’œil et sa capacité de discerner. Et l’enroulement n’est pas sans évoquer un resserrement, voire un repli sur soi comme si la poète ressentait le besoin de faire le vide autour d’elle pour mieux se saisir. En ce sens, L’enroulement des iris est l’œuvre du dévoilement. Tous les livres précédents tendaient vers cet aboutissement. Du moins, jusqu’au prochain.
1. Hélène Harbec est née le 28 juin 1946 à Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec). Elle obtient en 1967 un baccalauréat ès arts au Collège Saint-Jean, qui est affilié à l’Université de Montréal, puis une licence ès lettres de l’Université Laval en 1970. Elle s’installe à Moncton en 1970 et enseigne le français à l’Université de Moncton puis à l’Institut de Memramcook. Après quelques années dans l’enseignement, elle entreprend des études en soins infirmiers à l’École d’enseignement infirmier Providence de Moncton, et est reçue infirmière en 1977. Au bout d’un an de pratique comme infirmière, elle s’oriente vers le milieu culturel, devenant recherchiste contractuelle à Radio-Canada, tant pour la radio que pour la télévision. S’ajouteront la scénarisation et l’assistance à la réalisation.
EXTRAITS
Bottines d’enfant
Un enfant veut toujours jouer
j’apprends à ton fils
à marcher sur la voie ferrée
derrière la maison funéraire
bottine droite
devant bottine gauche
sans tomber
dans les herbes qui chatouillent
avant de rentrer à nouveau
essayer le prie-Dieu
devant ta photo qui sourit
aux gens qui pleurent
Va, p. 98.
Bain de Maurice bébé, monsieur A. au bracelet.
L’infirmier, toujours du côté gauche, Florence du côté droit.
– Je vais prendre votre main, lui dit-elle.
– Moi aussi, je prendrais bien votre main, répondit monsieur A. en tournant la tête vers elle.
Doigts longs, lunules bien dessinées.
Comme l’infirmier terminait toujours sa partie avant elle, il en profita pour aller voltiger dans les corridors.
Florence eut le temps de remonter les couvertures sur le corps lavé et de poser doucement les mains autour du cou de monsieur A.
– Ça doit prendre du courage ?
Il fit signe que oui.
Elle vit deux larmes couler.
Monsieur A. ne vit pas les siennes.
Les voiliers blancs, p. 99.
Il regarde du côté vaporeux de la chambre, puis il dit qu’il veut faire pipi. Je l’amène aux toilettes sur sa chaise gériatrique. Il désire que nous nous arrêtions au lavabo pour se laver les mains, mais il souhaite ardemment revenir au lit, c’est sa pensée la plus profonde. Allongé bien droit sous les couvertures, il dit qu’il peut rester comme ça, les yeux fermés, à nous écouter. Au souper, il devient anxieux. Il sait que nous allons bientôt partir et fermer les clôtures. Quand il est tout seul, il a beau appeler de l’aide en implorant Madame ! Madame ! personne ne vient. Nous demeurons sur le seuil de la porte à le regarder. Il se tourne sur le côté, face au mur. Dos courbé. Tête penchée sur la poitrine. Nuque à découvert.
Chambre 503, p. 20.











