S’il fut un temps où le Québec se désintéressait de l’histoire, ce danger est révolu. En plus de multiplier les titres, l’histoire recourt à tous les genres littéraires : des romans et des synthèses, des mémoires et des essais. « La science de l’homme dans le temps » (Marc Bloch) touche à tout.
La périphérie
Il st divers types de romans historiques. Les uns usent des faits comme d’un tremplin, d’autres y demeurent attachés.

Yves Dupéré
LES DERNIERS INSURGÉS
Hurtubise HMH, Montréal, 2006, 452 p. ; 27,95 $
Combinaison classique : un décor familier et une intrigue surgie de l’imagination de l’auteur. D’un côté, 1837 ; de l’autre, l’amour et la haine. D’un côté, la mémoire ; de l’autre, l’art du roman. Yves Dupéré, dans ce bouquin, se montre chercheur plus que romancier. Il connaît l’époque et les lieux, il recrée avec justesse les espoirs et les incertitudes du temps, il redonne vie aux figures légendaires que sont Papineau et Nelson. Par contre, ses dialogues sont rarement plausibles et naturels et il accorde une importance et une pérennité agaçantes à la rivalité entre deux gamins. Cette démesure dans le conflit personnel réduit le magnétisme de la rébellion. L’écriture, parfois gauche et rarement prenante, empêche le récit de prendre de l’altitude.

Robert-Lionel Séguin
LE DERNIER DES CAPOTS-GRIS
suivi de SOUVIENS-TOI, MÉDITATIONS SUR 1837
Trois-Pistoles, Trois-Pistoles, 2006, 212 p. ; 24,95 $
Fin connaisseur, Georges Aubin qualifie, dans son introduction, ce texte de « roman tout simple, voire naïf ». On n’y trouve ni la rigueur qui fera le renom de l’ethnologue ni le souffle des grands créateurs. En revanche, on recevra comme autant de pieds de nez envoyés à la rectitude politique les mots bruts et ravageurs qu’inspire 1837 à un Québécois de dix-heuf ans. Sur ce terrain, Robert-Lionel Séguin et Georges Aubin marchent de conserve. Le premier accuse une « équipe de larrons, guidée par la pègre libérale de Montréal » de vouloir faire disparaître du programme d’histoire les événements de 1837-1838 ; quant au second, la rage, rien de moins, explique que les Anglais soient « réduits à l’impuissance par une poignée de paysans ». Chez les deux hommes, la ferveur et l’enracinement.

Sergine Desjardins
MARIE MAJOR
Guy Saint-Jean, Laval, 2006, 485 p. ; 26,95 $
Ce roman fait honneur à la famille des romans historiques. L’auteure s’astreint à une recherche minutieuse, mais elle comble librement les vides laissés par une histoire forcément stylisée. À cela s’ajoute une chaude empathie entre l’auteure et son héroïne : comment s’en étonner quand on sait que Marie Major est l’aïeule de l’auteure ?
La Nouvelle-France que décrit Marie Major pratique le soupçon, la misogynie, la superstition. Autant que d’autres sociétés, mais avec moins de propension à brûler les sorcières. L’arbitraire clérical et judiciaire sévit avec force, avec le résultat que l’épouse paie de sa liberté les frasques du mari volage et hypocrite et que l’évêque obéit à sa vanité plus qu’à un quelconque sentiment de justice. Bien construit, émouvant, persuasif.
Son histoire à soi
La tentation de l’autobiographie ou du journal intime titille bien des écrivains virtuels. Y succomber ne garantit pas la valeur littéraire ou historique du résultat.

André Ouimet
JOURNAL DE PRISON D’UN FILS DE LA LIBERTÉ
1837-1838
Typo, Montréal, 2006, 157 p. ; 10,95 $
Le document n’a guère d’analogue. Ni par le style ni par les circonstances qui l’entourent. Jeune avocat, André Ouimet voit les revendications des vaincus francophones se briser sur l’intransigeance de marchands anglophones confondant conquête militaire et exploitation commerciale. Ouimet n’a pourtant pas la bagarre dans le sang et il se veut le pacifique porte-parole des francophones. Il sera quand même arrêté le 16 novembre 1837 et passera plus de quatre mois en détention. D’où son journal.
Ouimet siffle-t-il dans le noir pour se donner du courage ? Est-il si friand d’humour noir qu’il envisage sereinement la pendaison ? A-t-il plutôt la conviction que tout cela est une mauvaise blague de l’histoire ? On ne sait trop. Chose certaine, Ouimet rigole, pique, moque. Les observations abondent au sujet des compagnons de détention, des geôliers, des soldats anglais et tout cela, bien que déconcertant, sonne juste. Comme d’habitude, Georges Aubin* fournit des notes précises, intelligentes, éclairantes.
Le texte a été établi, présenté et annoté par Georges Aubin.
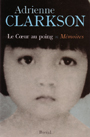
Adrienne Clarkson
LE CŒUR AU POING
MÉMOIRES
Trad. de l’anglais par Nicole et Émile Martel
Boréal, Montréal, 2006, 360 p. ; 29,95 $
Le parcours est impressionnant. Il n’y a rien de banal à passer du non-statut de refugiée à la gloire médiatique et politique. Il est rare, d’autre part, qu’une telle réussite doive tout au piston et rien aux qualités personnelles. Un préjugé favorable accueille donc les Mémoires d’Adrienne Clarkson. Il dure tant que les souvenirs portent sur l’enfance, l’insertion en milieu canadien, les études en France, l’amitié avec une femme qui a correspondu avec Rilke et dont l’appartement parisien s’orne de Borduas. L’intérêt s’étiole quand se déploie la carrière de l’adulte. Adrienne Clarkson rappelle ses rencontres prestigieuses, mais elle y greffe des commentaires anachroniques et maladroits. « Je me suis toujours estimée chanceuse d’avoir vu l’Iran avant la révolution islamique et avant toute la destruction qui accompagne inévitablement une révolution ». Le chah y régnait… « […] l’une des visions les plus mémorables que nous ayons conservées est celle d’une petite fille sur un trottoir alors que nous passions dans la rue en voiture, qui, voyant que nous la regardions, s’est couvert la tête et le visage de son tchador. Je me souviens d’avoir pensé que, si on avait quatre ans et qu’on faisait déjà cela, les chances de devenir moderne étaient bien minces. » Propos bizarres de la part d’une femme qui a réussi ce passage, étonnants de la part d’une journaliste dont les verdicts ne devraient pas imiter les couperets. Quant aux années d’Adrienne Clarkson comme gouverneur général, elles nous valent un carnet mondain, non une réflexion sur la fonction.

Thomas-Louis Tremblay
JOURNAL DE GUERRE
(1915-1918)
Trad. de l’anglais par Nicole et Émile Martel
Athéna/Musée du Royal 22e Régiment, Outremont, 2006, 331 p. ; 29,95 $
Publié presque un siècle après sa rédaction, ce Journal en dit plus long sur l’époque que sur le mémorialiste. Alors que les sentiments de Thomas-Louis Tremblay n’émergent qu’en lueurs éphémères, les mSurs militaires et politiques de la société d’alors accaparent l’avant-scène. Tremblay écrit un français misérable, mais l’armée vivait son unilinguisme. Quand Tremblay note que les décorations ornent plutôt les poitrines anglo-canadiennes et glorifient les états-majors plus que « les petits, les crottés, les sans-grade », le constat reflète des convictions répandues. Cela fait la valeur du document : il en dit long même quand il pratique l’autocensure.
Observer l’intérieur de l’armée exige des ajustements. Dans certains cas, c’est soi-même qu’on rappelle à l’ordre. Avant de reprocher à un militaire en permission de fréquenter les Folies-Bergères, peut-être faut-il se demander comment résiste l’équilibre mental de celui qui côtoie l’horreur. Quand, toutefois, un officier fait peu de cas des morts imputables à ses décisions, il n’est plus de nuance qui tienne et Tremblay a le mérite de l’affirmer. Même si « le sang sèche vite en entrant dans l’histoire », un officier demeure comptable des vies fauchées. Quant à la peine de mort imposée aux indisciplinés, elle est appliquée trop fréquemment pour que résiste l’excuse d’un « exemple indispensable ». Tremblay escamote le sujet. À l’inverse, il tient à plusieurs reprises des propos qui rendent la rectitude politique (presque) désirable. « 14 décembre : J’ai mis Hagan à la porte hier. Je n’aime pas la figure de ce sale Boche ». Portugais et Sénégalais auront droit à la même délicatesse. La voix qu’on entend est-elle celle d’un homme ou celle d’une institution et d’une époque ? Document important.
Marcel Tessier
CHRONIQUES D’HISTOIRE T. I et II
T. I : L’Homme, Montréal, 2004, 282 p. ; 24,95 $
T. II : L’Homme, Montréal, 2004, 255 p. ; 24,95 $
CHRONIQUES BIOGRAPHIQUES
L’homme, Montréal, 2006, 298 p. ; 24,95 $
Présentées à la télévision ou dans un quotidien, les chroniques historiques de Marcel Tessier visent à « donner le goût aux Québécois, d’aller plus loin à la recherche de leurs racines ». De fait, certaines informations relayées par Tessier piqueront la curiosité : l’esclavage pratiqué ici, l’Acadie reliée à la Nouvelle-Écosse plutôt qu’au Nouveau-Brunswick… Clair et modeste, l’objectif impose pourtant sa limite : le chroniqueur répercutera l’histoire convenue. Tessier insistera sur les personnages familiers, les dates classiques, les clichés usuels. Assez rares, les ajouts seront parfois équivoques. Ainsi, Marguerite Bourgeoys « fut la première à enseigner à des filles. Mais le curé Souart fut le premier à ouvrir une classe pour garçons. C’est donc à juste titre qu’on le reconnaît aujourd’hui comme premier instituteur de la colonie naissante ». Autre raccourci : « […] apprivoisés, les Indiens ne se feront pas prier pour servir fidèlement les nouveaux maîtres ». De même, Tessier porte à l’actif de d’Iberville l’attaque contre Deerfield (« À 18 ans, il part avec des miliciens canadiens vers Deerfield… »), alors que Mylène Gilbert-Dumas (1704,VLB, 2006) y voit autre chose. Cela cause plus de dégâts que les quelques inexactitudes qui déparent l’ensemble. Une différence notable sépare les deux tomes : le premier saute d’un sujet à l’autre, avec le risque de la dispersion, le second étoffe et allonge les exposés, exposant l’auteur à se faire plaideur.
Les Chroniques biographiques proviennent de la même main. Même sincérité, même honnêteté, même fragilité devant les repères extérieurs, même faiblesse de l’analyse. Marcel Tessier est doué d’une voix dont tous font l’éloge, il séduit les auditoires, il raconte avec verve et sérieux. Il aime les gens au point de dépendre de leur affection. La célébrité semble possible. Lorsqu’un choix s’imposera entre les aléas d’une carrière de chanteur et la sécurité personnelle et familiale, Tessier sombre. Survivant au naufrage, il tente sans prudence suffisante l’aventure électorale. Nouvelles meurtrissures. Émouvant et triste.
L’histoire de l’autre
Plutôt que de se raconter, certains tentent le portrait d’autrui. La biographie accueille aussi volontiers les visées pédagogiques que les hommages à une personnalité marquante. Elle sera réussie quand les plus classiques critères de ce genre recevront leur dû : distance critique, maîtrise des sources et des témoignages…

Marguerite Paulin
JACQUES FERRON
LE MÉDECIN, LE POLITIQUE ET L’ÉCRIVAIN
XYZ, Montréal, 2006, 168 p. ; 18 $
L’approche choisie par Marguerite Paulin convient à ce proche parent de Protée que fut Jacques Ferron. Puisqu’il change constamment de style, de plume et presque d’identité, il s’imposait de le laisser vagabonder à travers lieux et dates. D’où les féconds retours en arrière, les audaces offertes au public et les confidences murmurées aux proches, les soupçons aux limites de la paranoïa et les arbitrages entre la fibre Caron et celle dont les Ferron sont porteurs. « Peu importe s’il est injuste, pour lui, les Caron sont des parvenus. » Ferron, du coup, oublie que c’est aux Caron qu’il doit son amour des chevaux ! Imprévisible Jacques Ferron dont l’auteure constate et recrée les certitudes et la fragilité. Paradoxal Ferron que tous rangent parmi les grands intouchables et qui, pendant des années, vend à peine 200 copies de ses œuvres. Ferron maintiendra quand même, note l’auteure, certaines constantes. Toujours, il se rangera du côté des humbles. Toujours aussi, il redoutera la folie. En lui, solidarité et peur coexistaient. Beaucoup de doigté chez Marguerite Paulin.

Charles Denis
ROBERT BOURASSA T. I
LA PASSION DE LA POLITIQUE
Fides, Montréal, 2006, 404 p. ; 29,95 $
Admis à l’intimité de Robert Bourassa, Charles Denis avait tout pour livrer un portrait pénétrant de l’ancien premier ministre : conversations à huis clos, maniement des dossiers, participation aux stratégies, entrées privilégiées dans les cénacles libéraux, etc. Le résultat, hélas ! est désastreux. Il est l’hommage d’un acolyte complaisant. Bourassa méritait mieux.
Le problème, c’est que Denis veut rendre Bourassa incapable d’erreur. Il lui attribue la totalité des talents et des vertus. « La réalité est que Bourassa a toujours fait preuve d’une liberté totale. » La réalité est plus nuancée. Il y eut parfois amnésie sélective et parfois une mauvaise lecture de la conjoncture. Bourassa remporta le pari de l’hydroélectricité, beaucoup des 100 000 emplois promis manquent à l’appel. Quand, à l’ouverture des jeux olympiques, Bourassa déclare « mission accomplie », il passe sous silence le colossal déficit. « Les installations de Mirabel, souligne encore Bourassa, vont avoir une ampleur qui en fera l’un des plus grands aéroports de l’Amérique du Nord. » L’éloge se discrédite à force d’inflation.
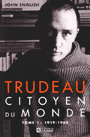
John English
TRUDEAU CITOYEN DU MONDE T. I
1919-1968
Trad. de l’anglais par Suzanne Anfossi
L’Homme, Montréal, 2006, 542 p. ; 37,95 $
L’homme a été tellement adulé et si intensément détesté qu’on croyait bien tout savoir de lui. John English, patient, pondéré, prouve qu’on aurait eu tort de fermer le dossier. Sa biographie de Pierre Elliott Trudeau fourmille de révélations éclairantes, mais elle est surtout riche d’une réflexion à la hauteur du phénomène. Le ton ne doit rien à l’idolâtrie ni au rejet systématique. Tout au plus pourrait-on reprocher à la biographie ce qui, pourtant, fait la gloire d’un bon système judiciaire : la présomption d’innocence. Quand aucune certitude ne se dégage des faits, English fait jouer le doute en faveur de Trudeau. Cela n’est quand même pas anormal.
Parmi les axes qui structurent la biographie, English insiste sur la formation de départ, la fortune familiale, la présence de la mère, les flirts du célibataire, la confiance tenace accordée à des revues au tirage confidentiel… Sur chaque front, English est honnête, allergique au manteau de Noé comme au voyeurisme médiatique, attentif aux autres biographies de Trudeau et autonome dans ses appréciations. À ce stade, car ce premier tome s’arrête au moment où Trudeau prend la direction du Parti libéral fédéral, English a déjà établi que Trudeau tient à ses mystères, mais qu’un bon biographe peut en percer plusieurs. Une lecture tonifiante.
Quand doute l’histoire
Le regard qui examine le passé observe la fragilité des certitudes. S’il insiste, on doit rouvrir les enquêtes bâclées et oser des interprétations nouvelles. Certains auteurs maîtrisent l’exigeante pédagogie de la remise en question.

Serge Gagnon
QUAND LE QUÉBEC MANQUAIT DE PRÊTRES
LA CHARGE PASTORALE AU BAS-CANADA
Presses de l’Université Laval, Québec, 2006, 414 p. ; 25 $
L’auteur est de ces chercheurs qui, sans fracas, mais avec une infinie patience, retournent chaque pierre, les blanches comme les autres. Cette sereine rigueur autorise Serge Gagnon à choisir un titre aux allures de raccourci : oui, le Québec a déjà manqué de prêtres. Un Québec particulier, certes. Pendant un temps limité, certes. Pour des raisons qui perdront leur influence, certes. Mais, oui, le Québec a déjà manqué de prêtres. Pendant la quarantaine d’années qui s’étend de la Révolution française aux tensions qui préludent à la rébellion, le travail proprement pastoral dépend d’une centaine de prêtres dont plusieurs n’ont ni la préparation souhaitable, ni la santé. Le diocèse de Québec a les dimensions d’un continent, les villes réclament, tandis que les paroisses rurales veillent sur des territoires élargis. L’ensemble construit une alternative douloureuse : privilégier le travail pastoral ou favoriser l’enseignement ? La pénurie, de fait, se résorbera lorsque les séminaires assureront une relève plus populeuse et mieux préparée. Dans l’intervalle, une poignée de pasteurs dut assumer des tâches surhumaines. Serge Gagnon fait entendre la voix de ces hommes épuisés, dépassés, conscients de leurs carences, courant d’une urgence à l’autre. Gagnon met également en lumière les priorités de l’épiscopat d’alors : s’il faut choisir entre la messe dominicale et le sermon, que la formation des consciences reçoive la priorité.

Yves Tremblay
VOLONTAIRES
DES QUÉBÉCOIS EN GUERRE (1939-1945)
Athéna, Outremont, 2006, 144 p. ; 19,95 $
Lors du conflit de 1939-1945, les volontaires québécois sont-ils aussi nombreux que ceux du Canada anglais ? La question, tendancieuse et réductrice, ne rend pas justice au livre. À la lecture, en effet, on constate que l’auteur voit plus loin que les chiffres. Un autre constat s’ajoute, moins réjouissant. Si les questions posées méritent l’attention, la méthodologie utilisée fragilise les réponses. Surgit alors une tentation à laquelle l’auteur résiste mal, celle de substituer son interprétation à celle des témoins.
Quoi qu’en dise l’auteur, l’échantillon déconcerte. Dix-neuf vétérans le composent, dont seulement huit qu’on pourrait qualifier sans mépris d’exécutants. Trois sont des sous-officiers et huit sont officiers à la fin du conflit. Les délais étonnent eux aussi. La guerre se termine en 1945, les entrevues sont menées en 1995 et on attendra 2005 avant que l’analyste se penche sur les entrevues conduites par quelqu’un d’autre. Point n’est besoin d’être docteur ès communications pour redouter la distorsion ni d’être gérontologue pour accueillir prudemment des impressions ressassées pendant un demi-siècle et cent fois exposées aux réactions des proches.
Les conclusions de l’auteur laissent songeur. Peut-être le Québec détestait-il la conscription plus encore que la guerre. Peut-être les Québécois jugeaient-ils correctement l’unilinguisme de l’armée.
Carl Leblanc
LE PERSONNAGE SECONDAIRE
Boréal, Montréal, 2006, 248 p. ; 24.95 $
Démarche fascinante et courageuse irriguée par une rédaction agile et musclée. Une question, lancinante, sans cesse reformulée, finit par polariser le débat : quand il est question de la vie, un humain peut-il n’être qu’un personnage secondaire ? Dans cette perspective, que n’aurait pas rejetée le Camus des Justes, Carl Leblanc analyse le sort de James Richard Cross. Un échange entre Leblanc et un des ravisseurs condense le problème :
« – Pourquoi parler de Cross ? Il y avait des milliers de chômeurs au Québec en 1970, pris en otages par des compagnies sans scrupules…
– Ça n’est tout de même pas la même affaire !
– C’est la même maudite affaire !
– Les chômeurs ne sont pas ligotés, n’ont pas les yeux bandés et ne sont pas menacés de mort !
– Il n’est pas mort, Cross, à ce que je sache !
Je n’avais pas encore compris. En ne mourant pas, Cross était disqualifié ».
Faudrait-il donc mourir assassiné pour s’inscrire dans l’histoire ? Tenace et pénétrant, Leblanc fera comprendre pourquoi, à 79 ans, Cross hait encore le FLQ. Cross pourrait pardonner ce que lui a subi, mais il ne peut pardonner la souffrance infligée à son épouse et à sa fille. Dostoïevski disait la même chose : le moujik pourchassé et mis en pièces par les molosses du seigneur ne pourra jamais pardonner à ceux qui ont imposé ce spectacle à la mémoire de son enfant. Leblanc, avec courage et talent, montre qu’aucune vie n’est secondaire.
L’histoire contondante
Surtout quand elle secoue les idéologies, l’histoire devient elle-même un acteur ou, entre les mains des acteurs, un instrument contondant.
Raymond Ouimet
L’AFFAIRE TISSOT
CAMPAGNE ANTISÉMITE EN OUTAOUAIS
Écrits des Hautes-Terres, Montpellier, 2006, 157 p. ; 20 $
L’antisémitisme, comme toutes les repousses du racisme, est un chancre contre lequel beaucoup utiliseraient la cautérisation. On souhaite donc le détecter le plus tôt possible. De là surgit le risque d’en pressentir la montée dès le bourgeonnement et de postuler d’avance la contamination de la société. L’enquête de Raymond Ouimet sur l’affaire Tissot n’évite pas complètement ce risque. Entre Tissot et la société outaouaise, il y a quand même une marge. Il est honteux et inadmissible qu’un torchon comme Le Patriote sévisse et salisse, mais toute la population était-elle atteinte de la peste ? « Freiman a raison d’avoir peur. Le Juif des années 1930 et 1940 est un être traqué auquel on s’attaque bien souvent impunément. » La preuve ne soutient pas ces généralisations. Ouimet glisse lui-même au procès d’intention : « Le fait que Tissot ait pu discourir à la Salle Notre-Dame, à Hull, donne à penser que les autorités oblates avaient un préjugé favorable envers l’homme et ses théories antisémites ». Autre raccourci : « […] le fascisme canadien-français est essentiellement fédéraliste ». Essentiellement n’est-il pas un peu fort ? Le sous-entendu règne en maître dans d’autres passages encore : « Comme les archives du Parti national n’ont jamais refait surface, on peut non seulement se demander si elles ont été détruites, mais si la GRC a cherché à protéger des personnages en vue ». La meilleure arme pour combattre le gluant antisémitisme serait-il de lui intenter des procès d’intention ?
(Sur une note moins sérieuse, Ouimet devrait retirer à Aurèle Joliat le statut de gardien de but qui appartenait plutôt à Georges Vézina… Le petit Joliat, lui, remplissait les buts…)
Pierre-Luc Bégin
MICHAEL IGNATIEFF
UN DANGER POUR LE QUÉBEC ?
Du Québécois, Québec, 2006, 157 p. ; 19,95 $
Ce pamphlet répondait à une inquiétude qui, depuis, s’est résorbée. Devant la possibilité que Michael Ignatieff s’empare du Parti libéral du Canada et devienne premier ministre, il était sain de sonder le passé du personnage. Que l’auteur réponde à sa propre question par un vibrant oui n’étonnera pas. D’une part, parce que Michael Ignatieff, à lire ses écrits, est aussi inquiétant pour le Québec que pour les droits fondamentaux ; d’autre part, parce que Michael Ignatieff semble professer des convictions à géométrie variable. Qu’il s’agisse de la guerre en Irak, de la nation québécoise ou de la torture.
Cela dit, le ton, qui aurait pu s’en tenir à la gouaille polémique, sert mal la cause de l’auteur. Les idées, dont Pierre-Luc Bégin sait faire bon usage, pèsent plus lourd (et salissent moins) que les coups bas. À quoi bon le constant recours au diminutif Iggy pour évoquer Ignatieff ? Comment, dans une discussion rationnelle, retenir contre Ignatieff non plus ses flottements personnels, mais les mœurs de ses ancêtres ?
Patrick Bourgeois
LE CANADA, UN ÉTAT COLONIAL !
Du Québécois, Québec, 2006, 239 p. ; 19,95 $
Patrick Bourgeois se réveille-t-il la nuit pour détester le journaliste André Pratte ? Je ne sais. De son propre aveu, des amis l’ont déjà invité à ne pas s’épuiser en détestation de l’éditorialiste. On acceptera quand même la justification de Bourgeois : face aux moyens dont use et abuse une presse québécoise monolithique, mieux vaut dénoncer les mensonges dès leur incubation. Or, selon Bourgeois, les textes de Pratte sont truffés de mensonges.
Bourgeois ne manque ni de souffle ni de carburant. Il appelle à sa rescousse des notions historiques indiscutables, rappelle les gestes posés par l’État central à l’encontre des intérêts québécois, vulgarise des arguments qui risquaient de ne jamais rejoindre les humbles mortels. Dans l’ensemble, les faits cités sont pertinents et percutants. Que Bourgeois les attache parfois de force à son char, cela fait partie de la nature même d’un pamphlet. On s’étonnera pourtant, parce que cela est fragile, qu’il fasse durer la Révolution tranquille de 1960 à 1980 et de l’assurance avec laquelle il fait naître à Londres « le pire colonialisme à avoir existé dans l’histoire de l’humanité ». Peut-être doit-on aussi imputer à l’inflation pamphlétaire l’envol suivant : « […] on se rend vite compte que l’économie québécoise est privée de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliards $ par année ». C’est beaucoup !
Deux bémols. L’ancêtre que je deviens n’aime pas les épithètes de nature physique. On peut accuser André Pratte de tromper son public, mais pas d’être moins grand que le géant Beaupré ou de préférer telle coupe de cheveux. Enfantillages. D’autre part, le nombre de formules boiteuses, de coquilles et de fautes devrait inciter l’éditeur qu’est aussi Bourgeois à faire relire sa copie.
Denis Monière
25 ANS DE SOUVERAINETÉ
HISTOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DU QUÉBEC
Du Québécois, Québec, 2006, 182 p. ; 24,95 $
Étrange et périlleux exercice que celui de réécrire l’histoire, surtout quand le quart de siècle remanié est bien connu du public. Alors que le Parti québécois se projetait dans l’avenir en publiant le budget de l’an I, le politologue Denis Monière s’attaque au granite indiscutable d’un passé dûment inscrit dans la mémoire commune. Il faut le faire ! Car Monière ne lésine pas : il inverse les résultats de 1980 et rend le Québec souverain.
Le plus étonnant, c’est que pareille pédagogie peut créer de beaux doutes. Voilà, en effet, que le Québec, ainsi émancipé par magie, se comporte en pays dit « normal ». Il s’exprime sur la scène internationale, assouplit les précautions linguistiques qui gênaient René Lévesque, modernise son mode de scrutin et garantit aux régions une part du pouvoir, etc. Tout cela, sans drame, parce qu’ainsi le veut la normalité. Monière se permet même de réconcilier les adversaires politiques. Dans un Québec souverain, Bourassa aurait proposé une nouvelle expansion hydroélectrique… Politique fiction, nous dit Monière. Certes, mais aussi pédagogie politique.
Précisions, hommages, images
Plusieurs bouquins récents raffinent l’histoire avec sérénité. Tantôt pour distinguer réel et imaginé, tantôt pour solliciter des utopies, tantôt pour laisser s’exprimer l’appareil photo.
Marcel Trudel
MYTHES ET RÉALITÉS DANS L’HISTOIRE DU QUÉBEC T. III
Hurtubise HMH, Montréal, 2006, 206 p. ; 24,95 $
La verve de ce magnifique nonagénaire ne s’épuise jamais. L’œil et la mémoire en éveil, la curiosité et la minutie en bandoulière, Marcel Trudel traite faits et gens selon leurs mérites. Le premier bilinguisme, il le situe à l’époque où les Amérindiens, se sachant indispensables, imposaient leurs langues aux arrivants. Avec le visiteur Kalm, il décrit le menu qu’offrait en son temps la table québécoise. On salait à son gré, mais le beurre apparaissait rarement sur la table. Cartes à l’appui, Trudel contredit Maria Chapdelaine : les choses changent au pays du Québec, en particulier les frontières. Neuf changements en 230 ans ! Quant à certains droits ancestraux des Mohawks, Trudel les nie en raison du fait qu’ils n’habitaient pas les lieux revendiqués. Une douzaine de bibelots.
Jean-Philippe Warren
MÉMOIRES D’UN AVENIR
DIX UTOPIES QUI ONT FORGÉ LE QUÉBEC
Nota bene, Québec, 2006, 143 p. ; 15,95 $
« Une fois brisé le miroir du passé, écrit Jean-Philippe Warren, la figure de l’homme ne pouvait plus s’y reconnaître. L’individu moderne serait donc désormais ce qu’il projetterait d’être. » D’où l’importance des utopies. D’où l’idée, logique autant qu’ingénieuse, de demander à dix personnalités d’aujourd’hui d’identifier dix « précurseurs en utopie ». Hélène Pelletier-Baillargeon redonne vie à Marie Gérin-Lajoie, Diane Lamoureux écoute Marcel Rioux, Jacques Beauchemin accompagne le puissant curé Labelle dans sa conquête d’un pays, Ramsay Cook revient sur le double projet de Frank Scott : « […] construire un nouveau Canada, résister à un Québec nationaliste »… La frontière s’abolit entre le passé et l’avenir.
Hélène-Andrée Bizier
UNE HISTOIRE DU QUÉBEC EN PHOTOS
Fides, Montréal, 2006, 320 p. ; 39,95 $
Un siècle se referme, un autre naît, les photographies durent. L’œil d’Hélène-Andrée Bizier capte, confirme, étoffe. Voici l’atterrissage de Lindberg sur les plaines d’Abraham. Voici de Gaulle non pas au balcon, mais au creux de la foule québécoise. Qui oserait nier, puisque la photo est là, qu’Aznavour fut au Québec la moitié du duo Roche et Aznavour ? Les choix d’Hélène-Andrée Bizier respirent la largeur de vue, cette culture qui évite les rejets ou les comparaisons dédaigneuses. Elle raconte cent ans, mais en jouant avec les frontières chronologiques : tantôt dix ans, tantôt quinze. Après tout, le siècle de Louis XIV s’est terminé à sa mort, en 1715.
Histoire de l’Histoire
Grâce aux historiens eux-mêmes, puisqu’ils ont le courage de se regarder en face, un bilan existe désormais des efforts québécois pour dire l’histoire.
Éric Bédard et Julien Goyette
PAROLE D’HISTORIENS
ANTHOLOGIE DES RÉFLEXIONS SUR L’HISTOIRE AU QUÉBEC
Presses de l’Université de Montréal, Montréal, 2006, 487 p. ; 34,95 $
Une balise est plantée. Solide et visible. Cette anthologie intègre une telle masse de réflexions que tout débat sur la santé de l’histoire au Québec devra en tenir compte. Les deux coordonnateurs ont ratissé large, sans jamais verser dans la caricature ou le bon-ententisme. Ils n’ont pas suivi telle mode qui aurait injustement écarté Rumilly ou Groulx ni telle autre qu’on accuse de gommer les aspérités québécoises. Cette hospitalité, belle forme de politesse intellectuelle, révèle un exemplaire souci de la vérité, tout en nous épargnant le style « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Toutes les thèses ont pu se faire valoir ; certaines, comme il se doit, sortent de l’exercice non pas discréditées, mais pressées de s’évaluer plus rigoureusement. La tendance quantitative, par exemple, qui a permis de troquer la manie des dates et des vedettes contre l’observation des tendances sociales et économiques de tout un peuple, se fait dire qu’elle n’est pas dispensée de la recherche du sens. « Il s’agit de découvrir, en somme, comment le Québec, parmi d’autres, a vécu son anormalité, ne serait-ce que pour mieux en sortir. » De quoi réconcilier (peut-être) ceux qui lissent les différences entre le Québec et le monde et ceux qui, au contraire, les mettent en exergue.
La confrérie des historiens a de quoi pavoiser. Non seulement elle mène ses recherches avec entrain, mais encore elle consent à mettre en lumière ses convergences et ses questionnements. Magnifique !



















