Il n’est pas facile d’aborder le conflit israélo-palestinien sans s’attirer immédiatement une foule de critiques. Qu’on se souvienne des polémiques soulevées par la diffusion à la télévision du film Route 181 ou du documentaire La porte du Soleil. Un homme comme Edgar Morin, ancien déporté, a été accusé d’antisémitisme et poursuivi en justice pour avoir publiquement critiqué la politique de colonisation menée par le gouvernement dirigé par Ariel Sharon.
Dans ces conditions, comment oser aborder le conflit dans les œuvres destinées à la jeunesse ? Quelques auteurs courageux et talentueux l’ont fait. Des éditeurs ont pris le risque de les publier. Mais on en propose rarement l’étude en milieu scolaire.
L’évacuation par l’armée israélienne des colonies implantées dans la bande de Gaza et la création d’un nouveau parti, Kalima, ont brisé des tabous. Les « faucons » les plus intransigeants ont fait un pas décisif en imposant à leurs partisans la position que la paix et la sécurité allaient de pair avec la création d’un État palestinien viable, position qui n’était jusqu’alors soutenue, et minoritairement, que par les pacifistes et les travaillistes. Mais, depuis Oslo et Camp David, les espoirs sans cesse déçus par des accords non appliqués ont suscité beaucoup d’amertume, puis l’assassinat d’un premier ministre qui acceptait de négocier la paix, la mort de celui qui avait su unilatéralement imposer un premier retrait des colonies. Les pacifistes sont mal à l’aise, les extrémistes s’en trouvent renforcés et le scepticisme a gagné l’ensemble de la population.
Comme l’écrit Véronique Massenot, auteure de Soliman le pacifique, « […] je veux croire à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Une vraie paix, juste pour tous, où chacun a sa place et respecte l’autre. C’est la seule issue. On le sait bien. Mais pourquoi faut-il tant de temps, tant de sang pour que les idées les plus sages progressent enfin ? » C’est à ce processus de paix que son livre voudrait modestement contribuer.
C’est aussi le sens de cette sélection d’une dizaine d’œuvres accessibles aux enfants du secondaire.
Les auteurs
Si notre choix s’est principalement porté sur des livres écrits en français, tous n’expriment pas des points de vue d’auteurs francophones. Certains sont traduits de l’hébreu (Riki, un enfant à Jérusalem, Samir et Jonathan, Les tagueurs de Jabalya), un autre de l’italien (Rêver la Palestine), un autre de l’américain (La colombe de Gaza). Dans leur échange de correspondance, Mervet et Galit écrivent chacune dans sa langue : Si tu veux être mon amie est ainsi traduit de l’arabe et de l’hébreu.
La voix des auteurs n’est pas neutre.
Du côté israélien, les histoires personnelles ne sont pas identiques. Yaël Hassan, d’origine polonaise, appartient « à la génération des enfants de rescapés » et de ce fait dit « avoir reçu la Shoah en héritage ». Bien que née à Paris, elle avait fait le choix d’aller fonder une famille en Israël où elle a vécu quatorze ans avant de revenir à Paris, se sentant « profondément juive culturellement mais aussi profondément française ». Les parents de Valérie Zénatti ont émigré en Israël alors qu’elle était déjà adolescente. Elle y a même été soldate, expérience qu’elle relate dans un livre. Ouzi Dekel, après avoir participé aux opérations militaires dans la bande de Gaza, est devenu l’un des fondateurs du mouvement « Yesh Gvoul », regroupant les soldats qui refusent de servir dans les « territoires ».
D’un autre côté, Nicole Vennat, qui a travaillé avec les enfants dans les camps palestiniens, exprime une certaine sympathie pour leur cause. C’est sans doute pourquoi l’éditeur a pris soin de faire ajouter à son album « une postface exprimant une sensibilité juive ».
Véronique Massenot, qui n’a jamais été en Israël ni en Palestine, a simplement réagi à un fait d’actualité qui la touchait, réalisant l’un des plus beaux livres sur le sujet. Elle s’explique : « N’est-ce pas le propre de l’écrivain que de se projeter dans le vécu de l’Autre, de l’explorer en profondeur et, par l’écriture, de faire partager cette exploration au lecteur ? Je revendique, ajoute-t-elle, le droit de parler de tout et envisage mon travail comme celui d’un ‘reporter en chambre’ envoyé sur le terrain de sa propre humanité confrontée à celle des autres, tous les autres ».
Alors qu’il était « à peine sorti d’une phase admirative très dans l’air du temps pour la geste israélienne », Jacques Vénuleth rencontre des exilés palestiniens au cours d’un séjour de plusieurs années au Maroc.
Robert Gaillot a simplement réagi à l’injustice. « Je ne supporte pas, dit-il, la loi du plus musclé, de celui qui a le plus de chars, l’assujettissement, le mensonge quotidien concernant ce conflit, l’abattage des oliveraies, la destruction des maisons, les camps de réfugiés. »
Briser le mur d’incompréhension
À l’exception de l’album de Robert Gaillot qui rappelle en quelques images, accompagnées d’un très bref texte bilingue (français-arabe), que la création de l’État d’Israël a entraîné l’exode forcé de Palestiniens, de Jacques Vénuleth dont le personnage emploie des termes forts comme « racisme institutionnalisé » et « apartheid », et de Randa Ghazy qui a fait un livre de dénonciation, chacun prend soin d’être extrêmement nuancé tout en exprimant une grande gêne à l’égard du sort réservé aux Palestiniens, principalement dans la bande de Gaza, lieu mentionné dans presque tous les ouvrages.
La construction d’un mur éventrant les paysages, emprisonnant les uns, enfermant les autres n’est pas qu’une réalité matérielle, c’est aussi une réalité psychologique, comme le montre bien le témoignage filmique de Simone Bitton (Le Mur, film documentaire, France/Israël, 1h 40). L’étude ou la lecture attentive de quelques-uns de ces livres pourrait sans doute contribuer à briser l’incompréhension mutuelle.
SAMIR ET JONATHAN
Daniella Carmi
Trad. de l’hébreu par Sylvie Cohen
Le Livre de Poche jeunesse, Paris, 2002, 220 p. ; 9,50 $
Prix Unesco de la littérature pour l’enfance et la jeunesse au service de la tolérance
Le narrateur de ce roman à la première personne, Samir, enfant palestinien, a fait une chute en dévalant les marches de l’escalier du marché à bicyclette. Il doit être opéré du genou dans un hôpital en Israël. Grâce à l’avocat chez qui elle travaille, sa mère a pu obtenir un laissez-passer qu’elle n’aurait pas eu même en faisant « le siège devant les bureaux des autorités militaires trois jours et trois nuits de suite ».La rotule est brisée. Samir doit demeurer à l’hôpital en attendant la venue d’un spécialiste de Chicago. Il partage donc quelques jours une chambre avec plusieurs enfants parmi lesquels Tsahi dont le frère est soldat. C’est la première fois que Samir voit un soldat de si près et sans casque. Il se demande si ce n’est pas lui qui a tué son frère Fadi. Il y a aussi Razia qui a été battue par son père un soir qu’il avait bu trop d’arak, Ludmilla qui lui semble une princesse et surtout le blond Jonathan, toujours plongé dans des livres sur les étoiles.Samir est étonné de la propreté et du calme de l’hôpital où il n’y a « pas de bruit, pas de coup de feu, ni de fumée » et où l’on peut prendre trois repas par jour. Enfin, un chirurgien venu de Chicago, qui ressemble aux docteurs des feuilletons que l’on voit à la télévision jordanienne le lundi soir, procède à l’opération.
Un soir, Jonathan, qui avait promis à Samir de l’emmener sur Mars, apporte un fauteuil roulant et entraîne son ami dans une salle où il y a un ordinateur avec un lecteur de CD-ROM. Deux enfants « qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau » apparaissent sur l’écran, un bleu et un vert. Ça n’a aucune importance, explique Jonathan, « ils sont faits de la même matière », comme tous les êtres vivants.Une fois sur Mars, les deux enfants s’efforcent de rendre la planète habitable en creusant des tranchées pour arroser le sable, en ajoutant des plantes pour l’oxygène et en faisant un écran de gaz pour éviter le rayonnement, en creusant un grand lac pour faire comme une mer… C’est évidemment un long passage métaphorique, réunion d’un enfant palestinien et d’un enfant israélien en train de bâtir « un nouveau monde », qui se termine par cette réflexion de Samir : « Rien n’est impossible du moment que nous sommes ensemble ».Le père de Samir, qui n’a pas pu lui rendre visite en raison du « bouclage des territoires », après avoir fait la queue trois jours durant devant les bureaux de l’administration des territoires avec une lettre de l’hôpital, peut enfin obtenir le laissez-passer pour venir chercher son fils.
Un livre généreux, écrit par une Israélienne vivant à Jérusalem, qui évoque bien la situation difficile des Palestiniens. Une histoire exemplaire, pleine d’espoir et de bons sentiments mais que les jeunes lecteurs trouveront peut-être un peu statique.
Me voilà, moi, Samir, un enfant des territoires, en train de pisser, en hurlant de rire et en me moquant royalement du monde, dans un bac à sable en compagnie d’un garçon juif dont le frère est soldat. Oui. Chaque jour, il me faudra un signe pour me rappeler que c’est vraiment arrivé et que je n’ai pas rêvé.
p. 207
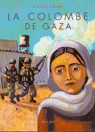 LA COLOMBE DE GAZA
LA COLOMBE DE GAZA
Cathryn Clinton
Trad. de l’américain par Jacqueline Odin
Milan, Toulouse, 2005, 240 p. ; 12,95 $
Ce roman à la première personne se présente comme le témoignage de Malaak, une jeune fille de onze ans qui vit dans la bande de Gaza.
Un jour, son père, parti travailler en Israël, n’est pas revenu. Une bombe du djihad a fait sauter le bus qu’empruntaient de nombreux Israéliens. Du toit de sa maison, elle attend son retour, se remémorant son dernier geste : le poing levé, le pouce en l’air pour signifier : « Je vais gagner ». Depuis, elle n’en parle presque plus et se confie surtout à son oiseau Abdo.
Malgré la mère qui ne cesse de répéter : « J’ai perdu mon mari. Je ne veux pas perdre mon fils », son frère Hamid est fortement tenté de se comporter en shabib, jeune militant et combattant des pierres, comme son copain Tariq.
Il est difficile de l’en dissuader alors qu’on garde précieusement dans la maison la photo de famille montrant les grands-parents « dans un jardin où poussent des jasmins et un olivier » avec l’inscription « Jérusalem 1946 ».
Si l’on supporte tant bien que mal le couvre-feu, les bouclages avec fermeture des écoles, les coupures d’eau, les maisons rasées pour l’exemple en représailles de l’assassinat d’un colon, le sentiment de vivre « en résidence surveillée », tout peut à tout moment basculer dans la violence.
Un enfant tué par les soldats israéliens, un autre abattu parce qu’il arborait un drapeau palestinien en tête du cortège et qu’on va enterrer « dans ses vêtements de martyr » et Hamid lance à son tour des pierres sur les soldats, prenant part à la première Intifada, ce qui va faire de lui un autre enfant « tombé à Gaza ».
Hamid écrivait des poèmes et l’un d’eux rythme le livre : « Petit oiseau, pourquoi ne voles-tu pas là-haut ? / Y a-t-il trop de barrières dressées ? / Trop de frontières à traverser ? »
Le livre, qui s’appuie sur un travail de recherche et des témoignages, résonne comme le diagnostic tragique d’une situation complètement bloquée entre 1988 et 1989. L’un de ses intérêts majeurs est de faire comprendre comment Hamid, l’enfant poète, bascule dans la violence malgré la promesse faite à sa mère et à sa sœur. Abdo, la colombe de Gaza, ne se serait-elle pas définitivement envolée ?
Le livre, accompagné de cartes et de repères chronologiques, bénéficie d’une couverture saisissante de Marcelino Truong.
LES TAGUEURS DE JABALYA
CHRONIQUES D’UN CAMP DE RÉFUGIÉS PALESTINIENS
Ouzi Dekel
Syros jeunesse, Paris, 2001, 92 p. ; 12,95 $
Cette courte fiction s’inspire de l’expérience de l’auteur qui, en tant que soldat israélien, s’est lui-même trouvé à l’intérieur du camp de réfugiés palestiniens de Jabalya, lieu hautement symbolique où s’était déclenchée la première Intifada en décembre 1987.
Dans un café de Tel-Aviv, en fin de journée, des amis lisent un article de journal évoquant une stèle élevée à la mémoire des enfants tués lors du massacre par l’artillerie israélienne de deux cents habitants du village de Qana au Sud Liban.
Le poème d’Ibn Al-Muqaffa, lu pour la circonstance, réveille en Youval les circonstances dans lesquelles il a connu l’œuvre de ce poète alors qu’il était soldat de première classe du bataillon d’artillerie 443 à Gaza.
Les murs de l’école, devant laquelle il devait monter la garde, étaient parfois tagués pendant la nuit. C’est ainsi que les habitants diffusaient les consignes ou les slogans politiques en divers lieux stratégiques. Alors la traque et les représailles s’organisaient. En pleine nuit, on obligeait les enfants à sortir des maisons et à taguer des slogans insultants pour les Arabes ou l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Le jour, on investissait l’école, où l’on travaille sans livre ni cahier, à la recherche de traces de peinture sur les mains des enfants. Si l’on croyait tenir un coupable, on procédait à l’arrestation nocturne : maison cernée, porte défoncée, hommes alignés, frappés à coups de crosse dans les côtes, le ventre ou la tête, destruction de la maison du coupable et expulsion de la famille vers un autre camp.
On comprend, dans ces conditions, qu’il soit difficile à Youval de gagner la confiance des enfants ou d’entrer en contact avec la représentante de l’Office des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) qui dispense la nourriture de base et l’aide médicale d’urgence. « J’avais l’impression, dit-il, qu’elle me rendait responsable de la situation, comme si j’étais le chef de l’armée. » Au moins complice. C’est ce qu’a dû se dire l’auteur. Après avoir été incarcéré dans une prison militaire pour avoir refusé de servir dans les territoires palestiniens occupés, il est devenu l’un des fondateurs du mouvement Yesh Gvoul, regroupant les soldats dans son cas, puis il a choisi de venir vivre à Paris.
 SI TU VEUX ÊTRE MON AMIE
SI TU VEUX ÊTRE MON AMIE
Galit Fink et Mervet Akram Sha’ban
Trad. de l’arabe et de l’hébreu par Ariane Elbaz et Béatrice Khadig
Folio junior, Paris, 2002, 209 p. ; 11,50 $
Il s’agit d’un témoignage. Une réalisatrice de films documentaires, Litsa Boudalika, a mis en relations Mervet, Palestinienne de 13 ans vivant dans un camp, et Galit, Israélienne de 12 ans qui vit à Jérusalem. Leur correspondance est entrecoupée de brefs rappels de l’actualité : attentats, orangeraies et maisons rasées par des bulldozers, bouclages, emprisonnements, expulsions, « badge blanc » imposé aux « travailleurs étrangers » dans certaines colonies…
Les deux jeunes filles expriment d’abord leur surprise : « Tu te rends compte, nous sommes à un quart d’heure de distance et c’est comme si nous étions sur deux planètes éloignées ». Mais, malgré une rencontre organisée à Jérusalem par deux oncles pacifistes, avec le temps, la guerre du Golfe, les échecs successifs des négociations de paix, les accords non appliqués, les relations se distendent. Si Galit, devenue adulte, est bien consciente que la paix ne s’obtiendra qu’au prix de la restitution des territoires occupés, c’est à la condition, précise-t-elle, « qu’ils n’arrivent pas à nos belles frontières ».
L’espoir demeure plus solide chez les oncles. Ainsi, l’Israélien Shlomo confie : « Personnellement je me sens beaucoup plus proche d’un Palestinien qui veut la paix que d’un Israélien qui ne veut pas la paix ».
L’intérêt majeur, outre l’authenticité du témoignage, réside dans la variété des points de vue.
Un riche dossier historique tente de retracer les origines bibliques des deux peuples revendiquant la même terre, l’histoire du mouvement sioniste, la responsabilité de l’Angleterre dans l’administration de la Palestine après le départ des Turcs, le rôle de la Société des Nations (SDN) puis de l’Office des Nations unies (ONU) et les différentes tentatives pour aboutir à un accord viable.
Maintenant, comme toi, je connais la guerre et je me rends compte que ce n’est ni juste ni agréable de vivre comme tu vis. D’un côté, je comprends, mais de l’autre je me dis que c’est vous qui êtes responsables. Chaque fois qu’il y a le couvre-feu, ça veut dire qu’il y a eu un meurtre. C’est donc normal que vous soyez sous contrôle, pour éviter les troubles et les rassemblements.
[…] Tu es peut-être sympathique mais tu es quand même arabe. À cause de ça, je ne pense pas qu’on sera amies un jour.
p. 111
À partir de 11 ans
MOMO PALESTINE
Robert Gaillot
Trad. en arabe par Kheïra et Chérif Boudelal
Grandir, Nîmes, 2002, 20 p.
Cet album illustré bilingue arabe-français raconte en quelques phrases soulignant des images aux couleurs vives, presque agressives, l’histoire d’un enfant. Chassé de sa terre par des tanks qui ont tout écrabouillé et des bulldozers qui ont tout aplati, puis par les colons qui se sont installés à l’emplacement de son village qu’il avait voulu revoir, Momo ramasse des pierres qu’il lance sur les soldats. Ceux-ci ripostent avec leurs fusils et Momo meurt sur la barricade. Froideur du ton complètement dépouillé, qui coïncide avec la banalité de la situation. Pas de commentaires mais le livre, loin d’être neutre, exprime une grande colère.
RÊVER LA PALESTINE
Randan Ghazy
Trad. de l’italien par Anna Buresi
Flammarion, Paris, 2002, 211 p.
Comment les Palestiniens vivent-ils ? Quelles humiliations et quelles violences subissent-ils quotidiennement ? Que se passe-t-il dans leurs têtes quand les soldats israéliens investissent un village, entrent avec leurs chaussures dans les mosquées, tuent femmes et enfants, barrent les routes et laissent mourir dans une ambulance une femme enceinte et son enfant ? Certains prennent des pierres pour lapider des soldats, d’autres se font kamikazes. Dans un tel contexte, l’amour entre Ramy et la jeune Israélienne Sarah est évidemment impossible. L’auteur met surtout en valeur l’état d’esprit d’un autre personnage, Ibrahim, fils de muezzin, étudiant en droit, dans de nombreux dialogues avec son entourage.
Un livre de dénonciation qui voudrait réagir à la vision unilatérale donnée par les médias. Ainsi, à propos de la lapidation de deux soldats : « Deux des quatre soldats moururent, ils furent sauvagement lapidés, comme le dit Rabin et comme l’écrivirent les quotidiens, mais chose étrange au contraire on n’écrivit pas sur le garçon tué et sur la mère tuée »
Un livre qui accorde une trop large place à des dialogues dont les locuteurs ne sont pas toujours facilement identifiables, écrit dans une prose qui se veut poétique, étrangement disposée et parfois non ponctuée, ce qui en rend l’accès difficile.
Pour les lecteurs persévérants uniquement.
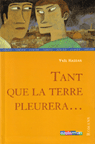 TANT QUE LA TERRE PLEURERA…
TANT QUE LA TERRE PLEURERA…
Yaël Hassan
Casterman, Paris, 2004, 134 p. ; 13,95 $
Un enfant se fait agresser sur un terrain de jeu par un groupe en cagoules. Un simple fait divers. Mais l’enfant, Samy, est juif. Il ne peut plus supporter de vivre dans un pays où « on ne parle jamais en bien d’Israël ». C’est là-bas qu’il désire aller vivre malgré l’opposition de ses parents. Son point de vue un peu « parano » est nuancé par celui de son ami Kamal, qui est d’origine arabe, et par Enave, jeune femme israélienne rencontrée dans l’avion.
Samy découvre en Israël l’omniprésence de l’armée, les camps de réfugiés, les check-points où sont parfois bloquées les ambulances, le bouclage, les maisons palestiniennes détruites en représailles contre les familles des terroristes. Finalement, il réalise que ce qu’il appréciait en France, c’était l’impression de sécurité.
En parallèle, l’auteur nous raconte l’histoire d’une jeune Palestinienne, Intissar. Son père travaille en Israël et défend des idées pacifistes. Mais, à cause de la répression, il est accusé de collaboration et reçoit des menaces des membres de la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa. Des graffitis couvrent le mur de sa maison. Sa porte est bloquée. Il est contraint d’abandonner son emploi. Pour « laver l’honneur de la famille », Intissar, la studieuse, la sage, choisit de devenir shahida, c’est-à-dire kamikaze. Le récit de ce basculement est certainement la partie la plus intéressante du livre parce qu’elle touche au destin du personnage sans faire intervenir des considérations morales.
Un livre accessible, composé de chapitres courts, extrêmement mesuré, qui, par souci d’équilibre, fait alterner plusieurs points de vue : Samy, l’enfant juif, son ami Kamal, un jeune beur, Enave, la jeune Israélienne, Intissar, la Palestinienne.
Un dossier d’une dizaine de pages expose ce qu’est le sionisme, évoque les conditions de la création de l’État d’Israël et ses conséquences, recense les différents accords qui ont tenté d’imposer un statut viable pour les deux peuples.
Les Palestiniens revendiquent le droit de vivre et d’avoir un État sur des terres qu’ils appellent la Palestine et nous, les Israéliens, voulons exactement la même chose au même endroit, sauf que nous appelons ce pays Israël.
p. 28
SOLIMAN LE PACIFIQUE
JOURNAL D’UN ENFANT DANS L’INTIFADA
Véronique Massenot
Le Livre de Poche jeunesse, Paris, 2003, 157 p. ; 8,95 $
Véronique Massenot a imaginé le journal de Soliman, enfant de Cisjordanie au moment de la seconde Intifada.Que faire du cahier à spirale « poussiéreux et tout gondolé » retrouvé dans les affaires de son frère, tué par l’armée israélienne ? S’en servir pour poursuivre leur dialogue.C’est ce qu’il fait en lui confiant pendant un peu plus d’un an sa vie quotidienne.
Le personnage est crédible. Il a une famille attachante, des amis avec lesquels il joue ou discute, des préoccupations de son âge, il est amoureux de Nabila, fréquente l’école où il a des problèmes avec certains professeurs et se pose des questions essentielles sur la vie.
Le livre s’ouvre par l’évocation du souvenir qui lui fait le plus mal : l’enterrement de ce frère qu’on dit « mort en martyr » alors qu’il a simplement été fauché par une rafale de mitraillette qu’un soldat affolé tirait au hasard.
Il évoque l’entreprise complexe que représente le voyage jusqu’à Jérusalem avec son ami Samy. Là-bas, il reconnaît la maison rose de Yaya, sa grand-mère, celle où est né son père avec « la fenêtre ovale au-dessus de la porte » et « le balcon aux barreaux torsadés imitant le volubilis » et dans laquelle sa famille a vécu jusqu’à la Nakbar, la catastrophe, l’exode forcé d’un million de Palestiniens vers les pays voisins en 1948. Une autre famille y vit, dont une fillette qui lui sourit.
Beaucoup de ses amis sont dans la même situation. Les familles ont été chassées de leur maison, de leur ferme, de leurs orangeraies ou de leurs champs d’oliviers rasés par les bulldozers.
Pourtant, à la différence de la famille de son ami Samy qui ne cesse de parler du passé, de vivre dans le passé, chez Soliman, on a appris à vivre au présent.
La vie quotidienne en Cisjordanie est à l’image de ce que l’actualité parvient parfois à nous faire entrevoir : bombardements, maisons détruites, jardins ravagés, secours improvisés, déblaiement des ruines à la brouette, récupération de quelques objets parmi les morts et les gravats, bouclage qui empêche les gens d’aller travailler, écoles fermées, enfants qui restent prostrés à cause d’une crise d’angoisse, infirmière qui ne peut plus aller travailler à l’hôpital de Tel-Aviv parce qu’elle est palestinienne, l’humiliation permanente. « Quel record doit-on battre ? se demande l’enfant au cours du troisième mois de blocus. Pour quel concours absurde ? Le ‘grand prix mondial du blocus’ ? Et pour quelle récompense ? » De son côté, Soliman s’interroge sur l’utilité de l’Intifada ou sur l’attentat-suicide dans une discothèque en Israël.
Le figure emblématique de ce peuple sans avenir, c’est sans doute son copain Samy que Soliman retrouve à l’hôpital « des bandages autour des genoux – et plus rien dessous. Plus de pieds pour tenir debout. Plus de jambes pour se sauver ». « Nous sommes tous amputés ! s’écrie Soliman. De nos droits, de nos rêves ! » Comme Yaya, sa grand-mère, il pense que ce qui sépare les Juifs et les Palestiniens aujourd’hui, ce ne sont ni les religions, ni les coutumes, ni même la question de la terre « mais tous ces morts, tous ces chagrins inconsolables ». Aussi, écoutant les conseils du vieux professeur Rouslan : « Pour faire la paix, il faut essayer de comprendre l’autre. Il faut donc l’écouter et cesser de crier », Soliman va chercher le contact avec les pacifistes israéliens et, pour mieux comprendre et fraterniser, il va commencer à étudier l’hébreu.
Le journal de Soliman fait l’inévitable allusion au Journal d’Anne Frank, témoin comme lui d’un peuple martyr, que le vieux professeur lui a donné à lire.
Une brève présentation rappelle le contexte historique et les conditions de la création de l’État d’Israël en 1948 puis la difficile recherche d’un processus de paix viable depuis 1993, que, d’une part, les extrémistes des deux camps se sont ingéniés à faire échouer et que compromet, d’autre part, l’occupation, jugée illégale par l’ONU, d’une partie de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est.
« Pourquoi notre histoire n’émeut-elle personne ? » se demandait Soliman. Véronique Massenot nous aide à entendre sa parole. Comme le titre l’indique, c’est un livre pour la paix qu’il faudrait diffuser largement.
Tous, nous haïssons les colons parce qu’ils nous volent nos terres, nos eaux, notre liberté d’aller et venir. Mais moi, ce qui me trouble, c’est l’idée qu’on puisse être volontaire pour vivre ainsi, dans cette sorte de prison… même dorée !
p. 32
 RIKI, UN ENFANT À JÉRUSALEM
RIKI, UN ENFANT À JÉRUSALEM
David Shahar
Trad. de l’hébreu par Madeleine Neige
Folio junior, Paris, 2003, 186 p. ; 10,95 $
Cet ouvrage écrit à la première personne se présente comme la transcription d’un témoignage authentique recueilli par l’auteur une quinzaine d’années auparavant. Il nous ramène aux débuts du conflit israélo-palestinien en 1947.
Au climat d’inquiétude de la population juive de Jérusalem qui appréhende le départ des soldats anglais, succède bientôt la vie difficile dans la ville assiégée par les Arabes, le manque d’eau, les obus, les bombardements. Mais c’est une population fortement mobilisée, sûre de ses droits sur cette terre et du caractère sacré de sa cause. « Si nous faisons ce qui est bien et droit aux yeux de Dieu et si nous sommes dignes de lui, nous obtiendrons la victoire », dit la grand-mère de Riki. Les jeunes comme Benni, frère de Riki, appartiennent au mouvement de jeunesse Irgoun où « l’on apprend à se servir d’un fusil, d’un revolver, à jeter des grenades, en fait à être soldat ».
Au cours d’une fugue, l’aventureux Riki découvre la vie d’un kibboutz où tout le monde s’appelle « camarade » et porte, comme son oncle, des vêtements de travail kaki. Avec lui, on assiste aussi à la réception de réfugiés clandestins, à l’acheminement d’un convoi pour défendre Jérusalem assiégée.
Un point de vue unilatéralement israélien avec un regard amusé sur la foi sans faille de la grand-mère et l’intransigeance idéologique de l’oncle qui ne cesse de tout voir comme « un malheur national ».
À partir de dix ans
LES CAILLOUX DU CHEMIN
OU « L’INTIFADA, AU JOUR LA NUIT »
Nicole Vennat
Syros-Alternatives, Paris, 1992, 45 p. ; 29,95 $
Ce texte, accompagné d’aquarelles de l’auteure et de broderies de femmes palestiniennes, s’efforce d’évoquer « le cadre et la trame de cette vie d’exil intérieur et extérieur des Palestiniens » et se présente comme « une succession d’histoires vraies ». On y retrouve ce qui fait le quotidien des Palestiniens en territoires occupés : écoles fermées, pierres lancées contre les voitures, enfants arrêtés, blessés, les tracts laissés la nuit « là où chacun passera demain », les détentions administratives sans jugement, les morts en prison… et les tentatives de résistance comme les cours de secourisme pour pouvoir donner les premiers soins aux blessés ou l’école clandestine magnifiquement évoquée. « Il y a pour toi une école bien cachée, déguisée en maison de tous les jours. Pour y aller, tu te promèneras sans cartable, ni signe extérieur de scolarité. Chaque jour, un professeur est désigné par les clandestins. »
L’auteure tente malgré tout de dégager quelques lueurs d’espoir. « Les livres d’histoire de demain parleront, sans haine, des expulsions et des occupations d’aujourd’hui.[…] Les enfants de Palestine et d’Israël liront-ils un jour ensemble le mot fraternité ? »
Une postface du professeur Paul Kessler tente de désamorcer les risques de protestations contre ce livre beau et généreux en précisant : « Si l’auteur manifeste une évidente et chaleureuse sympathie vis-à-vis des Palestiniens, il faut constater que son œuvre ne reflète aucune animosité envers le peuple israélien » et il rappelle l’existence, en Israël, de mouvements pacifistes « minoritaires mais actifs, déterminés et courageux ».
LES PIERRES DU SILENCE
Jacques Vénuleth
Le Livre de Poche jeunesse, Paris, 1995, 188 p. ; 8,95 $
Publié en 1995, l’ouvrage est un des premiers à aborder le problème palestinien, sur un ton qui ne présente ni les nuances ni la modération prudente des autres.
L’auteur a mis en exergue une courte citation de l’Ecclésiaste, reprise de manière plus développée par Yaël Hassan, disant qu’il y a « un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres ».
Il s’agit du journal, sans indication de jour, ce qui assure la continuité du récit, d’une jeune Arabe israélienne de quinze ans nommée Myasa, internée dans ce qu’elle appelle « un hôpital de fous » après s’être murée dans le silence à la suite d’un traumatisme qu’elle tente progressivement de dévoiler. La démarche est difficile. « Écrire n’a rien réglé, constate-t-elle dans un premier temps. Au contraire. J’ai cru pouvoir tricher. Me libérer à peu de frais, en douce, des mots encombrants. Les mots les plus encombrants ne sont jamais venus. » Jusqu’au jour où enfin, devant sa glace, elle pousse les mots-clés de son histoire : « Myasa ! Maison ! Soldats ! »
Au fil des pages, elle raconte des fragments de son histoire, comment, à cause de son grand-père qui n’avait pas obéi à l’ordre d’évacuer son village annexé, sa famille est devenue israélienne. Suivant les déplacements de son père, elle a pu faire ensuite une partie de ses études à Lausanne où, n’osant dire qui elle était, « appartenant à un pays qui n’existe pas », elle a tenté de se forger une identité en se faisant passer pour une Grecque. Elle parle des villages palestiniens comme Cheikh Munis, où vivait son grand-père, qui non seulement a été évacué, mais dont les maisons ont été rasées, à l’emplacement duquel les Israéliens ont créé un site archéologique, avec des ruines romaines importées, pour bien montrer qu’il n’a jamais existé. Peuple sans terre, dont on nie non seulement l’existence mais le passé.
Certaines scènes expriment une extrême tension, comme le passage où Myasa, sous la menace d’une fourchette, oblige Sarah, l’infirmière israélienne, à écouter son histoire, épisode qu’on transforme aussitôt en « prise d’otage ».
Une autre voix vient résonner, non pas en contrepoint comme dans les autres livres, mais comme une ponctuation forte des propos de Myasa, celle du « médecin aux yeux verts », le psychiatre qui s’occupe d’elle. Ni Israélien, ni Juif, il a « choisi de travailler un temps dans cet État par sympathie, par conviction » mais il doit avouer que le rêve s’est changé en cauchemar. Il emploie à l’égard de ce qu’il voit des mots très forts comme « racisme institutionnalisé » et « apartheid ». Désenchanté, il profite de son congé pour quitter définitivement le pays en emportant le journal de Myasa qu’il compare à une bombe, « pas une bombe terroriste. Une bombe pour ouvrir les yeux et ajouter de la vie ».
Un livre fort, révolté, sans concession, sans doute dérangeant, qui a cependant obtenu en 1994 le prix du Roman Jeunesse du Ministère de la Jeunesse et des Sports sur manuscrit anonyme.
Tout ce qui nous reste pour garder notre dignité, c’est de lancer des pierres. L’âge des pierres. L’âge de pierre. Ils sont arrivés à nous ramener à l’âge de pierre.
p. 75
 QUAND J’ÉTAIS SOLDATE
QUAND J’ÉTAIS SOLDATE
Valérie Zenatti
L’École des Loisirs, Paris, 2002, 262 p.
Derrière ce titre un peu ingrat, se cache un témoignage autobiographique empreint d’un certain humour.
C’est avec une certaine distanciation, due au fait qu’elle ne soit arrivée en Israël qu’à l’âge de treize ans, que Valérie Zenatti évoque l’obligation de faire son service militaire, comme les autres filles.
Dès le début du livre, elle énonce avec un rien d’impertinence, les réponses à savoir par cœur pour l’épreuve d’histoire de la Shoah, obligatoire pour le baccalauréat en Israël. Si son statut de soldate ravit sa famille plus qu’elle-même, « Valerix légionnaire » évoque un monde où « il semble que les mots ‘utile’ et ‘logique’ n’aient pas de réalité tangible ». Le ton devient parfois grave, par exemple lorsqu’elle évoque la fascination que finit par procurer le maniement des armes. « Pourquoi le cacher ? Mon pistolet mitrailleur me fascine. C’est un instrument de mort que nous manipulons avec de plus en plus d’aisance. Sans imaginer une seconde que nous pourrions nous en servir un jour. »
Les soldates ne combattent pas dans les territoires et ne vont pas au combat. Valérie est donc affectée aux services de renseignements et participe à une mission d’espionnage aérien. Ce n’est donc qu’au cours de déplacements en car ou de conversations entre amis que sont évoqués le problème palestinien et les contradictions d’Israël. « Il y a des gens trop riches et d’autres honteusement pauvres. Des ombres noires qui se balancent en priant Dieu et des silhouettes en minijupe qui dansent en croyant au plaisir de l’instant présent. Des militants qui veulent la paix maintenant et qui savent que, pour cela, il faudra donner aux Palestiniens le droit de vivre comme ils l’entendent. Et d’autres qui proclament leur attachement à la Terre de la Bible, qui se bouchent les oreilles et masquent les yeux pour ne pas savoir que trois millions de Palestiniens vivent – mal – à Gaza, dans les collines de Judée et de Samarie. » C’est pourquoi, parfois, avec son ami Gali, elle se mêle le vendredi soir à la manifestation des femmes en noir pour la paix.
 UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE GAZA
UNE BOUTEILLE DANS LA MER DE GAZA
Valérie Zenatti
L’École des Loisirs, Paris, 2005, 167 p. ; 17,95 $
Le livre s’ouvre par l’évocation de l’attentat au café Hillel à Jérusalem. « On a ramassé six corps. Ça s’appelle un attentat moyen », commente la jeune narratrice Tal Levine, surtout marquée par la mort d’une jeune fille de vingt ans, à la veille de son mariage.
Tal, dont les parents croient encore qu’il peut y avoir entre Israéliens et Palestiniens « autre chose que des corps déchiquetés, du sang et de la haine », est née précisément le 4 novembre 1995, jour de l’assassinat du Premier Ministre Rabin, artisan de la paix.
Pour ne pas effrayer les autres avec ce qu’elle a en tête, elle décide de l’écrire, comme Anne Frank, puis de le partager avec quelqu’un « de l’autre côté ». Elle enferme son message dans une bouteille de champagne, celle que ses parents avaient débouchée le 13 septembre 1993, au moment des accords de Camp David, et la confie à son frère, militaire, pour qu’il la jette dans la mer de Gaza. Celui-ci se contente de l’enterrer dans le sable.
Ce n’est pas une jeune fille de son âge qui trouve la bouteille mais un jeune homme. Alors commence entre « Barbouk » (Tal) et « Gazaman » (l’inconnu) une série d’échanges de messages par Internet. Leur dialogue exemplaire pourrait-il être prémonitoire ? « Je veux continuer à croire que, si lui et moi parvenons à nous ‘parler’ vraiment, se dit Tal, ce sera la preuve que nous ne sommes pas deux peuples condamnés à perpétuité à la haine sans remise de peine possible. »
Les premiers échanges sont empreints de méfiance. « Qui se trouve en face réellement ? C’est si facile, si trompeur, le mail. […] On peut s’inventer des identités, mentir, discuter avec des gens qui mentent peut-être eux-mêmes ? » Mais la confiance s’instaure et chacun évoque sa lassitude, ses difficultés quotidiennes, ses espoirs de paix, ses troubles psychologiques causés par l’insécurité réciproque et l’insupportable réalité quotidienne. Ils finissent par s’inquiéter l’un pour l’autre, si l’armée israélienne entreprend une opération dans la bande de Gaza ou si un attentat se produit à Jérusalem. Ils posent des questions fondamentales : « Nos deux peuples n’ont jamais été d’accord sur les mots. Vous dites ‘Israël’, on dit la ‘Palestine’ […].Vous dites un ‘terroriste’, on dit un ‘martyr’ […]. On devrait créer un dictionnaire binational ».
Un beau livre écrit par une auteure qui a vécu de l’intérieur les situations évoquées, un témoignage parfois déchirant, plein de tendresse et d’optimisme.
.










