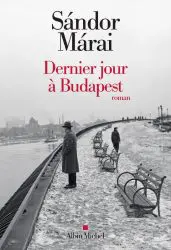Un vieil écrivain, dit Sindbad le marin, parcourt Budapest, la ville qu’il a aimée, pour une ultime promenade en calèche avant de regagner son logis et, apaisé, y mourir. L’argument est mince mais son traitement d’une extrême richesse et d’un rayonnement qui se prolonge.
Car il s’agit de bien plus que de l’évocation nostalgique de cette capitale : le prétexte pour Sándor Márai de reprendre ses thèmes favoris, une réflexion sur la mémoire, le temps, les rapports humains, les valeurs selon lesquelles la vie devrait s’ordonner, et l’écriture.
Sindbad est en réalité l’écrivain Gyula Krúdy, qui fut célèbre puis oublié dans son pays et admiré de Márai qui l’accompagne dans sa promenade imaginaire sous le nom du « conteur » Artur. Réapparaît ainsi par lui une « ancienne Hongrie », elle aussi disparue quand, en 1940, Márai écrit son récit.
Les lecteurs francophones peu au fait de l’histoire de l’Europe centrale pourront être gênés au premier abord par la multiplication de noms imprononçables de lieux et de personnes, aussi d’allusions historiques mais un lexique vient à leur secours et la traduction fait vite oublier cet obstacle.
Livre du souvenir au premier chef. Y paraissent puis s’effacent de pittoresques personnages dont Artur, capable de dormir partout « et avec entrain » sauf dans son lit. Des maîtres d’hôtel dans les restaurants et cafés jadis hauts lieux de l’intelligentsia hongroise et « îlots de paix », visiteurs des bains publics très populaires, des commerçants, des petites gens, tous avec leur dignité, leurs travers et manies, constituant un peuple singulier, mélancolique et fier, venu il y a longtemps d’Asie, toujours menacé dans un pays aux contours flous par les voisins, Turcs, Tatares, Allemands – l’actuelle politique visant les migrants serait-elle un écho et une conséquence de cette insécurité historique ?
L’éloge de la bonne chère, de la soupe, du rôti et du vin occupe beaucoup de place dans ce récit qui prend parfois les allures d’un pèlerinage gastronomique pour le vieil écrivain qui en tire tant de plaisir. Les rives du Danube dans une matinée du mois de mai, chaque rue de la vieille ville font naître des souvenirs émus et c’est toute sa vie qui se présente en raccourci. Surtout par les sensations que Márai fait surgir avec une subtilité et une intensité qui, irrésistiblement, rappellent Proust dont il était un admirateur, comme le fut la culture française très présente dans l’ancienne Hongrie. Une inscription publicitaire, le bruit de talons sur un trottoir, l’odeur dans une chambre d’hôtel, des senteurs de cuisine composent une étonnante mosaïque dans la description où le vocabulaire est raffiné à la mesure de son objet. Cela évolue lentement ou en accéléré, sensuel, langoureux ou débridé comme une czardas…
Passé et présent se confondent dans l’évocation comme se confondent progressivement l’auteur et son personnage principal. L’ironie sensible dès le début, la drôlerie frôlant le comique et la satire tendre cèdent à des notations plus graves. Images du vieillissement dans les bains publics, habitudes un peu émouvantes de Sindbad et, surtout, lancinante, la question : « Où étaient-ils, les chasseurs de chimères et les ombres, ces vagabonds fantomatiques de l’ombre hongroise, ces rebouteux secrets de l’esprit, enfants et héros, solitaires et Tsiganes, bavards et silencieux comme la mort, si tristes ? » Ces écrivains que nous ne connaissons pas ou que nous connaissons mal, mais dont les portraits imposent la présence vivante, furent à la fois des serviteurs de la Hongrie et de la beauté.
Le récit glissant d’une tonalité à une autre, amusé et d’une mélancolie déjà dans le titre, sentimental et vif, lyrique, coloré et méditatif, est traversé d’une haute idée de la création littéraire. De page en page il est relancé par la répétition de « j’écris parce que… », il devient ainsi un art poétique et une profession de foi en la puissance et en la nécessité de l’écriture : « […]parfois il entendait une sorte de voix qui ressemblait à celle d’un alto solitaire, oublié dans un coin, qui résonne soudain dans une pièce vide […]son affaire était de se souvenir, d’entendre des voix, de contempler le feu qui brasille au fond du cœur des hommes et de se consumer lui-même à cette flamme qui brûle sous la conscience ».
Le roman recompose en une perspective unanimiste l’histoire et la substance d’un pays qui n’existe plus vraiment que dans les mémoires. Plus, il donne une leçon de vie fondée sur une appréhension sensorielle de la réalité. Alors que notre état naturel est la distraction à ce qui nous entoure et la pauvreté de notre présence en lui, Márai nous dit la jouissance et l’accroissement de vie que nous apportent les sens en éveil : regarder, sentir, s’imprégner du monde concret.
Le conteur, alias Artur, se définit comme un nomade du cœur qui écrit pour « résoudre le mystère de ces âmes fières qui sont ses contemporains, « l’odeur du bonheur » mais « aujourd’hui il n’y en a plus ».
Márai – en parallèle avec tant de romans magistraux – livre ici des images des « temps héroïques », sa patrie de l’entre-deux-guerres, l’amour qu’il lui porte, prélude au déchirement qu’il décrira dans Mémoires de Hongrie ou Libération et Ce que j’ai voulu taire alors que l’invasion nazie puis l’occupation de l’Armée rouge le pousseront à l’exil. Dernier jour à Budapest fait pendant au Monde d’hier de Zweig, non pas avec l’ambition de décrire l’écroulement d’une civilisation qui a fleuri particulièrement en Europe centrale, mais en laissant remonter en une conscience, celle de Márai identifié à l’écrivain admiré, « les eaux profondes de la mémoire ».