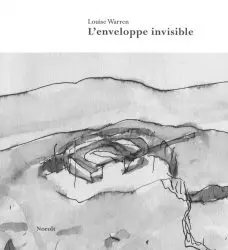En exergue à ce très beau recueil d’essais, l’auteure choisit les mots d’Anne Hébert comme invitation à capter l’invisible, à le contempler.
Avec ce nouveau titre, Louise Warren convie le lecteur en marche à travers un territoire où elle se terre, d’où elle observe. Retirée en ce lieu de création comme en celui des mutations, elle traque le silence. C’est à l’abbaye Val Notre-Dame qu’elle retrouve la chambre d’écriture, se couvre de solitude pour plonger à la source des poèmes.
J’ai lu ces essais comme les carnets de création du précédent livre de la poète, Le plus petit espace. Les thèmes de l’effacement et de la simplicité s’y retrouvent et s’y font écho. Louise Warren creuse, interroge l’espace où le poème prend forme, tisse un lien de continuité, de son tout premier livre au dernier. Elle trace sa géographie, dessine les contours de sa propre enveloppe.
La forme fragmentée mène la réflexion. Plusieurs entrées sont très brèves, observations du monde, de la vie du monastère, qui se fondent à la vie intérieure de la poète, à la pulsation de la nature aussi. Elles forment parfois un mouvement circulaire, d’autres fois un va-et-vient d’où émergent vie et poésie. L’auteure laisse la place à son imagination, à ses souvenirs, pour aller un peu plus loin dans le sens et l’évocation. Parfois, c’est le père qui surgit, d’autres fois, la ville, la force de l’hiver. L’image du lac Baïkal, avec ses eaux lustrales et profondes, est le motif qui revient le plus souvent dans le livre, chaque fois comme un espace clair et sacré, la possibilité d’une descente intérieure encore plus intense.
La poète se pose dans une chambre de solitude, elle choisit le silence pour entendre le monde, pour s’entendre elle-même. C’est dans cet espace que s’amorce un dialogue intérieur riche. Et la chambre devient lac, miroir, reflet et fenêtre ouverte. Les rencontres marquent le processus d’écriture. La poète croise Anne Hébert entre les pages d’un livre, l’architecte Pierre Thibault, les moines qui habitent l’abbaye. Ces rencontres résonnent de manière particulière chez Warren, qui évoque aussi la mort, ses morts et leur survivance. Elle écrit que sous sa peau, sous ses vêtements se forme une membrane, une enveloppe invisible et que c’est ce qui nous survit, ce dont les autres se souviennent. Que les morts ne sont pas parmi nous, mais en nous, et qu’ils meurent quand nous partons. L’enveloppe invisible, c’est aussi ça : nos actions, nos passions, ce qu’on fabrique de notre temps, de notre vie, ce qui nous anime, nous brise, nous déchire, mais qui est essentiellement nous, invisible et vrai.
Si le livre fait la place belle à l’architecture, il m’a semblé par moments que celle de l’ouvrage était un peu erratique, comme si les fragments suivaient essentiellement le mouvement de la pensée, de l’intériorité de la poète, sans autre structure que le temps qui passe et qu’elle observe. Toutefois, la réflexion est profonde, foisonnante. Très peu de répétitions ici, mais un tracé de la conscience créatrice dessiné un point à la fois. Et entre les pages, Louise Warren est généreuse. À travers montagnes, arbres, ombres, lumière, lac et glace, c’est un peu comme si on était juste au-dessus de l’épaule de la poète ou au creux de sa main peut-être, et qu’on avançait à tâtons, avec elle sur la trace du poème.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...