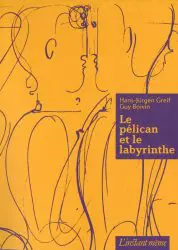C’est presque un roman d’horreur que viennent de publier Hans-Jürgen Greif et Guy Boivin, le troisième qu’ils signent en collaboration après La bonbonnière, en 2007, et Le temps figé, en 2012.
Jean-Loup Grozinski, originaire du nord de la France, a émigré au Québec à 21 ans pour fuir ses devoirs : le service militaire et la paternité, puisqu’il abandonne une femme et un fils qu’il ne connaîtra jamais. Sept ans plus tard, Hortense Guimond trouve en Jean-Loup le futur parfait mari : il est doux, calme, intelligent, et, pour elle qui désire des enfants mais craint les maladies liées à la consanguinité de son Saguenay natal, il importe qu’il soit étranger. En réalité, ils n’ont rien en commun : il s’intéresse à l’art, à la littérature, à la musique, tandis qu’elle ne se passionne que pour les enfants qu’ils ont ensemble. Hortense en voulait absolument six ; après le quatrième, alors qu’elle commence à manifester des signes de trouble psychique, et que Jean-Loup sombre dans une dépression nerveuse, il choisit de la quitter. Se sentant trahie, elle ne vivra plus désormais que pour exercer sa vengeance et détruire son mari « déserteur ». « J’aurais sa peau, juré, craché. » Tout le roman est constitué de l’exercice de cette haine qui la dévore et qui la conduit au bord de la folie, Hortense mettant toute son intelligence au service de sa volonté destructrice dirigée vers Jean-Loup, tout à la fois cherchant à manigancer pour mieux le ruiner, à le calomnier pour mieux l’humilier.
Le roman pousse à son paroxysme cette figure profondément symptomatique d’un matriarcat québécois aliénant, un peu à l’image de la mère reptilienne chez Victor-Lévy Beaulieu. Déjà dans Orfeo, un roman de 2003, Greif mettait en scène la signora, grande dame de la musique qui avait pris sous sa protection les deux principaux personnages du roman. Si la signora s’éteint dès l’incipit, sa présence reste latente tout au long du roman, elle n’en finit pas de mourir : « Car elle vivait avec eux, une présence perceptible à tout moment ». Il en va de même avec Hortense auprès de ses enfants, et qu’un adverbe désigne mieux qu’aucun autre : toujours. Il est justement en italique à la page 90 : « Je veillerais sur lui, quoi qu’il arrive. Toujours », dit-elle au sujet de son fils aîné. Car cette femme, prétendant aimer ses enfants, croyant les protéger, s’immisce maladivement dans leurs affaires, entend contrôler leurs gestes et pensées, cherche à les manipuler afin de satisfaire sa haine contre celui qui l’a déçue. Une machine déréglée, dévastatrice. L’horreur, il n’y a pas d’autres mots.
Les dernières pages, très belles, nous sortent enfin du cauchemar maternel. Le roman se termine sur un Jean-Loup fragile, qui, à près de soixante-dix ans, est diminué par la maladie de Parkinson, mais que la famille de son fils Éric réconforte. Il se souvient que, vingt ans plus tôt, il a fait la marche de Compostelle, et ce souvenir suffit à le rendre fier et heureux.
Dès les toutes premières pages, très efficaces, on sent la pleine maîtrise du métier, du sujet ; l’écriture court, coule, progresse comme une rivière poussée par les crues du printemps. Le rythme est d’une vivacité remarquable. C’est direct, immédiat comme un coup de poing, précis et terriblement bien ancré dans le réel, car aucun détail n’est laissé au hasard. À cet égard, on a reproché au roman d’accumuler les détails superflus, aux auteurs de ne pas avoir élagué. Mais c’est que le texte recherche volontairement un effet baroque, où « l’effet de réel » est atteint, saturé, par la profusion des détails, de sorte que la réussite tient à la saisissante capacité des auteurs de nouer tout cela ensemble, de resserrercet univers cohérent autour de cette surabondance qui le constitue. Un roman très fort, habilement structuré, percutant.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...