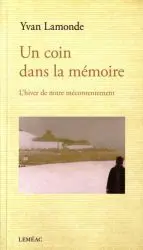Éminent historien de la vie intellectuelle au Québec, Yvan Lamonde délaisse ici la fresque documentaire pour s’adonner à l’essai. Son intention est maintenant de livrer une interprétation personnelle de la « désarticulation politique et intellectuelle du Québécois », dans le but de comprendre comment s’est produite cette désarticulation et de proposer une piste pour sortir de l’ornière.
Le « coin dans la mémoire » évoqué par Lamonde est celui de la division, instillée au cœur de la conscience québécoise par le colonisateur britannique, par la religion catholique et, enfin, par le Québécois lui-même, hésitant entre diverses allégeances et identités. La première semence de division origine de la stratégie de domination subtilement inscrite dans les structures politiques, depuis la Conquête jusqu’au régime fédéral actuel. La religion catholique a contribué pour sa part à enfoncer le coin de la division en laissant croire aux Québécois que la tolérance à l’endroit de leur langue et de leur religion leur assurait la maîtrise de leur destin. Enfin, l’expérience politique québécoise est celle de la division, exprimée par une sempiternelle opposition entre un « nationalisme culturel de conservation » et un « nationalisme politique à visée émancipatoire ». Cette opposition aurait atteint des sommets lors des référendums de 1980 et de 1995.
Le style de l’historien, habitué d’appeler à témoigner le chœur des voix contributives au devenir québécois, en particulier celles des morts, est encore reconnaissable dans l’essai. Lamonde se réclame entre autres de Gaston Miron pour lancer un appel à « rapailler » l’être québécois. Pour contrer le modèle de la division, pour surmonter les blocages et avancer désormais avec plus de confiance, il faudrait selon Lamonde se libérer du passé sans le trahir. Contre le multiculturalisme, il ne faudrait pas hésiter à affirmer la primauté du politique sur le culturel.
À tout prendre, l’analyse de Lamonde le porte à défendre le projet d’une nation fondée sur des principes civiques partagés. Parmi ces principes, sont cités comme exemples « la démocratie, l’État de droit, l’égalité des femmes et des hommes, la laïcité, le français comme langue commune ». Semble avoir été oubliée : la lutte conséquente contre les inégalités socioéconomiques.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...