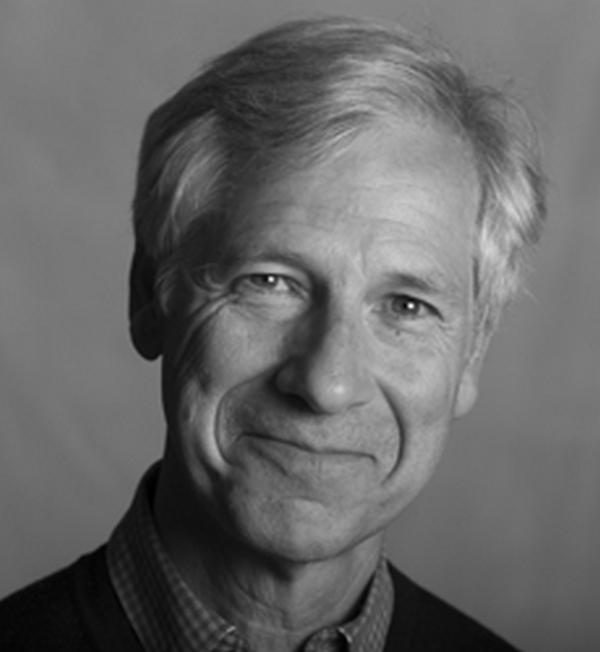Philippe Delerm a une prédisposition naturelle pour le bonheur. Et il ne s’en cache pas. Il la revendique plutôt avec l’étonnement sans cesse renouvelé, l’humilité de qui sait la fragilité de toutes choses en ce domaine. Cette inclination, voire cette aptitude, ne repose pas sur la quête béate d’un impossible rêve, ni sur la recherche de quelque autre forme de convoitise qui incite à toujours vouloir davantage que ce que la vie nous offre ; le bonheur se conjugue ici au présent, dans le lent écoulement des jours justement. Lenteur et présence, le socle du bonheur. Et comment mieux le capter qu’en tenant un journal, un filet pour attraper les instants fuyants et mieux en circonscrire les contours, la couleur, voire la fragilité de ces moments de lisière, comme Delerm les définit : « Dans la pièce d’à côté, les enfants regardent la télévision. J’aime bien cet instant de lisière ; on ne sait plus quelle heure il est, et je n’ai rien à écrire sinon que je suis bien, que c’est bon de se mettre sous la lampe quand la pluie d’orage commence à tomber de nouveau ». Nulle introspection vertigineuse, nulle déclaration de nature à vouloir se convaincre soi-même ou les autres. Seule la présence compte. Saisir les instants de bonheur au moment où ils se présentent et s’en réjouir. Voilà à quoi se consacre ici Delerm avec ferveur.
Ce journal s’échelonne tout au long de l’année 1988-1989, au moment où Philippe Delerm travaille à l’écriture d’un roman, Autumn, qui paraîtra quelque dix ans plus tard. Il n’a pas encore connu le succès que lui apportera la parution de La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Pour l’heure, seule compte l’immense richesse d’avoir du temps pour soi, pour l’égrener en conjuguant sa vie au présent. La pérennité de l’exercice importe ici moins que l’attitude à préserver : demeurer au plus près de l’acte gratuit d’écrire. Aurai-je un ton, une musique sur les jours ? s’interroge-t-il au moment d’entreprendre ce journal en se référant à d’autres écrivains qu’il affectionne et qui se sont prêtés au même exercice, José Cabanis et Paul Léautaud, pour ne nommer que ces derniers. Quelques pages suffisent à s’en convaincre : la touche Delerm est aussitôt reconnaissable.
Philippe Delerm se livre à l’exercice avec la discipline de l’enseignant qu’il est alors et l’indiscipline du rêveur éveillé qu’il cultive avec autant de sérieux. Apparaissent au fil des pages sa compagne, son fils, des amis, et ces lieux auxquels il appartient, loin des sanctuaires littéraires qu’il s’empresse chaque fois de fuir. Il ne choisit ni n’exclut ce qui compose le quotidien du diariste : ses réflexions d’enseignant, de parent, d’amoureux, d’écrivain, de simple citoyen, ses joies et ses inquiétudes, de même que ses relations avec ses éditeurs et le milieu littéraire. Ce journal s’arrête le 31 décembre 1989 avec ces mots de Gilles Vigneault : « Il faut dire les choses de tous les jours, avec les mots du dimanche ». Delerm souhaitait en faire la devise de son journal pour les années à venir, mais ces dernières se sont par la suite déclinées autrement, du moins jusqu’à maintenant. Succès oblige. Mais Philippe Delerm n’a sans doute pas dit son dernier mot à ce sujet, non pas le succès, mais le bonheur.
[wd_hustle id="5" type="popup"]Mode lecture zen[/wd_hustle]
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...