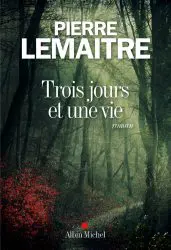Le dernier roman de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, repose sur une structure temporelle tripartite (« 1999 », « 2011 », « 2015 ») et raconte en vingt chapitres l’oppressant parcours d’Antoine Courtin, depuis l’âge de douze ans jusqu’à son établissement comme médecin de campagne dans sa ville natale de Beauval, en France, seize ans plus tard.
Très médiatisée, la disparition du jeune Rémi Desmedt, six ans, est l’événement initial majeur qui vient bouleverser la vie des Beauvalois et suspendre une lourde épée de Damoclès sur la tête d’Antoine. Car, « ivre de rage » et « débordé par un insurmontable sentiment d’injustice » devant le meurtre d’Ulysse, le chien des Desmedt, Antoine a frappé à mort Rémi d’un coup de bâton, le 23 décembre 1999, et transporté le corps dans les épais fourrés de Saint-Eustache. Une première battue pour retrouver le garçon est organisée, en vain. Une seconde est envisagée, mais empêchée par deux gigantesques tempêtes qui dévastent et isolent Beauval. Douze ans s’écoulent. Antoine fait maintenant son internat et vit une « relation […] explosive » avec Laura, étudiante clinicienne attirée comme lui par la perspective de l’action humanitaire. Prié par sa mère de se rendre à une soirée d’anniversaire à Beauval, Antoine revoie la belle et aguicheuse Émilie Mouchotte, une amie d’enfance avec qui il fait l’amour. Le futur médecin est toujours en proie aux crises de panique et d’angoisse : il « vivait avec la conviction que, tôt ou tard, [son] meurtre le rattraperait et ruinerait sa vie », d’autant qu’on projette de créer un parc d’attractions dans les bois de Saint-Eustache, où l’on retrouve bientôt le squelette de Rémi. Devant la menace de Mouchotte père de l’obliger à passer un « test génétique » pour prouver sa paternité, Antoine prend le parti d’épouser Émilie. Quatre ans plus tard, en 2015, le couple est établi à Beauval, où le jeune médecin reçoit un jour un colis que lui a adressé un témoin silencieux du drame de décembre 1999…
Mais ne dévoilons pas ici le dénouement inattendu du récit, qui a toute la couleur des finales en guillotine des nouvelles de Guy de Maupassant (« La Rivière » par exemple).
Trois jours et une vie est un genre de polar inversé où la recherche de l’assassin n’est pas l’objectif principal, puisque l’on en connaît l’identité dès le premier chapitre. Le roman met plutôt l’accent sur la perturbation qui accable le meurtrier après son geste : Antoine subit une véritable descente aux enfers, qui va de la peur d’être découvert à l’envie d’avouer son crime, en passant par de multiples sentiments de doute, de remords, de culpabilité, de « chagrin […] vertigineux », de paranoïa…
Dans une écriture sobre, claire, sans fioritures, le narrateur décrit en même temps les divers comportements de plusieurs personnages secondaires illustrant la vie des Beauvalois, avec leurs rivalités sociales et leurs luttes d’influence. On retrouve ici avec plaisir les « petits faits vrais » chers à Stendhal.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...