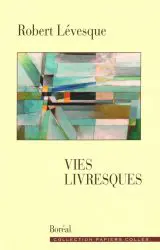La minutie sans sentiment risque d’engendrer la sécheresse. L’aventure sans la rigueur favorise l’égarement dans la stratosphère. La rare rencontre du souci vigilant et de l’appartenance séduit et comble l’auditeur ou le lecteur. Une fois de plus, Robert Lévesque ouvre généreusement ses déferlantes connaissances du monde culturel : qui pourrait en révéler autant que lui au sujet des libraires d’ici et d’ailleurs ?
Lévesque vagabonde de par le monde, mais il le fait les mains ouvertes, prompt à capter et à retenir le détail inaperçu. Si un nom a été brièvement évoqué dans tel obscur document, il devient, par les soins de Lévesque, projeté dans une dimension plus durable : il acquiert un sens, une portée, une exemplarité. Des libraires connus voient leur missionnariat enfin crédité de sa pleine valeur, leurs confrères anonymes accèdent à la lumière, leur fonction à tous goûte enfin à la reconnaissance sociale. Raymond Queneau s’extrait de son Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) pour se lancer, écrit-il, « à la recherche d’une boutique (car j’ai l’intention de m’établir libraire), mais je n’en trouve pas ». Corneille, l’homme de Chimène et de Rodrigue, insère un libraire dans La galerie du palais ou L’amie rivale et fait de lui, comme il se doit, un être « patient, autorisé de parole, serviable, appréciable ». Dans Le libraire, Gérard Bessette crée un Hervé Jodoin désœuvré et moqueur qui suggère aux clients « des livres d’auteurs qu’il considérait suffisamment sans talent pour leur enlever le goût de la lecture ». Tout passe en revue grâce à Lévesque, depuis les épidémiques vols à l’étalage perpétrés sous l’œil plus ou moins leurré du libraire jusqu’aux termes propres au métier : les rossignols pour désigner les invendables, les vaches pour évoquer les serviettes accueillant à gueule ouverte les acquisitions…
Cette attention promenée aux quatre coins de la planète ne fait pas de Lévesque un déraciné. Depuis ses jeunes années à Rimouski, il garde souvenance de mademoiselle D’Anjou, « commis de libraire de province, femme-repoussoir », qui l’aura aidé à se livrer très tôt à ce que Valery Larbaud appela victorieusement « ce vice impuni, la lecture ». Mieux encore, Lévesque rend hommage à deux cas rimouskois « d’indéracinables, des personnalités de grand talent, une journaliste, Lisette Morin – la bibliothèque municipale porte son nom – et un homme de radio, Sandy Burgess – il a formé Pierre Nadeau, Bernard Derome, que Miville Couture lui envoyait, il faisait travailler Michel Garneau ». De fait, Sandy Burgess, attiré à Montréal par Radio-Canada, n’endura la métropole que brièvement ; après un an d’exil, il était de retour « chez lui ».
Minutie et chaleur humaine, de quoi construire une culture.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...