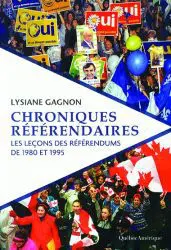Il est (trop) tentant de laisser Lysiane Gagnon juger elle-même son travail journalistique : « […] dans tout événement, l’être humain verra ce qu’il cherche et fermera les yeux sur ce qui irait à l’encontre de ses préjugés ». L’auteure, en effet, démontre ici cent fois plutôt qu’une qu’on a bien fait d’enterrer le mythe de l’objectivité journalistique.
Les deux pans de ce recueil farouchement fédéralisant obéissent à des règles différentes. À propos du référendum de 1980, la chroniqueuse procède par la voie synthétique, stylisant son argumentation de l’époque. En ce qui concerne le second référendum (1995), l’auteure laisse parler les chroniques écrites au fil des jours. Dans les deux cas, la thèse demeure la même : rien ne justifie un plongeon du Québec dans les incertitudes de l’indépendance.
Bien sûr, cette attitude est légitime ; elle est même prévisible et presque automatique à La Presse. Il n’était pourtant pas obligatoire de la défendre de façon aussi hargneuse et excessive. D’entrée de jeu, Lysiane Gagnon discrédite l’hypothèse d’une abstention du gouvernement fédéral : « […] Joe Clark, un homme conciliant et peu combatif qui était allé jusqu’à déclarer qu’il ne participerait pas à la campagne référendaire puisqu’il n’était pas Québécois ». Comme si la Suède avait eu tort de laisser la Norvège tenir son référendum de 1905 sans le troubler de l’extérieur. À peine quelques pages plus loin, la chroniqueuse reproche – à juste titre d’ailleurs – à Lise Payette son attaque malséante contre Madeleine Ryan ; elle en conclut, comme Pierre Bibeau, que « les femmes seront le fer de lance de notre campagne ». Quinze ans plus tard, le verdict s’est émoussé : « L’affaire des ‘Yvette’ n’a pas été aussi déterminante que certains le croient dans la défaite du OUI en 1980 ». Miniaturisation analogue à propos du coup de la Brink’s : « Une rumeur invraisemblable – lancée si ma mémoire est bonne, par un reporter de la Presse canadienne – s’était répandue ». La journaliste aurait mieux fait de parier sur les faits que de se fier à sa mémoire.
Sans surprise, tout ce que le camp souverainiste a pu dire ne mérite que ridicule et mépris, tandis que la totalité du plaidoyer fédéraliste, y compris le fameux engagement de Trudeau en faveur du « changement », mérite l’admiration éternelle : « J’étais prise dans cette foule compacte, presque suffoquée, incapable de griffonner sur mon calepin et en même temps ébahie devant ce chef-d’œuvre de rhétorique politique ».
Ceux que n’apprécie pas Lysiane Gagnon n’ont pas droit à sa tendresse. « Il [Parizeau] avait ce que Lévesque n’avait pas : une acuité intellectuelle que seul Pierre Elliott Trudeau pouvait égaler ». En revanche, le même Parizeau « manque de jugement ». Du tortueux Lucien Bouchard, elle écrit : « Chaque jour, on le voit à l’écran – intense, furieux, l’index vengeur, l’esprit enflammé et le ton colérique ». « Ce pauvre Jean Chrétien, qui n’a jamais eu une idée originale de sa vie », ce que contredit l’intelligente proposition du jeune député Chrétien de substituer le sigle Air Canada à TCA. « Arrive Preston Manning, avec son museau de rongeur à lunettes, sa voix de fausset […] ». Etc.
Même le journalisme engagé n’est pas astreint au fanatisme.
RETOUR AU SOMMAIRE DU DOSSIER Un peuple et son rêve
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...