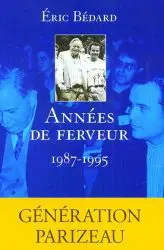Quand un auteur réfère ainsi à ses années de ferveur, le lecteur doit-il en conclure que les autres années du signataire ont baigné dans la torpeur ? On n’oserait l’affirmer d’Éric Bédard, même si son épilogue respire le désenchantement. Chez lui, en effet, deux sentiments s’affrontent au lendemain du second référendum : l’attachement viscéral à l’indépendance du Québec et le déprimant constat que les tenants de l’indépendance québécoise sont voués à un statut minoritaire. Ce n’est pas la fatigue culturelle d’Hubert Aquin, mais cela s’y apparente. À tort ou à raison, je lis ce livre comme s’il datait vraiment du soir de la déception.
L’ambivalence de Bédard n’a rien de stérile. Au contraire. Depuis les années fébriles dont il témoigne aujourd’hui, il a multiplié, seul ou en tandem, les contributions éclairantes à la connaissance du passé national. Je pense ici aussi bien à son Recours aux sources (Boréal, 2011) ou à Parole d’historiens (PUM, 2006) qu’à son ambitieuse compilation des chroniques politiques de René Lévesque (Hurtubise, 2014). S’agit-il d’une attente vigilante, pendant laquelle Bédard se raccrocherait « à la contingence, à cette idée que l’histoire est faite de hasards » ? Je ne sais.
Par son pèlerinage vers ses années de militance, Bédard révèle la tessiture de ses penchants personnels. Dans la ferveur de ses 25 ans, il jugeait hommes et enjeux avec une candeur brutale qu’il a feutrée depuis lors. « Au fond, écrivait-il, chef de parti ou de gouvernement, René Lévesque était resté un indécrottable jacobin » ; « Bernard Landry, alors numéro deux du parti, dont j’avais serré la main courte et moite de petit prince lors du souper […] ». En Denis Monière, il voyait « le type même de l’universitaire prétentieux et distant, convaincu de posséder les vérités essentielles ». En revanche, ses sympathies volaient d’instinct vers des personnalités comme Gilles Rhéaume (« le plus sympathique » des trois leaders du minuscule Parti indépendantiste) ou Jean Garon (« cet indépendantiste de la première heure avait toujours lutté contre ces Montréalais qui voulaient tout centraliser », en pondérant ceci : « Comme tous ceux qui aspirent aux fonctions les plus élevées, il [Garon] avait une très haute opinion de sa personne »). Même s’il n’aime pas opposer droite et gauche, le Bédard de cette période penche vers un populisme à la fois chaleureux et conservateur, vers Jacques Grand’Maison plutôt que vers les boomers.
Le déchirement vécu par le Parti québécois lors du second référendum, Bédard le subit au plus profond de ses jeunes convictions. Il admire Parizeau, mais il finira par se ranger du côté de ceux qui, comme Lucien Bouchard, plus flexible que Monsieur, bémolisent l’indépendance par l’association : « Il va de soi que l’échec du lac Meech et l’irruption d’un chef aussi charismatique que Lucien Bouchard ont contribué bien davantage à la ferveur souverainiste que son idée claire du Québec [celle de Parizeau] ». Vingt ans après les événements, il n’est pas dit que le verdict résiste.
Témoignage utile, mais qui ne doit pas occulter le travail ultérieur.
RETOUR AU SOMMAIRE DU DOSSIER Un peuple et son rêve
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...