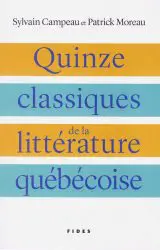Les classiques ont-ils encore une utilité de nos jours ? En fait, pourquoi devrait-on s’en passer ? On ne peut nier que des œuvres brillent plus que d’autres, au firmament littéraire, et nous apparaissent dès lors comme des repères communs sur la route de l’aventure humaine. Sylvain Campeau et Patrick Moreau ne doutent pas de l’importance des classiques pour une littérature et, plus largement, pour une culture. En témoigne leur passage à l’acte. Sous leur direction paraît cet ouvrage collectif, réunissant quinze textes de spécialistes de la littérature québécoise traitant chacun d’un classique.
Les codirecteurs de la publication n’ont pas pris la responsabilité de dresser la liste de ces œuvres phares. Ils ont fait appel à l’historien de la littérature québécoise Michel Biron, qui prend soin de mentionner dans un préambule que sa liste demeure ouverte. En effet, les classiques constituent un patrimoine collectif, ce qui implique une reconnaissance, à la fois par un public lecteur et par des institutions. L’élection d’une œuvre au statut de classique, et son maintien dans ce statut, passent par un processus sociologique complexe, auquel participent évidemment les experts. Notons ici que le livre est intitulé « quinze classiques » et non « les quinze classiques ».
Comme l’annonce l’introduction de l’ouvrage, les collaborateurs présentent les titres choisis « afin d’en montrer la richesse intrinsèque, mais aussi l’aspect significatif pour l’évolution de la littérature québécoise ». C’est dire que ces analyses auront une utilité pour l’enseignement, mais aussi un intérêt pour le grand public lecteur, qui y sera encouragé à découvrir les œuvres, ou encore y trouvera à enrichir la compréhension et l’interprétation de ses lectures.
Côté poésie, on ne sera pas étonné de retrouver parmi les élus Regards et jeux dans l’espace de Saint-Denys Garneau et les Poésies d’Émile Nelligan. Une question très juste est posée par Nelson Charest dans son texte sur Nelligan, et qui est également valable pour Saint-Denys Garneau : ces poètes sont entourés d’un mythe, mais leurs poèmes sont-ils lus ? On conçoit en effet la pertinence d’inciter à les lire. Le cas d’Alain Grandbois est différent. C’est un auteur moins largement connu et le recueil Les îles de la nuit est peut-être apprécié à sa juste valeur surtout par les spécialistes. Quant à Gaston Miron, les nombreuses réminiscences de son personnage et de son œuvre dans la vie culturelle d’aujourd’hui témoignent de sa stature. Comme le souligne Claude Filteau, l’auteur de L’homme rapaillé est surtout vu comme un écrivain engagé pour une société plus égalitaire et un Québec indépendant, mais sa poésie n’est pas toujours perçue dans toute sa profondeur.
Parmi les œuvres commentées, on constate la supériorité en nombre des récits de fiction et cela reflète la faveur populaire pour le genre. Du roman Le survenant de Germaine Guèvremont à Volkswagen Blues de Jacques Poulin, en passant par Le torrent d’Anne Hébert, on se penche sur des œuvres qui, en plus d’avoir été largement acclamées au moment de leur parution, sont encore appréciées des lecteurs contemporains. Entre autres, Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy, qui fut adapté au cinéma et valut à son auteure le prix Femina en 1947, donne accès à un certain Montréal des années 1940. Selon Sophie Marcotte, on lit beaucoup l’œuvre aujourd’hui pour cette valeur historique. Le « petit roman » Le libraire de Gérard Bessette, traduit et apprécié en plusieurs langues, est peut-être devenu un classique parce qu’on ne se lasse pas de l’interpréter et de le réinterpréter. Prochain épisode d’Hubert Aquin est présenté par Guylaine Massoutre comme « un roman cultivé et québécois, qui fait le pont entre l’Amérique et l’Europe dans sa géographie fictionnelle ». Figurent encore au tableau les romans Une saison dans la vie d’Emmanuel de Marie-Claire Blais et L’avalée des avalés de Réjean Ducharme, deux événements littéraires des années 1960 dont les échos sont encore bien perceptibles.
Une seule pièce de théâtre se retrouve dans le portrait de groupe, sans conteste la référence en dramaturgie québécoise : Les belles-sœurs de Michel Tremblay. Également un seul classique pour représenter l’essai : La ligne du risque de Pierre Vadeboncœur. Enfin, Jacques Ferron, qui pour plusieurs a atteint la perfection dans un genre peu fréquenté, voit ici confirmée la valeur classique de ses courts et truculents récits. Marcel Olscamp avance qu’il faut lire les Contes de Ferron parce qu’ils sont au fondement de l’identité québécoise. Sans grand risque de se tromper, on pourrait dire que la collection rassemblée dans l’ouvrage participe de ce fondement.
ESPACE PUBLICITAIRE
DERNIERS NUMÉROS
DERNIERS COMMENTAIRES DE LECTURE
Loading...