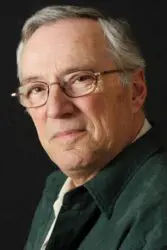Le terme saga, n’en déplaise à l’éditeur de La poussière du temps1 de Michel David, ne peut s’entendre ici que dans un sens dévié. Le Nouveau Littré en témoigne, qui définit ainsi la saga : « Histoire familiale qui se déroule sur plusieurs générations ».
Même si, en effet, Maurice Dionne a empoisonné l’existence de sa femme, puis celles de ses descendants, c’est lui, un lui écrasant, qui donne à ce récit sa triste unité. Maurice est le fléau, dans tous les sens du terme, et tous les autres personnages s’en tiennent bon gré mal gré non pas tant au statut de figurants qu’à celui de victimes.
Ombres et clarté
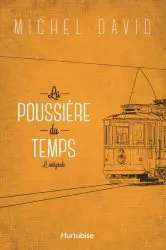 Quand Maurice Dionne rencontre Jeanne Sauvé, il jouit aussitôt à nos yeux de lecteur d’un préjugé favorable : venus rendre visite à des êtres chers logés par hasard dans la même chambre d’hôpital, les deux jeunes gens se plaisent et décident discrètement de profiter du hasard. Leur besoin d’émancipation au creux d’une époque astreinte à l’orthodoxie et à la soumission les rend sympathiques à nos regards de modernes (prétendument) émancipés. Le mariage couronne le tout. Jusque-là, Michel David a veillé à ce que Maurice se conduise en prétendant poli, prévisible, fiable.
Quand Maurice Dionne rencontre Jeanne Sauvé, il jouit aussitôt à nos yeux de lecteur d’un préjugé favorable : venus rendre visite à des êtres chers logés par hasard dans la même chambre d’hôpital, les deux jeunes gens se plaisent et décident discrètement de profiter du hasard. Leur besoin d’émancipation au creux d’une époque astreinte à l’orthodoxie et à la soumission les rend sympathiques à nos regards de modernes (prétendument) émancipés. Le mariage couronne le tout. Jusque-là, Michel David a veillé à ce que Maurice se conduise en prétendant poli, prévisible, fiable.
Le vernis a tôt fait de craqueler et le vrai Maurice de jeter bas le masque. Il décide de tout sans consulter sa femme. Les priorités du couple relèvent toutes de son arbitraire, aucune des besoins de Jeanne. Pire encore, il en arrive à lui administrer un coup qui la laisse meurtrie et révoltée. Sans attendre une récidive, Jeanne retourne chez ses parents. Ceux-ci découvrent à leur tour la vraie nature de Maurice et endossent la décision de leur fille. Au moment où le bris menace, Maurice se manifeste et réclame poliment sa conjointe. Mis en demeure de s’amender, il s’engage à renoncer aux arguments frappants. En peu de page, les étranges compromis de ce couple sont fixés ; ils ne varieront pas.
Maurice aurait-il changé en profondeur ? À peine. Il ne frappera plus Jeanne, mais il persistera à la traiter en subalterne et à l’agonir d’injures méprisantes. Faible lueur de savoir-vivre confrontée à d’opaques déferlements de grossièreté. Cloisonnement difficile à comprendre.
Autre contradiction
Maurice ajoutera à cette première compartimentation un contraste marqué entre le visage qu’il impose à sa famille et celui qu’il réserve à ses employeurs. Le tyran domestique laisse ses crocs sous le toit familial et séduit patrons et compagnons de travail par sa jovialité et une parfaite fiabilité. Un Doctor Jekyll and Mister Hyde montréalais.
Pendant longtemps, le destin de la famille Dionne oscille entre la dèche et l’espoir. D’année en année, le nombre d’enfants augmente et rend nécessaires les déménagements vers des logements moins exigus. Convaincu que les grossesses n’engagent que la responsabilité féminine, Maurice blâme Jeanne de ne pas éviter l’expansion de la famille. Il n’ajoute cependant rien aux allocations minables qu’il verse à Jeanne et qui permettent à peine la survie de la famille. À Jeanne de combler les vides en ajoutant aux tâches familiales de modestes travaux de couture. Implacablement, la famille se loge selon une pente descendante qui contredit l’évolution montréalaise : alors que de nombreuses familles améliorent leur sort en se déplaçant vers le nord de la rue Sherbrooke, le clan Dionne glisse vers le sud de la ville et ses taudis. Maurice, taiseux et cruel, améliore ses revenus, mais s’en réserve les retombées. La famille ? Que Jeanne s’en charge.
Improbable remontée
Les quatre tomes qui relatent ce machisme dévorant et une vie familiale étouffante ont beau tenir un certain compte du passage des décennies, ils n’en voilent que médiocrement les horreurs. Jeanne et Maurice vieillissent sans que le tyran cesse de distribuer à ses enfants taloches et ukases, pendant que la famille gagne enfin quelques degrés dans l’échelle sociale. Miracle ? Courage des époux ? David semble y voir la preuve des mérites du chef de famille : « Maurice Dionne était peut-être un homme nerveux et impatient, mais personne n’aurait pu nier qu’il était un travailleur acharné. La meilleure preuve en était qu’il avait cherché et vite déniché l’emploi supplémentaire dont il avait besoin pour boucler des fins de mois difficiles ». Pareil verdict étonne. Certes, il fut un temps où le père de famille québécois échappait à la critique s’il jouait correctement le rôle du pourvoyeur, mais imputer aux seuls efforts de Maurice la tardive avancée du clan Dionne occulte un peu vite ceux de Jeanne et les brimades infligées jusqu’à leur âge adulte aux nombreux enfants de la famille. Sa vie durant, Maurice valorisa d’abord et avant tout ses voitures, ses cigarettes, son emprise sur le budget familial et les revenus des enfants. En ce sens, il fait penser – en pire ? – au Séraphin Poudrier de Claude-Henri Grignon ; en plus de les affamer, Maurice agresse verbalement Jeanne et ses enfants avec une brutalité que la Donalda des Belles histoires des pays d’en haut n’eut jamais à subir de la part de l’avare. Tout au plus David laisse-t-il entendre que Maurice éprouvait à l’occasion une certaine forme de doute : « Il était évident qu’il [Maurice] regrettait sa colère et, surtout, sa sanction. Mais la vue du visage si peu repentant de son fils lui avait fait voir rouge ». C’est bien peu.
En intitulant La poussière du temps sa description d’une masculinité lourdaude, l’auteur a-t-il exhumé une peu glorieuse facette de l’histoire sociale québécoise ? Oui et non. Il a puisé dans un répertoire d’horreurs dont nul ne niera la réalité. Par contre, il a accentué jusqu’à l’improbable l’entêtement d’un mâle québécois confit dans sa suffisance et son inoxydable égoïsme. L’écrivain bénéficie du pouvoir de mentir vrai et on ne reprochera pas à Michel David d’avoir usé de ce privilège ; on peut néanmoins se demander s’il a dépassé les limites du mensonge plausible.
1. Michel David, La poussière du temps, L’intégrale, Hurtubise, Montréal, 2015, 1207 p. ; 42,95 $.
EXTRAITS
Pour sa part, Maurice, incapable de trouver un appartement convenable à prix modique pour loger sa famille déjà nombreuse, refusa d’abandonner son appartement avant que la compagnie lui en ait procuré un autre pour un prix identique.
p. 367
Ce jour-là, Julia Desmarais lui avait clairement dit qu’il était temps de songer à donner à sa femme et à ses neuf enfants un toit décent.
Bien sûr, il se rappelait encore la joie de Jeanne, le même soir, quand, sur un coup de tête, il avait décidé de téléphoner devant elle à la secrétaire de la coopérative pour lui dire qu’il acceptait de devenir membre de son organisme.
p. 634
Lorsque le plafond était peint, Maurice criait à sa femme de venir lui indiquer les endroits qu’il avait oubliés de peindre. Si elle ne trouvait aucun défaut au travail fait, le peintre s’emportait en disant qu’elle était trop paresseuse pour ouvrir les yeux. Si elle en découvrait trop, il se mettait invariablement en colère.
– Christ ! Fais-tu exprès de me faire monter dans l’escabeau, finissait-il par lui dire, excédé.
p. 423