Inspiré et profondément marqué par un dur contact avec la réalité, Les rescapés de Berlin1 de Janine Tessier fait toucher du doigt la difficulté qu’éprouvent les humains à imaginer les souffrances d’autrui.
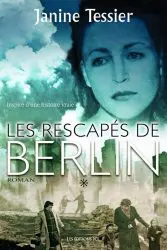 Nos douleurs sont toujours plus vives, nos maux plus immérités, nos morts plus injustes. Lorsque, par malheur, la guerre complique les relations entre les autres et nous, il devient encore plus difficile d’équilibrer la balance : il est impossible que l’ennemi souffre autant que nous, impensable que l’adversaire mérite la pitié autant que nous et qu’il ait le même droit de se plaindre. En s’attaquant à ce faisceau de réflexes, Janine Tessier demande à chacun d’entre nous un effort considérable : celui d’une compassion ouverte à tous.
Nos douleurs sont toujours plus vives, nos maux plus immérités, nos morts plus injustes. Lorsque, par malheur, la guerre complique les relations entre les autres et nous, il devient encore plus difficile d’équilibrer la balance : il est impossible que l’ennemi souffre autant que nous, impensable que l’adversaire mérite la pitié autant que nous et qu’il ait le même droit de se plaindre. En s’attaquant à ce faisceau de réflexes, Janine Tessier demande à chacun d’entre nous un effort considérable : celui d’une compassion ouverte à tous.
Dès les premières pages, l’ampleur du défi se manifeste. En ce 10 janvier 1942, le manoir Lindenbaum accueille le gratin du régime nazi. De Goebbels à Guderian, de Ribbentrop à Göring, aucun des familiers de Hitler n’est absent de la fastueuse réception offerte par le baron von Steinert et son épouse, Else. Certaines de ces personnalités ont beau émettre quelques réserves sur la stratégie du Reich, la prudence feutre tout propos qui ressemblerait à un blâme pour le Führer. Janine Tessier situe d’emblée son héroïne au cœur du cénacle nazi ; elle aura fort à faire pour la rendre sympathique.
La barbarie de la guerre vole au secours de l’auteure. L’opinion répandue dans le camp des Alliés, prompte à imputer tous les torts aux pays de l’Axe (Allemagne, Italie et Japon), ne peut camper dans sa possession tranquille du droit quand s’intensifient les bombardements contre les populations civiles de l’Allemagne. Peu à peu, avec tact et mesure, Janine Tessier creuse le fossé entre le nazisme et le peuple allemand. Alors qu’un optimisme verrouillé maintient son emprise sur les fidèles de Hitler, un nombre croissant de citoyens allemands doutent de la victoire finale et estiment excessif le prix à payer en morts et en privations. Même une famille comme celle d’Else est confrontée à la frugalité et à la plus constante insécurité. Le jour vient où Else et ses quatre bambins doivent quitter Berlin démoli et leur statut privilégié et se mettre en route pour Düsseldorf, pendant que le père, Johann, lié de trop près à la Gestapo pour s’absenter, ne peut accompagner les siens. Commence alors un calvaire de trois mois : 650 kilomètres à franchir à pied dans un pays en proie au désordre.
Ambivalence croissante
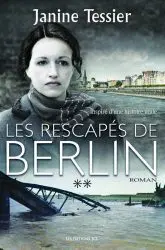 Ce périple rend tangible et émouvante une Allemagne de moins en moins d’accord avec son gouvernement et de plus en plus ensanglantée par les bombes. Les communications font défaut et Else sera sans contact avec son mari jusqu’à ce que la nouvelle du décès de Johann vienne s’ajouter à son esseulement. Déjà, elle avait dû dissimuler sa noblesse, tant le peuple s’éloignait du régime hitlérien ; Else ne pouvait désormais compter que sur les amitiés nouées en route ou sur l’amitié de contacts discrets.
Ce périple rend tangible et émouvante une Allemagne de moins en moins d’accord avec son gouvernement et de plus en plus ensanglantée par les bombes. Les communications font défaut et Else sera sans contact avec son mari jusqu’à ce que la nouvelle du décès de Johann vienne s’ajouter à son esseulement. Déjà, elle avait dû dissimuler sa noblesse, tant le peuple s’éloignait du régime hitlérien ; Else ne pouvait désormais compter que sur les amitiés nouées en route ou sur l’amitié de contacts discrets.
Quand s’ouvre le second tome de cette odyssée, Else et sa petite troupe sont parvenus à Düsseldorf et la guerre achève ses ravages. Un autre combat commence pour une baronne sans ressource autre que celle du travail. Serveuse de restaurant, secrétaire travaillant pour tel ou tel consulat, Else peine à nourrir sa progéniture et mendie auprès d’un beau-frère l’accès à un sous-sol malsain. Cela dure et dure.
Le poids des secrets
Le récit que reconstruit Janine Tessier ne se limite pas aux aspects matériels que sont la faim, la peur, le dénuement ; il intègre les pressions exercées sur le couple par l’intransigeance du régime et sa manie du soupçon. Dès Berlin, Else souffrait des silences de Johann. Quand, pendant les réceptions de Lindenbaum, les divergences affleuraient entre les vedettes du régime, Else ignorait la toile de fond et les enjeux en cause ; Johann, malgré son amour, lui en disait le moins possible. Tout au plus déplorait-il leur crédulité : « Comment avons-nous pu nous laisser berner, endoctriner, jusqu’à sacrifier tout ce que nous possédions à la cause, donner nos enfants, leur sang, leur vie ? » La frustration d’Else s’amplifie encore quand, mise en contact avec des gens mieux renseignés qu’elle au sujet des camps de la mort ou des purges sanglantes, elle dut admettre qu’elle avait vécu jusque-là hors de la réalité.

Else connut-elle enfin l’apaisement ? La pacification de l’Europe s’accompagna-t-elle d’une coexistence sereine entre les Alliés et les peuples conquis ? Oui et non. D’après le récit de Janine Tessier, Else vécut pendant encore longtemps – des années et des années – dans une semi-clandestinité, faute de pouvoir avouer son appartenance passée à une classe sociale associée intimement au régime nazi. Planait toujours sur son emploi, pensait-elle, le risque d’une révélation. Cela étonne. On peine à croire, en tout cas, que les consulats britannique et étatsunien aient pu ignorer la véritable identité d’Else von Steinert : d’une part, les embauches dans ces milieux firent toujours l’objet de vérifications surabondantes ; d’autre part, le maccarthysme asphyxiait de méfiance la bureaucratie et la diplomatie de l’époque. Peut-être Else vécut-elle cette peur sans raison.
On ne s’étonnera pas, en revanche, des convictions exprimées par Else et les siens et dont l’auteure révèle la teneur. Les Russes ont mauvaise presse pour une diversité de motifs, depuis les conquêtes effectuées par les divisions soviétiques propulsées par Staline jusqu’au changement de régime économique imposé à une partie de l’Allemagne, tandis que le plan Marshall de Washington fit beaucoup pour ramener l’Allemagne de l’Ouest sur la voie de la prospérité. Que les enfants d’Else aient cherché à construire leur avenir de ce côté-ci de l’Atlantique confirme simplement une tendance prévisible.
L’essentiel demeure le message porté par le travail de Janine Tessier : la guerre n’épargne personne, ni les agresseurs ni les agressés.
1. Janine Tessier, Les rescapés de Berlin, JCL, Chicoutimi, 2015, T. 1 : 432 p., 29,95 $ ; T. 2 : 478 p., 29,95 $.
EXTRAITS
Je sais, répliqua-t-elle vivement. La guerre, pour vous, soldat, c’est la rage de combattre et d’anéantir. Vaincre par tous les moyens, et si cela éclabousse des innocents, ce n’est pas votre faute. C’est ce qu’on vous a appris. Il n’y a pas de place pour la pitié.
T. 1, p. 403.
Les jeux étaient faits. Ils étaient livrés au bon vouloir de l’ennemi, et Hitler s’en lavait les mains. C’était ce que pensaient ces gens en quête d’un asile, condamnés à l’errance, comme Moïse et son peuple à la recherche de la Terre promise.
T. 1, p. 268.
Nous, les femmes allemandes, aurons le devoir de rappeler à nos enfants les usages transmis par nos aïeux, veiller à ce que nos descendants demeurent des Allemands dans l’âme. Dans la rue, qu’ils s’expriment en anglais, en russe s’ils le veulent, mais, à l’intérieur de nos maisons, qu’ils le fassent en allemand.
T. 2, p. 206.











