Avec la publication récente de La petite B.1, Gilles Jobidon poursuit une œuvre romanesque amorcée voilà une quinzaine d’années avec un étonnant succès. Son premier titre, La route des petits matins, avait alors remporté le prix Robert-Cliche 2003, le prix Ringuet 2004 de l’Académie des lettres du Québec et le prix Anne-Hébert 2005. Et pourtant, le manuscrit envoyé à de nombreux éditeurs avait essuyé plusieurs refus. Conversation à bâtons rompus avec un écrivain qui écrit comme on peint.
Gilles Jobidon : À l’origine, je me destinais à la peinture. J’ai étudié en arts plastiques au cégep mais ma sensibilité était si exacerbée que je ne pouvais pas y évoluer à l’aise. À l’université, j’ai donc opté pour l’histoire de l’art et le cinéma. J’ai ensuite travaillé pendant plus de quinze ans dans des musées comme coordonnateur du montage des expositions. Je suis très visuel. Ça doit paraître dans mon écriture. Je sens les choses visuellement et aussi un peu cinématographiquement. Je suis arrivé sur le tard à l’écriture. J’avais 50 ans.
Linda Amyot : Comment est née l’envie soudaine d’écrire ?
 G. J. : Quand j’étais encore au Musée des beaux-arts de Montréal, Châtelaine m’avait commandé un article sur l’art déco. J’ai d’abord proposé au magazine de faire la recherche seulement, mais j’ai finalement accepté d’écrire l’article. De fil en aiguille, j’ai collaboré à Châtelaine pendant quatre, cinq ans tout en continuant à effectuer des contrats pour les musées. C’est à partir de là que j’ai eu envie d’écrire. J’ai lu beaucoup. À un moment donné, j’ai été malade et j’ai dû arrêter de travailler pendant deux ans et demi. J’ai commencé à écrire… Je ne savais pas sur quoi alors j’écrivais, j’écrivais… J’ai envoyé une trentaine de pages à un éditeur qui m’a répondu que j’écrivais bien mais que je devais davantage circonscrire mon travail qui allait dans trop de directions. Son conseil m’a aidé. J’ai alors commencé un texte basé sur l’expérience de mon chum, ce qui a donné La route des petits matins. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup d’eau dans ce roman : la rivière, les larmes, le marais… J’ai donc circonscrit mon projet d’écriture autour des éléments occidentaux – terre, air, eau, feu – et orientaux – les mêmes plus l’or et le bois. J’ai ensuite écrit L’âme frère, qui porte sur l’air : respiration, étouffement, souffle, espace, etc. Ces éléments se trouvent en filigrane dans la psychologie, le sous-texte ou la thématique de base des romans – à part dans Combustio, où c’est très évident. Ça m’a rapproché de la façon dont on fonctionne en art contemporain, par flashs, par images. Surtout à partir de Combustio… Il y a une façon de faire en arts visuels qui s’appelle le ready-made. Marcel Duchamp, par exemple, prenait un objet quelconque et partait de celui-ci pour créer une œuvre. C’est un petit peu comme ça que je fonctionne… Avant d’écrire La petite B., j’avais commencé une recherche sur le peintre Delacroix – dont Baudelaire était un admirateur. En lisant sur Delacroix, je suis tombé sur un passage où on disait que Baudelaire, vers dix-neuf ans, était allé aux îles Mascareignes. J’ai alors commencé une recherche là-dessus mais il n’y a presque rien. C’était une occasion en or. Pour moi, Baudelaire, c’était une sorte de ready-made, un objet que je pouvais approfondir.
G. J. : Quand j’étais encore au Musée des beaux-arts de Montréal, Châtelaine m’avait commandé un article sur l’art déco. J’ai d’abord proposé au magazine de faire la recherche seulement, mais j’ai finalement accepté d’écrire l’article. De fil en aiguille, j’ai collaboré à Châtelaine pendant quatre, cinq ans tout en continuant à effectuer des contrats pour les musées. C’est à partir de là que j’ai eu envie d’écrire. J’ai lu beaucoup. À un moment donné, j’ai été malade et j’ai dû arrêter de travailler pendant deux ans et demi. J’ai commencé à écrire… Je ne savais pas sur quoi alors j’écrivais, j’écrivais… J’ai envoyé une trentaine de pages à un éditeur qui m’a répondu que j’écrivais bien mais que je devais davantage circonscrire mon travail qui allait dans trop de directions. Son conseil m’a aidé. J’ai alors commencé un texte basé sur l’expérience de mon chum, ce qui a donné La route des petits matins. Je me suis rendu compte qu’il y avait beaucoup d’eau dans ce roman : la rivière, les larmes, le marais… J’ai donc circonscrit mon projet d’écriture autour des éléments occidentaux – terre, air, eau, feu – et orientaux – les mêmes plus l’or et le bois. J’ai ensuite écrit L’âme frère, qui porte sur l’air : respiration, étouffement, souffle, espace, etc. Ces éléments se trouvent en filigrane dans la psychologie, le sous-texte ou la thématique de base des romans – à part dans Combustio, où c’est très évident. Ça m’a rapproché de la façon dont on fonctionne en art contemporain, par flashs, par images. Surtout à partir de Combustio… Il y a une façon de faire en arts visuels qui s’appelle le ready-made. Marcel Duchamp, par exemple, prenait un objet quelconque et partait de celui-ci pour créer une œuvre. C’est un petit peu comme ça que je fonctionne… Avant d’écrire La petite B., j’avais commencé une recherche sur le peintre Delacroix – dont Baudelaire était un admirateur. En lisant sur Delacroix, je suis tombé sur un passage où on disait que Baudelaire, vers dix-neuf ans, était allé aux îles Mascareignes. J’ai alors commencé une recherche là-dessus mais il n’y a presque rien. C’était une occasion en or. Pour moi, Baudelaire, c’était une sorte de ready-made, un objet que je pouvais approfondir.
Et l’élément derrière La petite B., c’était la terre ?
G. J. : Non, l’or. L’or, c’est la beauté, l’absolu, la connaissance, la quête de l’immortalité. Quand on travaille sur les éléments, il faut aussi travailler sur leur contraire. On est ici au cœur de l’univers symbolique. Chez Baudelaire, c’est aussi le désordre, la mort, la perversion, la putréfaction. Le côté sensuel de Baudelaire, j’ai vraiment voulu m’en inspirer. Je ne suis pas très figuratif. Je travaille davantage du côté de l’impression, des sensations, de l’atmosphère, de la sensibilité, de la profondeur. Par exemple, j’aime les fins ouvertes. Donc, avec La petite B., je voulais plutôt m’inspirer de l’art. Car l’art, c’est l’or, et l’or, c’est la poésie.
Vous dites que vous ne vous intéressez pas beaucoup à la figuration et pourtant les toiles de Georges de La Tour dans Combustio sont tellement bien décrites, on les voit sans avoir besoin de les voir réellement…
G. J. : Il y a quand même des peintres figuratifs qui m’accrochent. Georges de La Tour en est un. Monet, Turner, Delacroix, Hopper, Christopher Pratt… Mais ce sont des figuratifs qui travaillent beaucoup la sensualité, la matière, le cadrage, l’impression… Par contre, j’adore aussi la photographie. En fait, je suis plus proche d’une Virginia Woolf, qui écrit des romans en racontant des histoires mais en toutes sortes de petits plans. Ça devient un fractionnement qui ressemble beaucoup à celui de Monet. Quand on regarde ses nymphéas de près, on se rapproche de l’abstraction. Alors, pour moi, c’est le jeu, la texture langagière, l’espace sacré révélé par les mots, la musicalité. Je travaille beaucoup cette dimension. C’est pour cette raison que je prends du temps à écrire chaque roman.
Revenons un peu sur La route des petits matins, qui a bien failli ne jamais être publié.
G. J. : Ah ! La route, c’est toute une saga ! J’avais envoyé le manuscrit à dix-sept éditeurs. Dix-sept refus. Je l’ai mis dans un tiroir. Un matin, une amie, Brigitte Purkhardt, m’appelle pour me dire que je dois absolument le soumettre au prix Robert-Cliche. La date limite du dépôt était le jour même, à midi ! Elle est venue au bureau prendre la clé de ma maison, est allée chercher le manuscrit, en a fait des photocopies et s’est rendue à Montréal… mais elle est arrivée en retard à cause de la circulation ! On apprend ensuite que le délai pour le dépôt avait été reporté à la fin de la journée pour toutes sortes de raisons et que le manuscrit avait été accepté. Alors, j’ai eu le prix Robert-Cliche, puis le Ringuet et le Anne-Hébert. Ce à quoi je ne m’attendais absolument pas.
Comment avez-vous réagi ? Est-ce que ça vous a encouragé à continuer à écrire ?
G. J. : Oui et non. J’avais l’impression qu’on m’attendait avec une brique et un fanal pour le deuxième, mais il a été bien reçu.
Comment sont venues les nouvelles ?
 G. J. : Ça, c’est vraiment de l’exploration. Je ne dis pas que je n’en écrirai jamais d’autres mais je me sens beaucoup plus romancier que nouvelliste. Par contre, la dernière nouvelle de D’ailleurs, « Le tiroir bleu », avec le personnage de l’assureur, c’est ce qui a amené Combustio. Je suis curieux de nature, alors j’ai lu sur la Lloyd’s. Certaines personnes apprécient moins cette section du roman qui est presque du publireportage, mais je trouvais l’histoire de la Lloyd’s passionnante et tellement romanesque. Par contre, ce qui me ressemble le moins dans Combustio, c’est que, comme je travaille par fragments – moi, j’appelle plutôt ça des tableaux –, je ne fais pas nécessairement les liens entre eux. J’aime laisser de la place à l’intelligence du lecteur. Mon éditeur trouvait cependant trop éloignés les uns des autres ces fragments de différentes histoires qui forment une structure labyrinthique pour que le lecteur fasse les liens. Je les ai donc créés mais ce n’est pas naturel chez moi.
G. J. : Ça, c’est vraiment de l’exploration. Je ne dis pas que je n’en écrirai jamais d’autres mais je me sens beaucoup plus romancier que nouvelliste. Par contre, la dernière nouvelle de D’ailleurs, « Le tiroir bleu », avec le personnage de l’assureur, c’est ce qui a amené Combustio. Je suis curieux de nature, alors j’ai lu sur la Lloyd’s. Certaines personnes apprécient moins cette section du roman qui est presque du publireportage, mais je trouvais l’histoire de la Lloyd’s passionnante et tellement romanesque. Par contre, ce qui me ressemble le moins dans Combustio, c’est que, comme je travaille par fragments – moi, j’appelle plutôt ça des tableaux –, je ne fais pas nécessairement les liens entre eux. J’aime laisser de la place à l’intelligence du lecteur. Mon éditeur trouvait cependant trop éloignés les uns des autres ces fragments de différentes histoires qui forment une structure labyrinthique pour que le lecteur fasse les liens. Je les ai donc créés mais ce n’est pas naturel chez moi.
Quand on regarde votre œuvre dans un ordre chronologique, on a d’abord La route des petits matins, un roman intimiste avec des phrases courtes. Ensuite, L’âme frère, qui contient beaucoup de mots du vieux français…
G. J. : Il y en a des inventés aussi. J’ai choisi des termes et des expressions en vieux français dans des glossaires, mais j’en ai inventé… qui faisaient Nouvelle-France.
En même temps, la forme de L’âme frère se rapproche de La route des petits matins avec ses phrases très courtes, elliptiques. Ensuite, il y a le recueil de nouvelles D’ailleurs et celui de récits en prose poétique, Morphoses. Puis arrive Combustio avec des phrases très longues, des segments qui ressemblent à du reportage. Avec La petite B., on est un peu entre les deux. Est-ce que c’est une volonté d’explorer différentes formes ?
G. J. : Tout à fait. J’ai un esprit sautillant. Mais le lien est la langue. La musicalité, la sonorité, le rythme sont primordiaux pour moi. La peinture, la musique – je suis des cours d’accordéon celtique –, le cinéma sont des univers qui me rejoignent et qui traversent mon écriture. Si mon écriture finissait par ressembler à de l’aquarelle, par exemple, ça me ferait bien plaisir.
Vous mêlez beaucoup la fiction et le réel, les personnages historiques et fictifs : vous sentez-vous tenu de respecter les éléments véridiques, historiques ?
G. J. : Absolument pas. Il y a un proverbe chinois – j’en entends à longueur de journée ! – qui dit : « Vrai vrai faux faux. Faux faux vrai vrai ». C’est-à-dire qu’il y a du faux dans le vrai et du vrai dans le faux. Les analyses des historiens ne seraient pas tout à fait exactes si on pouvait connaître la vérité. Par contre, si on pense aux romans de Soljenitsyne sur le goulag, c’est romanesque mais il y a probablement beaucoup de vérité là-dedans… Je suis cependant très structuré dans mes recherches.
Vous faites beaucoup de recherches ?
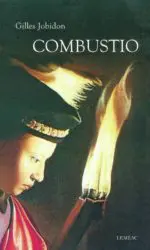 G. J. : Pour Combustio, j’ai passé six ans dans l’univers du feu, du cirque – j’ai lu à peu près 60 livres sur les cirques, sur l’assurance. Pour La petite B., je n’ai presque rien trouvé sur le voyage de Baudelaire aux Mascareignes mais j’ai lu beaucoup sur Caroline Baudelaire. Je fais beaucoup de recherches mais je m’en libère. Ce n’est pas facile mais la recherche finit par être à l’intérieur de moi. Je prends des notes pour un prochain roman qui sera en dehors du cycle lié aux éléments. Le dernier roman sur les éléments portera sur la terre… mais ça se passera sur l’eau ! Paradoxe… paradoxe… En ce moment, j’ai une trentaine de pages d’un roman où j’essaie de mixer les deux éléments orientaux : l’or et le bois. En fait, c’est un segment que j’avais écrit pour La petite B., mais qui s’y intégrait mal. Je l’ai conservé pour un autre roman parce que c’était trop loin des quatre autres sections, qui portent sur Charles, Maah, Caroline et Laure.
G. J. : Pour Combustio, j’ai passé six ans dans l’univers du feu, du cirque – j’ai lu à peu près 60 livres sur les cirques, sur l’assurance. Pour La petite B., je n’ai presque rien trouvé sur le voyage de Baudelaire aux Mascareignes mais j’ai lu beaucoup sur Caroline Baudelaire. Je fais beaucoup de recherches mais je m’en libère. Ce n’est pas facile mais la recherche finit par être à l’intérieur de moi. Je prends des notes pour un prochain roman qui sera en dehors du cycle lié aux éléments. Le dernier roman sur les éléments portera sur la terre… mais ça se passera sur l’eau ! Paradoxe… paradoxe… En ce moment, j’ai une trentaine de pages d’un roman où j’essaie de mixer les deux éléments orientaux : l’or et le bois. En fait, c’est un segment que j’avais écrit pour La petite B., mais qui s’y intégrait mal. Je l’ai conservé pour un autre roman parce que c’était trop loin des quatre autres sections, qui portent sur Charles, Maah, Caroline et Laure.
Vous travaillez à partir de quoi ? D’un thème ? D’un personnage ? D’une image ?
G. J. : C’est le hasard qui m’amène à m’intéresser à un sujet en particulier. Mes recherches sur la Lloyd’s. La petite note sur le voyage de Baudelaire aux Mascareignes… Pour L’âme frère, par exemple, j’effectuais des recherches sur les mercenaires allemands engagés par l’Armée britannique au moment de la Conquête lorsque je suis tombé sur un article qui parlait du premier bourreau en Nouvelle-France. Il avait été condamné parce qu’il était homosexuel. On lui avait donné le choix entre être expatrié dans une autre colonie ou devenir bourreau. En même temps, dans un mémoire de maîtrise, j’ai trouvé une brève information sur trois hommes qui s’étaient fait surprendre nus dans une grange. J’en ai fait le déclencheur du récit.
À quel moment apparaît le personnage ?
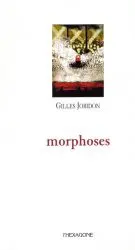 G. J. : Dès que je trouve son nom. Ça peut prendre un certain temps. Au début, Sarah Mill dans Combustio s’appelait autrement. Je lui avais donné le prénom du personnage qui est devenu sa sœur, celle qui est morte dans un incendie. Mais ça ne marchait pas. Quand j’ai trouvé Sarah, tout s’est éclairé. À partir de là, j’ai commencé à voir son appartement, ses meubles, sa collection de livres anciens, ses effets personnels… C’est une chose très importante dans ma façon de travailler. Je passe aussi parfois des journées dans les bibliothèques où je ne fais que sortir des livres d’images. Et je regarde des images, je regarde des images, je fais des photocopies et je les colle sur les murs de mon bureau en chronologie avec la structure de mon roman. C’est mon plan de base. Tout mon roman est là. Après, je vais écrire des bouts. Par exemple, dans L’âme frère, il y a une lettre que le personnage expatrié écrit à son amant. C’est ce que j’ai écrit en premier, mais elle se retrouve dans le troisième quart du livre. Je pensais que le roman commencerait ainsi, mais j’ai continué à écrire d’autres bouts, j’ai déplacé des choses et la structure s’est replacée autrement. Je travaille beaucoup par soustraction. Je peux écrire quinze pages mais, au bout du compte, je n’en garde qu’une seule. Une, plus une, plus une autre et une autre encore, ça finit par donner un roman…
G. J. : Dès que je trouve son nom. Ça peut prendre un certain temps. Au début, Sarah Mill dans Combustio s’appelait autrement. Je lui avais donné le prénom du personnage qui est devenu sa sœur, celle qui est morte dans un incendie. Mais ça ne marchait pas. Quand j’ai trouvé Sarah, tout s’est éclairé. À partir de là, j’ai commencé à voir son appartement, ses meubles, sa collection de livres anciens, ses effets personnels… C’est une chose très importante dans ma façon de travailler. Je passe aussi parfois des journées dans les bibliothèques où je ne fais que sortir des livres d’images. Et je regarde des images, je regarde des images, je fais des photocopies et je les colle sur les murs de mon bureau en chronologie avec la structure de mon roman. C’est mon plan de base. Tout mon roman est là. Après, je vais écrire des bouts. Par exemple, dans L’âme frère, il y a une lettre que le personnage expatrié écrit à son amant. C’est ce que j’ai écrit en premier, mais elle se retrouve dans le troisième quart du livre. Je pensais que le roman commencerait ainsi, mais j’ai continué à écrire d’autres bouts, j’ai déplacé des choses et la structure s’est replacée autrement. Je travaille beaucoup par soustraction. Je peux écrire quinze pages mais, au bout du compte, je n’en garde qu’une seule. Une, plus une, plus une autre et une autre encore, ça finit par donner un roman…
1. Gilles Jobidon, La petite B., Leméac, Montréal, 2015, 228 p. ; 25,95 $.
Gilles Jobidon a publié :
La petite B., Leméac, 2015 ; Une vie de porcelaine, Maurice Savoie, Galerie Plein sud et Les heures bleues, 2013 ; Combustio, Leméac, 2012 ; D’ailleurs, VLB, 2007 ; Morphoses, L’Hexagone ; L’âme frère, VLB, 2005 ; La route des petits matins, VLB, 2003 et Typo, 2014.
EXTRAITS
Je sais le nom qu’elle porte dans le milieu des artistes. La petite B… Elle était soi-disant venue pour faire un portrait de famille qui eût été impossible. J’acceptai de faire la photo seule, à la condition qu’on ne puisse distinguer mes traits. Je ne veux rester qu’une ombre dans cette scabreuse histoire, un détail, une virgule, une note en bas de page. Pour ce qui est de mon fils, j’ai cru longtemps que sa poésie était un mal nécessaire. Je sais maintenant qu’elle est bien pire. Son plus glorieux torchon ne devrait pas s’intituler Les fleurs du mal mais le Mal tout court, en conservant la majuscule. Baudelaire, c’est moi qui l’ai fait.
La petite B., p. 128.
Si écrire est apprendre à lire, peindre est apprendre à voir. Chez La Tour, dessiner équivaut ni plus ni moins à respirer. Pour lui, peindre est autre chose – peindre est mentir vrai. Le nouveau-né ne raconte pas d’histoire, il les contient toutes. Les contes de ce temps-là commencent tous de la même façon. Par cette phrase convenue qui nous éclaire parfois autant que le soleil : il était une fois…
Combustio, p. 252.
À la fin du procès, le juge déclare lesdits Fillio et Saint-Michel convaincus d’actions infamantes consommées nuitamment contre le Ciel et l’ordre public. Il ajoute pour s’être connus charnellement, s’être donné chaleur, contentement ensemble comme mari et femme, s’être abreuvés de luxure, avoir commis des actes d’impudicité contre nature du détestable vice sodomitique de bougrerie. Dit aussi que seuls bestialité, infanticide et régicide sont supérieurs en disgrâce, en abomination.
L’âme frère, p. 15.
Il y aura d’autres soirs, d’autres matins où je n’en pourrai plus, où il n’y aura ni oiseau, ni bruine fraîche, où rien ne pourra me faire oublier le mal. Il faudra alors, comme le cheval devant l’obstacle, décupler ce qu’il y a de douceur, non plus pour gérer, mais digérer ce qui en moi se bat pour vivre, comprendre le mouvement de l’oiseau et de la pluie. Ce que l’on trouve vaut moins que ce que l’on cherche.
Morphoses, p. 53.
Ma grand-mère en poudre, on l’avait mise dans un vase où on a peint une jolie libellule et son nom écrit dessus, Ly Sanh. Mon frère m’avait dit qu’il ne croyait pas que c’était possible que ma grand-mère soit entrée dans un si petit vase. On avait sûrement dû en égarer un gros tas quand elle avait été cinérée, qu’il avait dit. Il dit aussi qu’il voulait aller lui dire au cinérateur, qu’est-ce que tu veux qu’on fasse d’une grand-mère en poudre ? en pleurant, il disait qu’il n’aimait pas ça, une grand-mère en poudre, qu’il préférait la vraie, la pas en poudre, celle qui ressemblait à un dinosaure tout ridé avec des picots bruns, des dents en or et qui sentait la pipe.
« Ly Sanh », D’ailleurs, p. 51.
Le passeur vous conduit jusqu’à un atelier de fabrication de chaises où vous attentent une quinzaine de personnes. Des Viets, des Sino-Viets, des gens qui comme vous ont payé l’acompte de la liberté, qui feront la route à pied vers Srê Âmben, où un bateau vous mènera à bon port – freedom. Des femmes, des hommes, des enfants, des gens dont l’âge varie de quelques mois à celui des cheveux gris. Dans le lot, une vieille femme que tu as côtoyée au marché, Apââ, au moins cinquante ans, l’âge vénérable de ta mère. Elle te reconnaît, te fait un léger sourire en plissant les yeux, en hochant quelque peu la tête. En la regardant, tu t’inclines légèrement en lui faisant cadeau du plus beau sourire que tu peux, malgré la tristesse dont tu es envahi.
La route des petits matins, p. 83.
Un jour, tu m’as demandé comment on fait pour écrire un livre. C’est une de ces questions que l’on pose souvent à ceux qui se mêlent d’écriture. Je ne sais toujours pas comment y répondre. Les questions m’intéressent plus que les réponses. Sans doute est-ce la raison pour laquelle j’écris. Au début, lorsque je suis traversé par le désir d’écrire, je perds mes moyens. J’ai l’impression de ne plus savoir comment.
Une vie de porcelaine, p. 15.











