Y a-t-il mot plus vibrant, plus vivant, que joie ? En italien, gioia amène un sourire. La joie hissée haut, jusqu’à cet art de vivre libre, n’est pourtant pas sans partage chez Goliarda Sapienza.
Le parcours de l’écrivaine sicilienne, née à Catane en 1924, n’a pas été facile, loin de là. Enfant d’une mère icône de la gauche italienne et d’un père anarcho-socialiste, Goliarda Sapienza s’abreuve très tôt aux textes des plus grands esprits, dont une lecture-phare, La femme et le socialisme d’August Bebel.
Retirée à quatorze ans de l’école tombée sous l’emprise fasciste, elle entame peu après des études d’art dramatique à Rome. Sa carrière de comédienne sera interrompue par l’Occupation allemande, alors qu’elle se joint à la Résistance. Les années éprouvantes de faim et de fuite de la persécution nazie achevées, elle connaît le succès sur les scènes d’avant-garde et au cinéma, aux côtés de Luchino Visconti et de Francesco Maselli. Jeune trentenaire, Sapienza traverse une profonde crise de doute. Est-ce pourquoi elle déserte la scène pour se consacrer à l’écriture ? Premiers poèmes, première tentative de suicide soignée par des électrochocs. Une cure psychanalytique peu orthodoxe, dont elle témoigne dans Le fil de midi, s’achèvera en catastrophe, mais devant une fenêtre ouverte sur les mots prêts à s’envoler.
La vie en fusion dans l’œuvre
 Les publications de Lettre ouverte (prélude littéraire qui nous est apparu un peu confus) et du Fil de midi (le style s’épure et s’affirme), regroupés en français dans Le fil d’une vie, apportent quelque réconfort à celle qui n’aura ni dieu ni maître, et tonifient cet élan qui la mène sur les traces de Modesta, son alter ego romanesque. Depuis sa mansarde de la via Denza, la quête fiévreuse durera dix ans et s’intitulera L’art de la joie1. Alors qu’elle est sur le point de conclure, vient un homme qui accompagnera la volcanique Goliarda jusqu’au bout de son voyage. Angelo Maria Pellegrino croit qu’est né quelque chose qui n’existait pas. Les principaux éditeurs italiens ne partageront pas cet avis. Les refus en cascade dictent à Sapienza un geste symbolique et désespéré, qui la conduit à la grande prison des femmes au nord de Rome. Son texte d’une clairvoyance saisissante, L’Université de Rebibbia, fait revivre cette descente aux enfers parmi des prisonnières politiques et de droit commun où elle renaît à la joie. Là comme ailleurs, elle se lie aussi bien avec la prostituée futée qu’avec la jeune révolutionnaire de ces années de plomb. « La gaieté comme le pain et les larmes, défend Sapienza, doit être partagée avec tout le monde. »
Les publications de Lettre ouverte (prélude littéraire qui nous est apparu un peu confus) et du Fil de midi (le style s’épure et s’affirme), regroupés en français dans Le fil d’une vie, apportent quelque réconfort à celle qui n’aura ni dieu ni maître, et tonifient cet élan qui la mène sur les traces de Modesta, son alter ego romanesque. Depuis sa mansarde de la via Denza, la quête fiévreuse durera dix ans et s’intitulera L’art de la joie1. Alors qu’elle est sur le point de conclure, vient un homme qui accompagnera la volcanique Goliarda jusqu’au bout de son voyage. Angelo Maria Pellegrino croit qu’est né quelque chose qui n’existait pas. Les principaux éditeurs italiens ne partageront pas cet avis. Les refus en cascade dictent à Sapienza un geste symbolique et désespéré, qui la conduit à la grande prison des femmes au nord de Rome. Son texte d’une clairvoyance saisissante, L’Université de Rebibbia, fait revivre cette descente aux enfers parmi des prisonnières politiques et de droit commun où elle renaît à la joie. Là comme ailleurs, elle se lie aussi bien avec la prostituée futée qu’avec la jeune révolutionnaire de ces années de plomb. « La gaieté comme le pain et les larmes, défend Sapienza, doit être partagée avec tout le monde. »
Entre-temps, L’art de la joie continue de se taire au fond d’un tiroir. Sapienza, qui s’éteint en 1996, ne verra pas sa Modesta couverte d’éloges, et son histoire qualifiée de chef-d’œuvre, en France d’abord où le succès tient du phénomène. L’éditeur français Frédéric Martin, de la maison Le Tripode, a entrepris depuis peu de publier son œuvre complète, laquelle, dit-il, était incomprise parce que fragmentée. La consécration est totale puisque la maison d’édition Einaudi en fait de même. Einaudi est à l’Italie ce que la Pléiade est à la France.
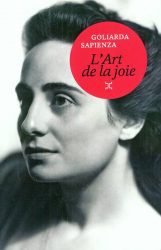 Le lectorat saura mesurer combien la joie de Sapienza est un art travaillé à l’aune de ses convictions plutôt qu’un sentiment spontané. À l’image de leur créatrice, les personnages réels ou de fiction qui habitent son œuvre, surtout L’art de la joie, bouillonnent d’ardeur, de force vitale, d’énergie brute. De contradictions aussi. Sous sa plume, ils se font si vrais qu’il suffit à l’écrivaine de convoquer le regard vigilant de Mimmo, ou la mer de Tuzzu, ou encore la taille chancelante de Béatrice, pour qu’ils soient reconnus sur-le-champ et se soudent à l’action où ils sont a priori étrangers. On peut ne pas aimer ce style osé, moderne par ses ellipses de temps et d’espace où les coutures du tissu narratif demeurent invisibles. Il faut s’y attarder pour comprendre les choix structurels de Sapienza, ce qui n’en fait pas pour autant un livre crypté. Il est tout à fait possible de lire L’art de la joie sur un mode simple, en ignorant sa portée politique, et y trouver son compte.
Le lectorat saura mesurer combien la joie de Sapienza est un art travaillé à l’aune de ses convictions plutôt qu’un sentiment spontané. À l’image de leur créatrice, les personnages réels ou de fiction qui habitent son œuvre, surtout L’art de la joie, bouillonnent d’ardeur, de force vitale, d’énergie brute. De contradictions aussi. Sous sa plume, ils se font si vrais qu’il suffit à l’écrivaine de convoquer le regard vigilant de Mimmo, ou la mer de Tuzzu, ou encore la taille chancelante de Béatrice, pour qu’ils soient reconnus sur-le-champ et se soudent à l’action où ils sont a priori étrangers. On peut ne pas aimer ce style osé, moderne par ses ellipses de temps et d’espace où les coutures du tissu narratif demeurent invisibles. Il faut s’y attarder pour comprendre les choix structurels de Sapienza, ce qui n’en fait pas pour autant un livre crypté. Il est tout à fait possible de lire L’art de la joie sur un mode simple, en ignorant sa portée politique, et y trouver son compte.
Libertaire, jamais libertine
Modesta est une enfant sauvage, impénétrable au dogme Tu ne tueras point. Sur cette pierre angulaire, Sapienza construit un personnage rare, mû d’abord par le sens de sa propre vie. Rien ni personne ne se substituera à ce désir d’aller au bout de son destin. Qui y fait obstacle sera évincé et, s’il le faut, éliminé. Se choisir ne fait pas de Modesta un être égocentrique, froid, distancié, mais une femme généreuse, forte et sensuelle. Là se trouve tout le paradoxe d’un personnage complexe, au comportement ondoyant dans une morale ambiguë, à des années-lumière des figures sacrificielles d’Emma Bovary ou, plus modernes, de Thelma et Louise. Modesta n’est pas femme à quitter la scène. Elle encaisse les coups, les digère, puis les recycle en un salutaire fertilisant existentiel.
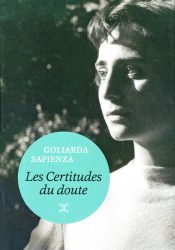 Bien que l’expression éculée ne soit pas mentionnée, Sapienza décortique la moindre courbe de la trajectoire d’une « maîtresse femme », celle que les autres femmes admirent ou envient, celle que les hommes ne peuvent que respecter tant elle est authentique et en possession de ses moyens. Ses hommes, elle les confondra l’un après l’autre par sa suavité presque perverse et l’interprétation d’un rôle social puissant, à la fois anarchiste et humaniste, dont ils ignorent le b.a. ba. Au détour, Sapienza répare les blessures du destin. Ainsi, une nuée d’enfants et de jeunes gens grouillent dans le giron familial de Modesta, mettant un baume sur la brûlure de la stérilité de Sapienza, de l’impossible maternité. Quel écart par ailleurs entre l’érotisme du roman et les échecs et interdits sexuels mis à nu dans Le fil de midi ou Les certitudes du doute.
Bien que l’expression éculée ne soit pas mentionnée, Sapienza décortique la moindre courbe de la trajectoire d’une « maîtresse femme », celle que les autres femmes admirent ou envient, celle que les hommes ne peuvent que respecter tant elle est authentique et en possession de ses moyens. Ses hommes, elle les confondra l’un après l’autre par sa suavité presque perverse et l’interprétation d’un rôle social puissant, à la fois anarchiste et humaniste, dont ils ignorent le b.a. ba. Au détour, Sapienza répare les blessures du destin. Ainsi, une nuée d’enfants et de jeunes gens grouillent dans le giron familial de Modesta, mettant un baume sur la brûlure de la stérilité de Sapienza, de l’impossible maternité. Quel écart par ailleurs entre l’érotisme du roman et les échecs et interdits sexuels mis à nu dans Le fil de midi ou Les certitudes du doute.
Qualifier L’art de la joie de roman d’apprentissage occulte l’analyse politique aussi fine que fouillée qui le sous-tend, sa toile de fond philosophique et historique, son traité de sexualité féminine. Saga et chronique de mœurs, le roman tient aussi du conte où l’enfant sauvage se voit sacrer princesse par alliance à un « mongolien », se glisse de l’extrême indigence à l’opulence, devient anarchiste et combat le fascisme, se révèle poète tout autant qu’oratrice de talent, aime hommes et femmes. Libertaire, elle étanche sa soif d’aimer à plusieurs sources et cherche le plaisir dans l’amour. Jamais ce plaisir orphelin de sentiments que convoitent les libertins. Le réalisme n’est pas toujours au rendez-vous, et c’est tant mieux. Sapienza saupoudre d’idées séditieuses ses longs (certains diront interminables) dialogues et nous entretient de fascisme, de psychanalyse, de socialisme, du dressage des petites filles, de trahisons des camarades de lutte et celles de l’histoire, de la désillusion politique. Argent, pouvoir, sexe, rien des jeux sociaux n’échappe à son regard pénétrant. Des réflexions sociopolitiques interrompent des actions proches du mélodrame. Frédéric Martin estime que ce livre a certainement influencé plus de destinées que nombre d’ouvrages de théorie politique.
Le désir dans tous ses états
Sapienza le sait, les voies du désir sont infinies. Elle les quadrille toutes : la sexualité exploratoire de l’enfance, celle initiatique de la fille pubère dans les bras d’un jeune homme bienveillant, l’union voluptueuse avec le corps-sœur, la quête éperdue de la femme « fatale », l’incandescente liaison avec l’homme mature ou celle inachevée avec un bel esprit qui laisse son corps insatisfait. Enfin l’embrassement apaisé dans les bras de l’homme d’âge mûr. Digne de la touche de Doris Lessing, dans Les grands-mères, elle chasse la pudibonderie et explore la face cachée du désir maternel. « L’amour entre mère et fils est le dernier grand drame romantique, précisément parce qu’il ne peut être consommé. »
L’air de rien, Modesta avoue être moitié fille moitié garçon, comme si elle incarnait le meilleur de l’un et l’autre sexe, sculptant ainsi un être supérieur. Sa psyché n’est pas sans rappeler celle d’Orlando, le célèbre personnage de Virginia Woolf. Utilisant une variété de pinceaux, le récit postule qu’une femme initiée aux plaisirs de la chair et de l’amour par un corps-sœur vivra une sexualité, avec homme ou femme, plus épanouie. En prime, les rapports entre les sexes, débarrassés des inévitables stéréotypes, se font plus francs, plus tendres et amoureux. Embellis sans l’ombre d’un doute. À cela, on applaudit aussi. Qui sait quel germe d’égalité grandira dans quelques têtes « dures de comprenure » ?
Les femmes d’abord

Ce que l’on soupçonne à travers l’œuvre de Sapienza se trouve entériné par son dernier compagnon : « […] le plus grand intérêt de sa vie fut pour les femmes. Elle avait avec elles un rapport très complexe, qui reste tout entier à creuser », écrit Pellegrino dans son fervent témoignage Goliarda Sapienza, telle que je l’ai connue. Les femmes, qu’elle admire, l’intimident et la déconcertent. Ainsi L’art de la joie révèle de jolis paradoxes. Modesta a la gifle allègre et paternaliste, surtout envers femmes et enfants. De-ci de-là, de vieux réflexes sexistes sourdent d’un temps ancien. Bien maligne celle qui pourrait dire si Sapienza en est consciente ou non. Sa Modesta aime les femmes précisément parce qu’elles sont des femmes. Multi-meurtrière, elle éliminera ou fera assassiner sept personnes, dont trois hommes, des chemises noires, pour d’évidentes raisons politiques. Les autres meurtres sont commis, nous explique Sapienza, par « nécessité personnelle ». Or les victimes de cette nécessité sont des femmes. L’affranchissement de Modesta s’amorce par le meurtre de sa mère de sang, puis celui d’une mère initiatrice intellectuelle. Notons que Sapienza n’écrira qu’après la mort de sa mère biologique, à la fois modèle plus grand que nature et verrou de son talent.
Si le mystère plane sur cette question, il est cependant clair qu’en littérature Sapienza déploie ce qu’elle a de plus riche à nous offrir : des expériences humaines diaprant les nôtres de mille couleurs et saveurs. Répondant au souhait de Tzvetan Todorov dans La littérature en péril, elle transmet cet héritage fragile, ces paroles qui aident à mieux vivre.
* Photo ©Fonds Goliarda Sapienza/Angelo Maria Pellegrino
1. Goliarda Sapienza, L’art de la joie, trad. de l’italien par Nathalie Castagné, Le Tripode, Paris, 2015, 600 p. ; 39,95 $.
Œuvres de Goliarda Sapienza publiées en français :
Les certitudes du doute, Le Tripode, 2015 ; L’Université de Rebibbia, Attila/Le Tripode, 2013 ; Moi, Jean Gabin, Attila/Le Tripode, 2012 ; Le fil d’une vie, Viviane Hamy, 2008 ; L’art de la joie, Viviane Hamy, 2005 et Le Tripode 2015.
À paraître au Tripode :
Deux recueils de poésie, un recueil de pièces de théâtre, un roman inédit, une correspondance, des journaux intimes.
EXTRAITS
À vingt ans je me suis débarrassée des terres parce que je ne voulais pas devenir l’employée de mon patrimoine. À trente ans je me suis débarrassée de ce mot d’artiste parce que je ne voulais pas devenir l’employée de mon talent.
L’art de la joie, p. 548.
À chaque carrefour des bonnes intentions le percepteur de la loi du profit vous attend avec une faux affamée d’or sonnant et trébuchant.
Les certitudes du doute, p. 99.
Ne le sait-on pas depuis longtemps, que la littérature peut être une panacée pour toutes les maladies de l’esprit ?
Les certitudes du doute, p. 99.
L’amour et le sexe sont enfants l’un de l’autre.
L’art de la joie, p. 267.
Désirer la guerre est déjà infléchir le futur, et pas seulement le tien, vers le malheur.
L’art de la joie, p. 600.











