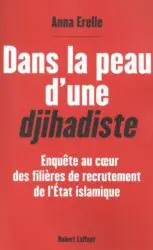Comment faire « communauté humaine » ?
Répugnante banalisation de la torture
Les carnets de Guantánamo de Mohamedou Ould Slahi
Par Laurent Laplante
Quelques rappels s’imposent pour que ressorte l’atroce déni de justice que subit depuis une quinzaine d’années Mohamedou Ould Slahi.
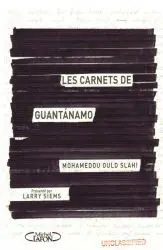 Né en Mauritanie en 1970, Slahi a maille à partir avec les États-Unis à compter de 2000. Volant du Canada vers son pays natal, il est intercepté au Sénégal, puis chez lui sur ordre des États-Unis. Après un répit, la police mauritanienne l’arrête de nouveau sur exigence étatsunienne. Expédié en Jordanie, puis à Bagram (Afghanistan), Slahi se retrouve à Guantánamo le 4 août 2002. Depuis lors, il est torturé de mille manières, harcelé par des interrogateurs qui se relaient, trompé dans ses attentes les plus légitimes, blessé dans ses convictions religieuses, sevré de contacts avec sa famille… Tout cela sans jamais être visé par une quelconque accusation. Lorsqu’un tribunal a enfin entrouvert aux avocats de Slahi la porte de l’habeas corpus en mars 2010, le gouvernement étatsunien a aussitôt porté la décision en appel, avec le résultat que Slahi est toujours à Guantánamo. Sans qu’on sache pourquoi et comme s’il s’agissait de battre le record de détention de Mandela.
Né en Mauritanie en 1970, Slahi a maille à partir avec les États-Unis à compter de 2000. Volant du Canada vers son pays natal, il est intercepté au Sénégal, puis chez lui sur ordre des États-Unis. Après un répit, la police mauritanienne l’arrête de nouveau sur exigence étatsunienne. Expédié en Jordanie, puis à Bagram (Afghanistan), Slahi se retrouve à Guantánamo le 4 août 2002. Depuis lors, il est torturé de mille manières, harcelé par des interrogateurs qui se relaient, trompé dans ses attentes les plus légitimes, blessé dans ses convictions religieuses, sevré de contacts avec sa famille… Tout cela sans jamais être visé par une quelconque accusation. Lorsqu’un tribunal a enfin entrouvert aux avocats de Slahi la porte de l’habeas corpus en mars 2010, le gouvernement étatsunien a aussitôt porté la décision en appel, avec le résultat que Slahi est toujours à Guantánamo. Sans qu’on sache pourquoi et comme s’il s’agissait de battre le record de détention de Mandela.
Caviardage
Slahi revendique la paternité des Carnets de Guantánamo1 lors d’une audience tenue le 15 décembre 2005 devant l’Administrative Review Board, à Guantánamo : « Je voudrais signaler que j’ai récemment écrit un livre ici, en détention, qui retrace toute mon histoire. Je l’ai envoyé au district de Columbia pour qu’il soit rendu public ». Le manuscrit, qui compte 466 pages et que Larry Siems a resserré un peu, n’a pas connu le parcours que souhaitait le détenu. Ce n’est qu’en 2012, c’est-à-dire après dix ans de détention ininterrompue, que Slahi reçut l’autorisation de publier. Le manuscrit dormait depuis sept ans. Un bémol s’impose : le texte publié est affligé de 2600 gestes de caviardage. Selon Le Grand Robert, passer au caviar signifie ceci : « Noircir à l’encre certains passages d’un écrit pour les rendre indéchiffrables. (Allusion au procédé appliqué par la censure russe, sous Nicolas 1er et certains de ses successeurs aux passages jugés indésirables dans les publications étrangères, à leur entrée dans l’empire.) ». Mission accomplie pour les censeurs : le décryptage est difficile.
Parmi les questions posées par Slahi à ses geôliers, il y a, bien sûr, celle, récurrente, par laquelle il demande quelles accusations pèsent contre lui ; à ce jour, écrit Siems, aucune réponse n’a été offerte. Par ailleurs, jamais Siems n’a été autorisé à rencontrer Slahi.
Complices d’accord ?
Le responsable principal, pour ne pas dire unique, des malheurs de Slahi est Washington. « Parti pour rentrer chez lui, écrit Siems, il se retrouvera abandonné sur une île des Caraïbes, à six mille cinq cents kilomètres des siens. Avant d’en arriver là, il sera emprisonné et interrogé dans quatre pays, souvent avec la participation des Américains, et toujours sur ordre de ces derniers. » La servilité des gouvernements intimidés par Washington est nette, bien que Slahi soit surtout déçu de son propre gouvernement. Les Jordaniens, mis à contribution en raison de leur science reconnue de la torture (!), s’étonneront pourtant de ne jamais recevoir des États-Unis les preuves incriminant Slahi. L’attitude des Afghans va dans le même sens. Dans chaque cas, les Américains exigent l’obéissance, sans justifier leur conduite : la force, à leurs yeux, prime le droit. Quand, enfin, Slahi aboutit à Guantánamo au terme de son laborieux tour du monde, il est déjà amoché. D’accord ou non, les vassaux de Washington ont collaboré à la barbarie.
Quels droits et quelle dignité ?
Guantánamo incarne ce que l’on peut concevoir de pire comme parodie de la société de droit. Au cours de la campagne électorale qui lui a valu son premier mandat présidentiel, Obama avait si bien saisi l’arbitraire et la cruauté des limbes de Guantánamo qu’il s’était solennellement engagé à liquider ce pénitencier dès la première année de son règne. Sept ans plus tard, les circonvolutions légales se perpétuent et l’abcès attend toujours la lancette. On répète pourtant aux États-Unis que justice delayed is justice denied. Donald Rumsfeld, qui a autorisé par écrit le recours à la torture, n’a jamais eu à répondre de sa coupable gestion de la Justice. Année après année, les avocats du gouvernement ont usé de mesures dilatoires pour occulter les sévices, escamoter l’horreur et empêcher l’identification des sadiques et des tortionnaires. Des médecins, des psychologues, des psychiatres ont aidé à doter Guantánamo de techniques minutieusement cruelles. À peine a-t-on entendu certains ordres professionnels rappeler leurs membres aux exigences éthiques de leur travail. Tout se passe comme si le gouvernement étatsunien s’efforçait de rendre un maximum d’États et de métiers aussi coupables que lui. Un sidéen multipliant les aventures susceptibles de contaminer ses partenaires à leur insu ne se conduirait pas plus mal. Le professeur ès démocratie répand la tyrannie et l’État de droit bafoue ses lois.
Dimension religieuse
Tout lecteur de Slahi percevra l’importance qu’a sa foi pour lui. Au creux de son martyre, Slahi se récite ou lit le Coran. Du fond de ses exils successifs, il tente d’orienter ses prières vers la Mecque. Loin d’émouvoir ses tortionnaires, ce souci leur suggère un autre moyen de l’écraser de mépris : « […] dès que je commençai à prier, XXXXX se moqua aussitôt de ma religion, et je me résignai à prier dans mon cœur, afin de ne pas lui donner l’occasion de blasphémer. Rire de la religion d’autrui est un des actes les plus barbares qui soient ». Quand ses geôliers apprennent que sa foi lui interdit les contacts sexuels hors mariage, ils le livrent aux moqueuses turpitudes de femmes dénudées. Aux abus de force s’ajoutent les sadiques raffinements du mépris.
Slahi est-il crédible ? La persistante absence d’accusations oblige à le penser. Chose certaine, il est émouvant.
1. Mohamedou Ould Slahi, Les carnets de Guantánamo, trad. de l’anglais par Éric Betsch et présentés par Larry Siems, Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 2015, 448 p. ; 29,95 $.
EXTRAITS
Les interrogatoires se durcirent nettement avec le temps, les responsables de GTMO enfreignant – comme vous le découvrirez – tous les fondements sur lesquels étaient bâtis les États-Unis, ainsi que les principes élémentaires, tels que celui-ci, énoncé par Benjamin Franklin : « Les individus prêts à sacrifier une liberté essentielle afin d’obtenir un peu de sécurité temporaire ne méritent ni l’une ni l’autre ».
p. 95
S’il y a de quoi justifier la détention, alors vous devez pouvoir faire appel à un avocat professionnel. Dans le cas contraire, eh bien on n’aurait même pas dû vous interpeller pour commencer. C’est ainsi que fonctionne le monde civilisé, et toute autre façon de faire est une dictature. La dictature est gouvernée par le chaos.
p. 150
L’ironie, c’est que j’ai vécu douze ans en Allemagne et que les Allemands n’ont jamais fourni aucun détail compromettant à mon sujet, ce qui ne reflétait que la vérité. Alors que je suis resté à peine deux mois au Canada, les Américains ont par la suite assuré que les Canadiens leur avaient transmis des tonnes d’informations sur moi.
p. 153
Rire de la religion d’autrui est un des actes les plus barbares qui soient. Le président Bush a décrit sa guerre sainte contre le prétendu terrorisme comme une guerre entre le monde civilisé et le monde barbare, pourtant son gouvernement a commis davantage d’actes barbares que les terroristes.
p. 300
Collectif Nous sommes Charlie
Par Laurent Laplante
La tuerie du 7 janvier 2015 date de plusieurs mois, mais elle n’a encore déposé dans son sillage sanglant que peu de clarté. D’une part, la société nie avec justesse que le meurtre soit une protestation légitime même contre l’humour grinçant ; d’autre part, malgré l’apparent consensus de ses défenseurs, la liberté d’expression change de sens d’une personne à l’autre. Le collectif signé par 60 écrivains témoigne de ce paradoxe.
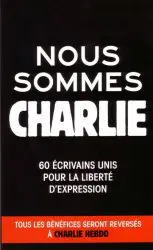 Les plumes mises à contribution dans Nous sommes Charlie, 60 écrivains unis pour la liberté d’expression ne présentent pas toujours, loin de là, des vues pénétrantes. Jacques Attali, péremptoire, affirme qu’« il appartient d’abord, immédiatement, au président de la République de proposer un plan d’action majeur. C’est aussi à la représentation nationale d’en débattre et de le voter ». Comme si les textes avaient force magique. Noëlle Châtelet, dans sa « Lettre à Voltaire », déclare que « la tolérance est encore mise à mal dans notre pays », sans soupçonner que la tolérance était et demeure une façon altière de se soustraire au pluralisme. André Comte-Sponville frappe plus juste en souhaitant que s’actualise l’Écrasons l’infâme ! de Voltaire et que LE fanatisme moderne en soit la cible ; il ne semble pas entrevoir qu’existent plusieurs fanatismes. Pontifiant et verbeux (malgré sa magnifique écriture), Bernard-Henri Lévy décrit la manifestation du 11 janvier comme « un de ces moments de grâce, un de ces souvenirs métapolitiques comme les grands peuples en connaissent parfois », ne ratant évidemment pas l’occasion de pavoiser au mauvais moment. Dans la même veine, Patrick Poivre d’Arvor auréole les journalistes tués : « Il fallait les prendre tels qu’ils étaient, il faut nous prendre tels que nous sommes, pétris de contradictions mais si français ». On a beau juger les assassinats du 7 janvier infiniment détestables, un certain courant hexagonal s’accorde l’absolution un peu rapidement.
Les plumes mises à contribution dans Nous sommes Charlie, 60 écrivains unis pour la liberté d’expression ne présentent pas toujours, loin de là, des vues pénétrantes. Jacques Attali, péremptoire, affirme qu’« il appartient d’abord, immédiatement, au président de la République de proposer un plan d’action majeur. C’est aussi à la représentation nationale d’en débattre et de le voter ». Comme si les textes avaient force magique. Noëlle Châtelet, dans sa « Lettre à Voltaire », déclare que « la tolérance est encore mise à mal dans notre pays », sans soupçonner que la tolérance était et demeure une façon altière de se soustraire au pluralisme. André Comte-Sponville frappe plus juste en souhaitant que s’actualise l’Écrasons l’infâme ! de Voltaire et que LE fanatisme moderne en soit la cible ; il ne semble pas entrevoir qu’existent plusieurs fanatismes. Pontifiant et verbeux (malgré sa magnifique écriture), Bernard-Henri Lévy décrit la manifestation du 11 janvier comme « un de ces moments de grâce, un de ces souvenirs métapolitiques comme les grands peuples en connaissent parfois », ne ratant évidemment pas l’occasion de pavoiser au mauvais moment. Dans la même veine, Patrick Poivre d’Arvor auréole les journalistes tués : « Il fallait les prendre tels qu’ils étaient, il faut nous prendre tels que nous sommes, pétris de contradictions mais si français ». On a beau juger les assassinats du 7 janvier infiniment détestables, un certain courant hexagonal s’accorde l’absolution un peu rapidement.
Heureusement, certains textes font mieux. Philippe Claudel écrit : « J’ai lu et entendu qu’ils étaient des monstres. Je ne suis pas d’accord. Leurs actes sont monstrueux, en ce sens qu’ils n’ont rien d’un comportement humainement acceptable. Mais ces actes ont été commis par des hommes, des hommes qui sont nés et ont grandi dans une société qui est la nôtre, que nous avons façonnée. En quelque sorte, ils sont nous, et nous sommes eux ». Autrement dit, si « nous sommes Charlie », peut-être sommes-nous également parents des coupables. Anne Nivat va dans le même sens : « Depuis quelque temps, j’avais été stupéfaite, voire blessée, d’entendre des voix amies s’élever, affirmant ne pas comprendre pourquoi je continuais à donner la parole à l’autre, à celui qui fait peur, au ‘méchant’, au ‘barbare’, au ‘djihadiste’, ‘taliban’ ou ‘combattant de l’islam’ ». Ainsi se trouve dénoncé un rejet rarement perçu et auquel répond, exorbitante et inadmissible, la haine des trois terroristes français.
Vanter Voltaire, Hugo et Zola s’imposait, à condition de ne pas oublier qu’ils furent des exceptions.
1. Collectif, Nous sommes Charlie, 60 écrivains unis pour la liberté d’expression, Le Livre de poche, Paris, 2015, 166 p. ; 8,95 $.
Dans la peau d’une djihadiste d’Anna Erelle
Par Yvan Cliche
C’est une bien singulière épopée que nous raconte Anna Erelle dans ce livre1 en forme de long reportage sur les efforts de recrutement en France du groupe terroriste État islamique.
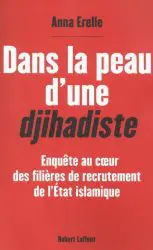 Anna Erelle est en fait un nom fictif, car l’auteure doit protéger son identité en raison de craintes de représailles de sympathisants de l’organisation islamiste. Qu’a-t-elle fait de si répréhensible ? Au départ, la journaliste pigiste de 30 ans s’intéresse au sort des familles ayant perdu un enfant parti faire le djihad en Syrie. De fil en aiguille, elle en vient à entrer elle-même en communication, via Skype, avec un djihadiste d’origine française, établi en Syrie. Pour construire avec lui un rapport de confiance et en tirer un maximum de renseignements en vue d’un reportage sur l’État islamique et sur son fonctionnement, elle se fait passer pour Mélanie, 20 ans, Parisienne convertie à l’islam dur, qui porte le voile en cachette de sa mère.
Anna Erelle est en fait un nom fictif, car l’auteure doit protéger son identité en raison de craintes de représailles de sympathisants de l’organisation islamiste. Qu’a-t-elle fait de si répréhensible ? Au départ, la journaliste pigiste de 30 ans s’intéresse au sort des familles ayant perdu un enfant parti faire le djihad en Syrie. De fil en aiguille, elle en vient à entrer elle-même en communication, via Skype, avec un djihadiste d’origine française, établi en Syrie. Pour construire avec lui un rapport de confiance et en tirer un maximum de renseignements en vue d’un reportage sur l’État islamique et sur son fonctionnement, elle se fait passer pour Mélanie, 20 ans, Parisienne convertie à l’islam dur, qui porte le voile en cachette de sa mère.
L’homme avec qui elle parle est un certain Bilel, Français musulman de 38 ans depuis longtemps sur le terrain en Irak et en Syrie, dont le travail est de faire le djihad et d’assassiner des mécréants. Au fil des échanges, Anna/Mélanie comprend que cet individu est en fait un haut gradé lié au « calife » Al Baghdadi, grand timonier de l’État islamique.
Le livre est essentiellement un compte-rendu de ces échanges, enregistrés et mis en images secrètement par un photographe de l’agence où travaille Anna.
Ce Bilel apparaît comme un individu fort malsain, qui se dit célibataire et qui « marie » Mélanie après seulement deux jours de discussions avec elle. Il lui promet une belle vie à soigner les combattants djihadistes, mais en insistant continuellement auprès d’elle sur le port obligatoire du niqab. Une Mélanie bien sûr vierge, qui pourra s’offrir à son futur mari avec des sous-vêtements sexy qu’elle devra ramener de Paris avant son départ vers la Syrie.
Mélanie poursuit son stratagème jusqu’à se rendre réellement à Amsterdam, prétendument en escale sur sa route pour rejoindre Bilel. Mais le plan, soit celui de voir et de photographier en Turquie les passeurs de djihadistes occidentaux vers le front syrien échoue, et Anna/Mélanie retourne à Paris. Comme on s’en doute, Bilel découvre qu’il a été roulé et entre dans une colère noire contre Mélanie, à qui il envoie des messages de haine. Anna devra donc se cacher, pour éviter de possibles représailles. Une crainte rapidement atténuée par le fait que Bilal serait, selon toute vraisemblance, décédé dans une embuscade en Irak peu de temps après avoir subi cette supercherie.
À la fin du livre, on apprend sans surprise que Bilal était un petit voyou en France, qu’il aurait finalement trois épouses et des enfants qui déjà se battent au front. Un individu animé, et ce n’est encore pas une surprise, par des sentiments érotiques entremêlés d’un violent désir de pureté inspiré par un islam rigoriste et sans pitié.
Donc, une enquête intéressante au cœur des réseaux intégristes. Un seul bémol : au reportage se mêlent les états d’âme un peu adolescents de l’auteure, sentiments intimes qui selon moi font de l’ombre à l’enquête. Celle-ci aurait dû obtenir toute la place tant ce sujet est d’actualité.
1. Anna Erelle, Dans la peau d’une djihadiste, Enquête au cœur des filières de recrutement de l’état islamique, Robert Laffont, Paris, 2015, 262 p. ; 24,95 $.
Géopolitique des islamismes d’Anne-Clémentine Larroque
Par Yvan Cliche
Depuis les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, plusieurs se sont mis à interroger plus directement les préceptes de la religion islamique, mais surtout son interprétation radicale, l’intégrisme violent.
 Mais pour le néophyte qui souhaite en toute objectivité appréhender avec rigueur ce phénomène, l’effort peut être rapidement découragé par la multiplication des approches et des termes collés à cette mouvance (islamisme, salafisme, radicalisme islamiste, wahhabisme, etc.), sans compter les distinguos obligés entre le sunnisme et le chiisme, les deux principales branches de l’islam.
Mais pour le néophyte qui souhaite en toute objectivité appréhender avec rigueur ce phénomène, l’effort peut être rapidement découragé par la multiplication des approches et des termes collés à cette mouvance (islamisme, salafisme, radicalisme islamiste, wahhabisme, etc.), sans compter les distinguos obligés entre le sunnisme et le chiisme, les deux principales branches de l’islam.
Le livre1 d’Anne-Clémentine Larroque, maître de conférences à Sciences Po (Paris), est une introduction au sujet qui permet fort heureusement de contourner ces difficultés. Pour l’experte, « l’islamisme s’impose comme alternative politique à la vision occidentale de l’État importée par les colonisateurs ». Mais cette idéologie ne se déploie pas de manière homogène : il y a les mouvements politiques, les missions de conversion et la lutte armée, violente.
Le tronc commun est un « fondamentalisme puritain » visant à renforcer l’ordre moral de la communauté. L’auteure s’attarde avec raison sur l’organisation des Frères musulmans, née en Égypte il y a cent ans, l’entité la plus structurée faisant la promotion de l’islamisme dans le monde arabe. Cette organisation a deux objectifs : instaurer la charia (loi islamique) comme source de législation et islamiser les institutions politiques et culturelles. Une islamisation, donc, par le haut, par le moyen de la politique, et par le bas, par l’œuvre missionnaire, l’action de terrain.
Depuis le 11 septembre 2001, poursuit l’auteure, on assiste à la fragmentation de l’islamisme, avec l’apparition de nouvelles mouvances, cette fois territoriales : Afrique du Nord, Irak, Syrie, avec des actions de plus en plus violentes relayées par les médias sociaux.
L’auteure en arrive à la conclusion redoutable que, si l’islamisme politique a en partie échoué, car il n’a pas pris le pouvoir dans l’ensemble des États arabes, l’islamisme social a progressé, comme on le constate notamment par le port, plus répandu que jamais, du voile dans le monde musulman.
Enfin, petite erreur à corriger lors d’une prochaine édition : page 27, Sayyid Qutb, le penseur du radicalisme islamique, est un intellectuel égyptien, et non d’origine saoudienne.
1. Anne-Clémentine Larroque, Géopolitique des islamismes, Presses Universitaires de France, Paris, 2014, 126 p. ; 16,95 $.