Depuis Whisky et paraboles en 2005, Roxanne Bouchard mène une triple vie. Professeure de niveau collégial, elle s’évertue à faire tomber ses étudiants amoureux de la littérature québécoise.
Fervente correspondante depuis longtemps, elle a publié En terrain miné, un échange de lettres reconstituées et enrichies avec le caporal Patrick Kègle, dont on a beaucoup parlé. Romancière, son registre balance avec bonheur entre la légèreté et la gravité. Rencontre avec une écrivaine qui prend l’engagement et le rire au sérieux.
Roxanne Bouchard : Ma famille m’a transmis assez vite merci le sens de l’autodérision. Pour moi, l’humour, c’est sacré. Pas celui des humoristes, plutôt l’humour au quotidien, celui qui permet de désamorcer les problèmes et, à partir de là, de trouver des solutions. Il n’y a pas assez d’humour dans la littérature actuelle au Québec et j’ai envie de travailler cette veine-là. Par exemple, dans Crématorium Circus, j’ai emprunté au genre du carnavalesque dans lequel on rit des autorités, de ce qui est sérieux, on tourne la hiérarchie à l’envers, à la bouffonnade.
Linda Amyot : Même la mort ?
R. B. : Je n’ai pas ironisé sur la mort, mais j’ai voulu me moquer gentiment de certains rituels funéraires un peu trop prétentieux. C’est pour ça que, dans mon roman, les morts semblent moins importants que l’occasion de faire un party pour épater la galerie. L’humour n’exclut donc pas le sérieux, mais quand je m’embarque dans des projets comme Crématorium Circus, de la série L’Orphéon, je le fais pour avoir du fun.
Y a-t-il une Roxanne Bouchard sérieuse et une Roxanne Bouchard qui tourne tout à la rigolade ?
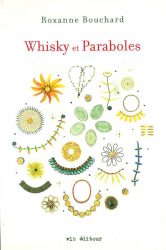 R. B. : Whisky et paraboles, Nous étions le sel de la mer et En terrain miné sont beaucoup plus intimes, plus proches de ce que je suis. Il y a une part de poésie, du moins je l’espère, dans ces livres-là. Il y a aussi une part d’étude : qui sommes-nous, les Québécois, qui sont les musiciens, les pêcheurs, les militaires, comment sont-ils en amour, avec leur famille ? Quand on m’offre des projets comme La gifle ou L’Orphéon, je n’ai pas envie de faire autant de recherches, je peux juste m’amuser. Il n’est pas toujours nécessaire de vouloir toujours faire de la grande littérature. Écrire, lire, ça peut aussi être drôle, un loisir, un divertissement. Un livre comme La gifle devrait juste permettre au lecteur de passer un bon moment, de rigoler avant de le laisser sur un banc d’autobus ou dans un café pour qu’un autre s’en empare et passe un bon moment à son tour.
R. B. : Whisky et paraboles, Nous étions le sel de la mer et En terrain miné sont beaucoup plus intimes, plus proches de ce que je suis. Il y a une part de poésie, du moins je l’espère, dans ces livres-là. Il y a aussi une part d’étude : qui sommes-nous, les Québécois, qui sont les musiciens, les pêcheurs, les militaires, comment sont-ils en amour, avec leur famille ? Quand on m’offre des projets comme La gifle ou L’Orphéon, je n’ai pas envie de faire autant de recherches, je peux juste m’amuser. Il n’est pas toujours nécessaire de vouloir toujours faire de la grande littérature. Écrire, lire, ça peut aussi être drôle, un loisir, un divertissement. Un livre comme La gifle devrait juste permettre au lecteur de passer un bon moment, de rigoler avant de le laisser sur un banc d’autobus ou dans un café pour qu’un autre s’en empare et passe un bon moment à son tour.
Et on passe effectivement un très bon moment en se demandant où l’auteure est allée chercher ça.
R. B. : Quand j’ai commencé à écrire ce livre, j’examinais ma main en train de donner une gifle et je décortiquais le geste… C’est une blague, une fantaisie, ce livre-là. Je n’en revenais d’ailleurs pas quand les critiques en ont parlé. Je me disais : « Ben, voyons donc, ils prennent ben ça au sérieux ! »
Croyez-vous que c’est parce qu’on a besoin, à l’instar d’une bonne comédie de qualité comme La grande séduction, d’avoir des œuvres humoristiques de qualité en littérature ?
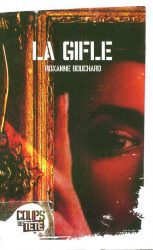 R. B. : Mon ami Louis Cornellier m’a suggéré d’adapter La gifle pour la scène en disant justement qu’on a besoin de théâtre d’été de qualité. J’aime beaucoup écrire des dialogues, mais je ne suis pas une dramaturge… Par contre, c’est vrai que j’aime créer des textes humoristiques ! Michel Vézina m’avait demandé si un jour j’allais écrire un autre roman dans le genre de La gifle. Je m’étais dit que je ferais quelque chose sur le cirque qui s’intitulerait : Qui a tué l’homme-canon ? Je pensais à une enquête policière sérieuse dans l’univers circassien. Finalement, c’est devenu le délire de Crématorium Circus. On dirait que j’ai besoin, à tous les deux livres, d’écrire un truc loufoque !
R. B. : Mon ami Louis Cornellier m’a suggéré d’adapter La gifle pour la scène en disant justement qu’on a besoin de théâtre d’été de qualité. J’aime beaucoup écrire des dialogues, mais je ne suis pas une dramaturge… Par contre, c’est vrai que j’aime créer des textes humoristiques ! Michel Vézina m’avait demandé si un jour j’allais écrire un autre roman dans le genre de La gifle. Je m’étais dit que je ferais quelque chose sur le cirque qui s’intitulerait : Qui a tué l’homme-canon ? Je pensais à une enquête policière sérieuse dans l’univers circassien. Finalement, c’est devenu le délire de Crématorium Circus. On dirait que j’ai besoin, à tous les deux livres, d’écrire un truc loufoque !
Tout en respectant le genre ?
R. B. : Exactement. Crématorium Circus est un roman de genre inspiré des codes du burlesque. Contrairement à d’autres, je ne crois pas qu’il faille nécessairement s’inspirer de nos propres expériences pour écrire, qu’il faille avoir vécu quelque chose pour en parler. Je ne suis pas allée à la guerre, je ne suis pas pêcheuse, je n’ai pas 70 ans comme certains de mes personnages… L’écriture, c’est la maîtrise d’un art, pas d’une expérience de vie. Récemment, j’ai publié une nouvelle dans le recueil érotique Nu. J’ai écrit, selon des consignes imposées, une nouvelle érotique très loin de ma réalité personnelle, en respectant les paramètres du collectif. (Mais, en fait, je pense que j’ai plutôt écrit une nouvelle humoristique dans laquelle il y a de l’érotisme…)
Comment sont nées vos œuvres plus personnelles ?
R. B. : Quand j’ai écrit Whisky et paraboles, il y a déjà une dizaine d’années, je fréquentais beaucoup le milieu « trad ». Mon amoureux d’alors était membre de La bottine souriante, je correspondais très régulièrement avec mon ami Fred Pellerin. Un de mes correspondants, un dramaturge belge, m’avait mis au défi d’écrire un roman. J’ai d’abord pensé l’écrire sous forme de lettres, puisque la correspondance était mon genre littéraire. Puis, c’est devenu le journal intime d’Élie. En même temps, jeune prof de 22 ans, je ne jurais à ce moment-là que par la littérature française jusqu’à ce qu’un jour je reçoive Betsi Larousse, le roman de Louis Hamelin. Dès les premières lignes de cette histoire d’amour déjantée, qui commence au Festival western de Saint-Tite, je suis tombée en bas de ma chaise tellement je trouvais ça fort ! À partir de là, j’ai relu la littérature québécoise autrement et voracement. Dans Whisky et paraboles, j’ai intégré une cinquantaine de citations extraites de différentes œuvres de la littérature québécoise. Le roman est né dans ce contexte et, quand je dis qu’il est proche de moi, c’est au sens où la démarche de la narratrice en quête d’un ancrage reflète la mienne. Ce livre-là symbolise ma réappropriation de notre littérature, de notre culture.
Alors, vous avez eu l’idée de le soumettre au prix Robert-Cliche ?
R. B. : Pantoute ! C’est un de mes amis qui, me voyant déprimée après ma rupture amoureuse, m’a littéralement forcée à l’envoyer. Je n’ai jamais pensé que je le gagnerais ! Quand j’ai reçu l’appel, j’ai cru que c’était une blague et j’ai répondu une niaiserie du genre : « Ça adonne bien, faut que je me rachète des électroménagers ! »
Les personnages sont nés comment ? Le personnage d’Agnès, la petite qu’Élie finit par adopter, par exemple ?
R. B. : Je ne sais pas trop. Je n’ai pas d’enfant, mais il y a plusieurs adoptés dans ma famille. J’ai d’ailleurs appris, après sa mort, que mon grand-père Bouchard a été adopté ; ce secret a fortement marqué mon imaginaire. Mais, en même temps, l’adoption, dans le roman, est métaphorique ; c’est plutôt, pour moi, une histoire d’ancrage dans la littérature, dans la culture, de la société à laquelle j’appartiens. Pour ce premier roman, je voulais trouver des symboles forts, un peu trop peut-être. Je ne fais plus de personnages métaphoriques maintenant.
Donc, vous êtes partie d’une idée, d’un thème ?
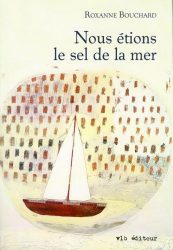 R. B. : Je pars toujours d’un thème, un pivot central qui reste mon phare tout au long de la construction du roman, de sa structure, de la création des personnages qui peuvent changer en cours de route selon les besoins. Pour Whisky et paraboles, c’était le pardon. Se pardonner à soi-même afin d’aller de l’avant, s’adopter soi-même. Pour Nous étions le sel de la mer, c’est le mensonge. Il y a des mensonges socialement acceptables : les histoires de pêche, les souvenirs d’enfance magnifiés. Et à côté de ça, il y a des mensonges destructeurs ou inacceptables. J’ai voulu mettre en scène un village de pêcheurs en Gaspésie où tout le monde se ment à soi-même et aux autres à propos d’une femme et où, en même temps, certains personnages recherchent la vérité.
R. B. : Je pars toujours d’un thème, un pivot central qui reste mon phare tout au long de la construction du roman, de sa structure, de la création des personnages qui peuvent changer en cours de route selon les besoins. Pour Whisky et paraboles, c’était le pardon. Se pardonner à soi-même afin d’aller de l’avant, s’adopter soi-même. Pour Nous étions le sel de la mer, c’est le mensonge. Il y a des mensonges socialement acceptables : les histoires de pêche, les souvenirs d’enfance magnifiés. Et à côté de ça, il y a des mensonges destructeurs ou inacceptables. J’ai voulu mettre en scène un village de pêcheurs en Gaspésie où tout le monde se ment à soi-même et aux autres à propos d’une femme et où, en même temps, certains personnages recherchent la vérité.
Le personnage de Marie Garant est assez particulier ?
R. B. : J’ai fait beaucoup de voile pendant plusieurs années. J’ai pris des cours de navigation, de mécanique. J’ai navigué en Gaspésie, dans les Caraïbes, j’ai fait de la régate. J’ai embarqué sur 36 bateaux différents… Je rêvais de partir en solitaire puis… j’ai découvert que l’amour était aussi une belle aventure ! Quatre-vingt pour cent des gens qui font de la voile sont des hommes. Alors, imaginer une femme qui navigue en solitaire comme Marie Garant, ça me permettait de mettre en scène un fantasme marin. Et comme elle est morte, elle devient un personnage mythique qui peut donner lieu au mensonge.
Il y a une enquête policière dans Nous étions le sel de la mer ; est-ce que ça vous a donné le goût de continuer à explorer ce genre ?
R. B. : Ça ne me tente pas de faire uniquement un roman policier ou un roman d’amour. J’aime le mélange des genres. Ça permet plus de latitude. Et puis j’aime bien mon personnage d’enquêteur. Je trouve ça le fun les gars de 52 ans qui rêvent encore d’amour ! Ce n’est pas juste aux femmes d’être amoureuses ! Mon chum, mon père sont de grands amoureux. J’aurais peut-être le goût d’écrire un autre roman avec mon policier ou ce même type de personnage.
Vous l’avez déjà fait avec le personnage de Gonores Minella, qui était déjà dans La gifle et qu’on retrouve dans Crématorium Circus.
R.B. : C’était le personnage idéal ! Une bonne grosse madame catho qui se mêle de tout !
Quel est votre prochain défi d’écriture ?
R. B. : Depuis un an, je travaille à un projet de docu-fiction qui se passe à l’été 2009 à Kandahar, en Afghanistan. Je travaille à partir d’entrevues et de correspondances avec des militaires de différents corps de métier de la base Valcartier.
C’est donc un projet qui nécessite beaucoup de recherches ; est-ce que tous vos ouvrages en ont exigé autant ?
R. B. : Pour ce projet, je suis aussi allée en exercices avec les militaires afin de mieux comprendre ce qu’ils vivent sur le terrain. Pour En terrain miné, j’ai dû reconstituer la majeure partie de la correspondance, car il restait peut-être une trentaine de lettres. Pour Nous étions le sel de la mer, j’ai fait beaucoup de recherches sur la pêche ; je suis allée en haute mer avec des pêcheurs gaspésiens et amérindiens, j’ai recueilli des anecdotes, des expressions, j’ai lu des documents encyclopédiques. Pour Crématorium Circus, j’ai étudié le genre du carnavalesque, le milieu du cirque, des entreprises funéraires. J’aime apprendre, c’est une grande motivation pour moi. Ma mère était enseignante, alors… J’aime mettre en scène des univers qui existent au Québec, mais dont on parle peu ou qu’on juge… comme les militaires ! Le métier d’écrivain, c’est l’art de reconstruire un univers avec les mots. Alors, pourquoi pas choisir un univers inconnu à découvrir.
EXTRAITS
– Ma femme est vierge ?!!!
Foudroyante, la mariée se tourne, enragée, et, d’un geste sec, gracieux et fier, lui claque la joue de toutes ses forces. Un mouvement parfait, souple et élancé, que personne n’avait vu venir. Splendide. Elle le gifle d’un violent revers de la gauche. Paf ! Et le diamant de son alliance entaille la joue de Victor Orena d’une petite griffure sanglante.
– Comment oses-tu hurler ça devant tout le monde ?!
Victor Orena s’en fiche. Il lance un cri de joie :
– Champagne pour tous !
La gifle, p. 106.
– Vous n’aimiez pas Marie Garant…
– C’est pas moi en particulier ; elle était pas aimée en général, Marie Garant. Mais c’était pas une raison pour qu’on veuille la voir morte ! Je voudrais pas que vous pensiez des affaires ! Moi, je l’ai juste ramassée. À son âge, ça vaut pu la peine de demander sa mort. Pis, à mon âge, saint-ciboire de câlisse, on a appris à pas tuer. On sait que la mort va arriver toute seule. Mais faut pas s’en faire avec ça : une vieille qui s’est noyée en tombant de son voilier, ça vous fera pas une grosse enquête. Pour le reste, c’est mort et enterré.
– Qu’est-ce qui est mort et enterré ?
– Rien.
– Racontez-moi quand même…
Nous étions le sel de la mer, p. 87.
Vous, vous êtes moderne et authentique. Vous exigez l’excellence, l’originalité, le luxe. Alors venez, dès aujourd’hui, au Phénix crématorium (ISO 9004) et planifiez des pré-arrangements haut de gamme hors de prix ! Venez vivre l’expérience Phénix.
Vous ne serez pas déçu !
Vos invités gémiront : « Quelle façon sexy de mourir ! », s’extasieront : « Quelle classe ! », s’enflammeront : « Il aurait dû mourir plus souvent ! »
Au Phénix crématorium (ISO 9004), vous ressusciterez d’entre vos cendres !
Crématorium Circus, p. 128.
– La liste d’école d’la petite ? Vous pouvez la garder : j’ai pas une cenne pour ça !
La porte s’est refermée sur mon nez et je n’ai pu attraper que les yeux d’eau d’Amorosa. Il ne m’est resté que ça coincé là, mais c’était tellement ça que j’ai su, tout à coup, que j’avais, du moins pour aujourd’hui, un peu de réponse en moi et du vide est monté plus qu’un écho et plus que du silence et j’ai recogné à la porte instantanément, mue par ça qui savait plus que moi que je répondais à quelque chose et que, pour une fois depuis longtemps, j’avais envie de défier la bouderie du monde, d’affronter l’effronterie et l’affreuse et de faire entendre ce que j’avais d’humain à partager. La contrariété a ouvert la porte avec de l’impatience à pleins soupirs et, avant qu’elle m’envoie le « Quoi encore ! » de l’écœurement, j’ai attaqué.
– Dans ce cas, verriez-vous un inconvénient à ce que j’emmène Agnès acheter toutes ces fournitures scolaires au village ? À mes frais, bien sûr…
Agnès regardait tellement par terre qu’elle allait sûrement creuser un trou dans le plancher sous peu.
Whisky et paraboles, p. 48.











