« D’abord derrière les roses il n’y a pas de singes
Il y a un enfant qui a les yeux tourmentés. »
Georges Schehadé
Sans doute faut-il attendre d’être en pleine possession de ses moyens d’écrivain avant d’entreprendre d’écrire sur ses père et mère. Avoir amorcé le renversement des rôles, être à son tour devenu parent, permet sans doute de poser un regard à la fois juste et renouvelé sur l’image, réelle ou sur celle que l’on s’est forgée au fil des ans, de ses parents.
Oser même porter ce regard qui interroge notre empreinte et la révèle sans fard nécessite du recul. Et du temps qui, avec la distance, peut nous dévoiler la véritable nature de ces personnes jusque-là réduites, circonscrites, enfermées dans leur rôle de parent, comme nous l’étions dans notre rôle filial. Et soudain, la figure parentale qui hier, aux yeux de l’enfant, incarnait la force et le pouvoir d’attraction, suscitait tout à la fois l’admiration et le respect, commandait l’obéissance et le désir d’affranchissement, montre aujourd’hui sa fragilité. Cette fragilité fait soudainement écho à notre propre vulnérabilité, en dessine les contours sous un jour familier qui nous fait parfois douter de ce que l’on croit être notre caractère propre, unique. Le miroir qu’on nous tend dérange. Un nouveau cycle s’amorce, le temps de l’écriture est venu.
Chacun à sa façon, Robert Lalonde et Michael Delisle, dans des récits à la fois empreints d’affection et d’amour, tout autant que teintés d’humour, dans une démarche avant tout littéraire, remontent le fil du temps filial pour se retrouver avant le temps de l’écriture, au moment où la parole, encore hésitante, cherche une voie qui bientôt permettra au trop-plein qui ne cesse de s’accumuler de se déverser. Une voie qui à son tour creusera ses propres sillons, dessinera ses empreintes temporelles dans l’espace de liberté que chaque livre concrétisera. Peut-être faut-il attendre que l’écriture, comme la voix, mue avant de s’attaquer à semblable projet…
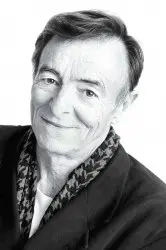
C’est le cœur qui meurt en dernier1 fait en quelque sorte écho au Fou du père, roman dans lequel Robert Lalonde interrogeait l’image du père, le poids de son héritage. Le présent récit nous révèle cette fois, dans une succession de souvenirs où se ravivent les images d’une vie, le portrait de la mère. Le récit se décline en une série de scènes dans lesquelles la mère et le fils confrontent leurs souvenirs, retracent les mêmes événements maintes fois évoqués et qui ne cessent pourtant de se redessiner autrement dans l’esprit de l’un et de l’autre. « À coup sûr, dira le fils, tu m’as légué la parole qui surestime le réel, le dramatise, à l’aide de beaux mensonges signifiants. Tu m’as légué l’exagération qui fait voir. »
Jamais la mère ne sera nommée, alors qu’elle décline sans arrêt le nom de ses frères et sœurs, oncles et tantes, et de toute autre personne qui, à un moment ou à un autre, jouaient un rôle dans le théâtre de son quotidien. Ultime pudeur ? Non, Robert Lalonde préfère ici s’adresser le plus souvent directement à sa mère, comme si elle était présente, prête à lui donner la réplique, à rectifier les faits, accentuant et actualisant ainsi chaque trait de sa personnalité. Comme si elle jouait sur scène, elle apparaît dès lors que la lumière se pose sur elle et elle s’impose aussitôt par sa gestuelle et ses répliques théâtrales. Le dernier mot, elle l’aura sans aucun doute eu plus souvent qu’à son tour s’il faut en croire la liste des répliques que Lalonde énumère en cascade et qui nous font à notre tour sourire. « Quelle actrice elle ferait ! confie-t-il, Katharine Hepburn, Joan Crawford et même la grande Marlène Dietrich pourraient aller se rhabiller ! » Se dessine peu à peu une femme aux élans passionnés, dont la vie, comme celle de tant d’autres de cette génération, a été le plus souvent confinée à veiller à l’entretien d’un intérieur et au soin des siens. « J’étais pas faite pour cette vie-là », laissera-t-elle tomber, tout en sachant qu’elle ne pouvait aspirer à une autre.
Succèdent aux scènes qui nous font sourire celles, plus poignantes, où le fils visite la mère dans une résidence pour personnes âgées, moments où s’entremêlent les confidences jusqu’à ce jour tues, les remontrances qui rappellent à chacun son rôle, inversé ou non, dont celui tenu par le père et le mari, jusqu’à ce que tout s’embrouille sous l’effet des médicaments, et le poids des souvenirs. Lalonde relate, entre autres souvenirs, comment sa mère, au terme de sa vie, surmontant sa fierté, lui a demandé de lui réapprendre à lire afin qu’elle puisse enfin « déchiffrer de quelle manière [il s’y prenait] pour laver [leur] linge sale devant tout le monde ! »

Ce souci animera également le père de Michael Delisle dans le récit qu’il lui consacre, Le feu de mon père2. Le titre réfère ici, de manière métonymique, à l’arme à feu que portait ce dernier dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’il agissait, entre autres tâches, comme passeur illégal d’immigrants entre les États-Unis et le Canada. Ici, le père n’apprendra qu’au huitième titre publié par son fils que ce dernier est écrivain. Mais l’intérêt pour l’œuvre du fils ne sera que passager, ne s’avérera qu’un accident de parcours, comme l’aura été sa carrière de petit malfrat. Ayant invité son père et son frère à souper chez lui, Michael Delisle raconte quelle a été la réaction du premier lorsqu’il leur a annoncé, pour en quelque sorte casser la glace, qu’un de ses livres venait d’être réédité en format poche : « Qui tu massacres dans celui-là ? » lui demande-t-il avant d’ajouter, se retournant vers son autre fils : « Fais attention, ton tour s’en vient ».
 Au-delà des anecdotes rocambolesques relatées dans ce récit, qui fait également une large part à la mère, l’intérêt réside avant tout dans le traitement des événements rapportés qui, comme chez Robert Lalonde, ont conduit Delisle à prendre conscience que l’écriture serait en quelque sorte sinon une planche de salut, du moins la voie qui lui permettrait d’avoir quelque emprise sur sa vie, s’avérerait l’arme qu’il ferait sienne. Ayant grandi dans une famille que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de dysfonctionnelle (un père malfaiteur et une mère accro aux somnifères et aux amphétamines), Delisle se souvient du silence qui régnait entre les murs de la maison que l’on s’empressait de longer pour se réfugier dans sa chambre. « Comme poète, écrit Delisle, je profite à revivre ces silences mornes. Contrairement à cette idée qui veut que l’artiste se forme à l’expression, ma condition est davantage liée au silence qui m’a été imposé. C’est de n’avoir pas eu droit de parler qui a fait de moi un écrivain. »
Au-delà des anecdotes rocambolesques relatées dans ce récit, qui fait également une large part à la mère, l’intérêt réside avant tout dans le traitement des événements rapportés qui, comme chez Robert Lalonde, ont conduit Delisle à prendre conscience que l’écriture serait en quelque sorte sinon une planche de salut, du moins la voie qui lui permettrait d’avoir quelque emprise sur sa vie, s’avérerait l’arme qu’il ferait sienne. Ayant grandi dans une famille que l’on pourrait aujourd’hui qualifier de dysfonctionnelle (un père malfaiteur et une mère accro aux somnifères et aux amphétamines), Delisle se souvient du silence qui régnait entre les murs de la maison que l’on s’empressait de longer pour se réfugier dans sa chambre. « Comme poète, écrit Delisle, je profite à revivre ces silences mornes. Contrairement à cette idée qui veut que l’artiste se forme à l’expression, ma condition est davantage liée au silence qui m’a été imposé. C’est de n’avoir pas eu droit de parler qui a fait de moi un écrivain. »
C’est plutôt à la naissance d’une écriture et d’un écrivain qu’au portrait brossé ici à grands traits du père, de sa conversion religieuse tardive, que le présent récit nous convie. Comme Perec, Delisle aime à dresser des listes pour aplanir l’angoisse des possibles, contrer la disparition. Si, un jour, alors qu’il n’était qu’un enfant, le narrateur du récit a pu servir de bouclier humain à sa mère devant la furie du père croyant qu’elle l’avait trompé, l’écriture a par la suite joué ce rôle, d’abord par la poésie, puis par le récit narratif. Mais dans l’un et l’autre cas, le même enjeu se dessine : « L’exercice autobiographique soulève des questions éthiques que l’écrivain de fiction passe sa vie à éviter et qui tournent autour de ce contrat : il faut se montrer ».
Dans l’un et l’autre cas, l’écrivain emprunte une voie dont il ignore quelle en sera l’issue. Comme Dédale, il n’a d’autre choix que de l’explorer et, par l’écriture, de s’élever à son tour au-dessus des souvenirs en évitant la chute.
1. Robert Lalonde, C’est le cœur qui meurt en dernier, Boréal, Montréal, 2013, 165 p. ; 19,95 $.
2. Michael Delisle, Le feu de mon père, Boréal, Montréal, 2014, 122 p. ; 17,95 $.
EXTRAITS
Pour une fois, tu disais vrai. À propos de papa, du temps, d’une bonté, d’un amour très tard venu. Et aussi à propos d’une manière d’espèce de sorte de pardon qui, tout en n’effaçant rien, changeait tout.
C’est le cœur qui meurt en dernier, p. 116.
J’ai toujours eu, du plus loin que je me souvienne, la mort dans l’âme. Ce joug, cette entrave à l’insouciance, m’est tellement intime que j’ai fini par y voir une forme de lucidité.
Le feu de mon père, p. 10.











