D’un entretien à l’autre
Si elle ne s’est pas dissoute dans ses larmes, c’est qu’elle savait aussi bien rire que pleurer. Si elle a fait vibrer tant de cordes féministes, même chez certains hommes, c’est que la rebelle avait l’esprit en furie, mais le cœur doux. L’ardeur de Louky Bersianik n’avait d’égale que sa rigueur,
En 2006, France Théoret, poète, romancière et essayiste1, a mené six entretiens structurés avec son amie Louky Bersianik, d’abord pour rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre, mais aussi pour graver dans le temps son travail de pionnière sur la féminisation des titres et des fonctions. Chemin faisant, toutes deux ont abordé les rives de l’écriture de Louky Bersianik et ont retracé la filiation de sa mère, qui lui a insufflé son féminisme inébranlable, sans que celle-ci ait jamais prononcé le mot. De son père est venue, à l’âge le plus tendre, cette passion inentamée pour la chair du verbe. Les deux femmes ont ensuite établi l’architecture de l’œuvre plurielle. De là, elles ont quadrillé l’inquiétant territoire intime des prédateurs avant de s’arrêter en poésie, si chère à Louky Bersianik.
La publication de ces entretiens (L’écriture, c’est les cris, Entretiens avec France Théoret2) nous a offert l’occasion d’échanger durant quelques heures avec France Théoret, et d’évoquer l’écrivaine, la femme, l’amie Louky.
Une archéologue de la langue
Rien d’autre n’a fasciné Louky Bersianik que les mots, une passion dévorante. Déjà dans le dictionnaire qu’elle lit très jeune, elle voit toutes les œuvres des écrivains, et sait d’instinct que ses livres s’y trouvent. Son père possède « un Enfer », le coin où l’attendent les ouvrages mis à l’index. L’audacieuse et silencieuse jeune fille s’aventure à l’insu du père dans le lieu interdit, et fait le plein de mots et de monde.
Le masculin embrasse le féminin, et c’est un baiser mortel, crie et écrit plus tard Louky Bersianik, qui ne tarde pas à scruter la langue française, à la mettre sens dessus dessous, à dénuder ses codes et ses règles en révélant son envers et ses travers patriarcaux. Gaiement et sur plusieurs octaves, elle nous invite à transgresser cette langue qu’elle ne cessera d’aimer. Elle compare la féminisation des titres par le e muet à une gifle en plein visage, et démontre que ce n’est là que l’arbre qui cache la forêt de la tyrannie linguistique que vivent les femmes. Aucune de ses nombreuses propositions, aussi étonnantes qu’inspirées, n’a trouvé la voie des dictionnaires ni celle de l’usage. Les femmes n’ont pas entendu ou retenu les vocables qui sculptent nos réalités innommées : utérile, clitorivage ou pénil, surtout le diamant pur, gynile et ses dérivés.
Quand son amie France Théoret lui suggère qu’elle est l’architecte de la féminisation des titres, Louky se braque : « La première ? Non, je n’accepte pas la compétition ». L’amie insiste : « Ce n’est quand même pas né de l’air du temps ». Après une identification minutieuse des dates, Louky admettra que… c’est son personnage qui a découvert la féminisation. L’Euguélionne est donc la première dans la francophonie qui, au-delà des discussions, a inventé et rédigé un tableau de féminins en formation. Et quel tableau, empreint d’un imaginaire tonique, et dicté par une solide connaissance de l’étymologie, du grec, du latin et de l’indo-européen.
Naissance d’un archétype féministe
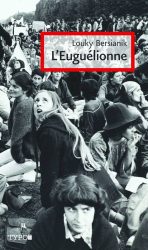 « C’est fort un personnage », commentait souvent Louky. Dans un monastère où elle se réfugiait au début des années 1970, elle a entendu la voix de L’Euguélionne3, un personnage de dixième importance dans son épopée Le Squonk. Si elle n’avait pas pris en note son message, confiait-elle, tout aurait été perdu. Cette extra-terrestre venue de la planète Eunorexie lui dictait sa parole à la manière des évangiles, laquelle s’est incarnée dans les 1386 versets du premier livre publié sous le titre éponyme, L’Euguélionne. L’écrivaine avait 45 ans.
« C’est fort un personnage », commentait souvent Louky. Dans un monastère où elle se réfugiait au début des années 1970, elle a entendu la voix de L’Euguélionne3, un personnage de dixième importance dans son épopée Le Squonk. Si elle n’avait pas pris en note son message, confiait-elle, tout aurait été perdu. Cette extra-terrestre venue de la planète Eunorexie lui dictait sa parole à la manière des évangiles, laquelle s’est incarnée dans les 1386 versets du premier livre publié sous le titre éponyme, L’Euguélionne. L’écrivaine avait 45 ans.
C’est peu dire que l’inspiration traverse cet ouvrage inclassable. Il est porté par un souffle et une passion rares. Il révèle un état de concentration majeure, précise France Théoret, voire un état second. Roman protéiforme, il entremêle avec virtuosité poésie et récit, langue origynelle et harangue, mythologie et allégorie. Créature archétypale, la lionne de la bonne nouvelle s’introduit avec la même impudence candide aussi bien dans le privé que dans le politique, univers qui en définitive s’interpénètrent. Elle fait flèche de tout bois misogyne. Ne rate jamais sa cible.
Jean Basile du Devoir accueillait ainsi le bel objet littéraire : L’Euguélionne dépasse d’un seul coup toute la production romanesque de cette année et s’installe parmi les œuvres importantes de la littérature québécoise. C’est un ours, un je-ne-sais-quoi, lançait dans Le Monde un critique français aussi confondu qu’admiratif.
Acclamée, la Bible Bersianik a surtout eu une influence existentielle indicible. Je vous ai lu et ma vie a changé, a-t-on entendu de mille et une façons dans la bouche des femmes. Un homme a ajouté : « Je suis devenu un Euguélionne enragé ». Il n’était pas seul. C’était l’année 1976.
Le merveilleux sourd de chaque pore de L’Euguélionne, qui transfigure Louky la timide, la muette, en un sujet parlant. Ses idées en jets de lumière et en phrases lapidaires lui rendent au sens littéral la parole. Sous sa protection, l’écrivaine traverse la solitude et accède à la sphère publique. Paradoxe déchirant : la notoriété lui sied mal. Elle n’arrive pas à s’exprimer en public. Elle disait : « J’ai toujours été une muette ».
Ce texte hors norme demeure révolutionnaire. Il porte la marque de toute œuvre majeure : il n’a pas d’âge et semble inépuisable. On y revient sans en tarir la richesse pour interpréter ses songes, se plonger dans sa poésie, relire son verbe flamboyant et goûter son humour dévastateur. Pour jouer aussi avec les mots durs du patriarcat et les neutraliser, ou encore s’amuser à déshabiller la freuduleuse théorie, dont l’autrice connaissait l’aventure de l’intérieur.
Le Dit de Louky
L’ampleur du projet littéraire de Louky Bersianik suggère une référence au premier grand roman moderne, Le Dit du Genji, composé de 54 livres et de 2000 pages, écrit au Xle siècle par la Japonaise Murasaki Shikibu. Une différence de taille sépare pourtant le travail des deux femmes. Même si des recueils de poésie et des contes, quelques essais et romans ont émergé de l’ombre, des centaines de pages de la Québécoise nous sont inconnues. Son travail est un iceberg dont on ne voit et ne connaît que la pointe.
En devinant la timidité profonde de Louky, conjuguée à une époque si obtuse envers l’écriture des femmes, on frémit. On se prend à penser, devant tant de circonstances adverses, que cette œuvre puissante et inégalée aurait pu rester entièrement secrète. Son roman phare, L’Euguélionne, est le dernier de six livres de la fresque intitulée Le Squonk. Au moins deux autres projets de fresques, Les inenfances de Sylvanie Penn et Pour une archéologie du futur, reposent dans ses archives. Sa démarche littéraire ne ressemble à aucune autre, et un plan si vaste serait unique au Québec. Il faudra un jour réunir tous ses textes inédits ou publiés en revues, plaide France Théoret. Rien n’empêche la lecture des manuscrits en leur état, et leur publication posthume comme on l’a fait par exemple pour Kafka.
La créatrice de sens lançait avec une presque désinvolture : « Je suis radicale, parce que j’écris à la racine4 ». Elle était radicale, la plus radicale de toutes peut-être. Elle était savante et d’une simplicité désarmante, mêlant la gravité à un humour irrésistible. Lucide, jamais hargneuse ; des rires ponctuaient ses assertions. C’était une amoureuse, mais ses sentiments ne voilaient pas son regard. Sur la question des femmes, aucun point aveugle ne l’entravait. Oui, arguait-elle, l’amour a des comptes à rendre à la justice.
France Théoret ne doute pas que son féminisme fasse problème. La véritable styliste, celle qui accorde autant d’attention à la voie gigantesque (la fresque) qu’à la voie gigogne (la poésie) aurait-elle été mise au banc de la littérature ? À noter cet élément troublant d’une preuve qu’il faudra étoffer : à la fin des années 1990, un vote tenu à l’Union des écrivaines et des écrivains du Québec s’oppose à son accès à la tribune des membres d’honneur. Personne depuis la création de l’institution en 1977 n’avait essuyé pareille rebuffade. Le seul pays dont se réclamait Louky Bersianik, celui de la littérature, lui a refusé un passeport.
Déjà inconsolable de la vie qu’elle a vécue, de la peine de ses inenfances conjuguée à celle d’exister en tant que femme, sans désirer être un homme, s’ajoutait la peine d’être née du mauvais côté de l’histoire. N’empêche, la fée des mots a su plonger sa douleur dans le larmier comme elle l’a fait de sa plume dans l’encrier, pour en tirer la substance d’une terrible vivante.
Louky Bersianik a laissé une marque indélébile, un puissant signifiant sur la planète écriture. À force de tout vouloir, elle a tout ouvert. Son je affirmé avait la constance de son intelligence. On ne rencontrait pas tantôt Louky la féministe, tantôt Louky l’écrivaine. On rencontrait une femme debout qu’on ne pouvait imaginer assise. Elle était son œuvre.
La mécréante forcenée
On sait que dans la vie, la pensée et l’œuvre de Louky Bersianik, la structure patriarcale du monde constitue sa vision fondamentale. Or, dans le cinquième entretien sur les proies et les prédateurs, il se révèle une intelligence du monde antérieure à cette vision. Le plus fort mange le plus faible aurait été le noyau dur de sa conscience, né dans sa psyché de petite fille. Dans la vie, ainsi que le traduit son fils Nicolas, on est soit le repas, soit le repu. Elle disait que si le patriarcat a eu un début, il peut donc avoir une fin, mais elle ne voyait pas comment on pouvait mettre un terme à la prédation. L’insoutenable poids de cette injustice l’accablait et serait une des causes de sa peine existentielle. Son alter ego Sylvanie Penn, inversion de Pennsylvanie, ne contient-il pas aussi cette peine infrangible ? « Nous finirons tous dans la gueule de Dieu, parce que c’est lui qui est tout en haut de la chaîne alimentaire. » Et ce dieu, s’il existe, ne peut être bon ; il est cruel ou, au mieux, indifférent.
La mécréante forcenée, de son propre aveu, croyait pourtant en ses pareilles. Elle voyait grand, elle voyait haut pour nous toutes. Denise Boucher l’exprime si bien : « Louky Bersianik ouvrait les portes de la pensée avec splendeur ». Comment dire à celles et ceux qui ne connaissent ni l’écrivaine ni son œuvre de courir s’y abreuver. Les Entretiens avec France Théoret paraissent une large entrée en matière. Les académiciennes, les étudiants et les professeurs, les chercheuses et autres exégètes y découvriront de nombreuses pistes de réflexion et d’étude.
1. France Théoret reçoit le prix Athanase-David pour l’ensemble de son œuvre en 2012.
2. L’écriture, c’est les cris, Entretiens avec France Théoret, édition préparée et annotée par André Gervais, Remue-ménage, Montréal, 2014, 166 p. ; 19,95 $.
3. Du grec euaggeion : « évangile » ou « bonne nouvelle ».
4. Du bas latin radicalis, de radix, racine.










