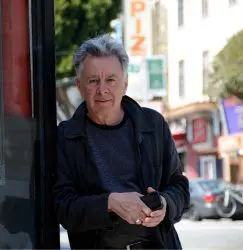Il y a plusieurs livres que je n’ai pas lus et que j’emporterais en voyage, comme Le colosse de Maroussi de Henry Miller, acheté en 1986, que je comptais apporter en Grèce ; mais je ne m’y suis pas encore rendu. Ce jumelage est toutefois à l’origine d’une méthode d’écriture : intégrer le voyage à la fiction que j’écris, et un livre au voyage de ma fiction. C’est peut-être en souvenir de ce projet grec en suspens que j’ai emporté Sexus de Miller au Costa Rica quand je me suis mis à écrire Nosara. À New York pour New York trip, c’était Les Pâques à New York de Cendrars. Et à Marie-Galante, un roman d’Annie Ernaux que j’ai récrit entre les lignes mêmes du volume : Une si simple passion est un véritable palimpseste. Pour Sûtra, à l’aller et au retour – un long courrier, c’est merveilleux pour l’écriture : on entre dans une zone d’intense mais légère concentration (il n’y en a pas de meilleure) –, ce fut Oku no hosomichi dont j’aime bien traduire le titre, simplement, par La voie étroite vers l’intérieur, ce qui correspond tout à fait au sens de l’œuvre de Bashō.
Il est certain qu’il est bon de lire des livres qu’on n’a pas lus, du moins de les lire un peu. On apprendrait, par exemple, dans la Bible, la différence entre l’Arbre de la Vie et l’Arbre de la Science du bien et du mal… ou peut-être pas.
Mais ce que je veux lire et emporter dans un lieu de grandes vacances, c’est en fait deux livres : L’Iliade et L’Odyssée. La Grèce, après tout, est notre origine. Il faut y retourner. Nietzsche est convaincu que ça repassera. L’Odyssée serait un livre de voyage, selon ce que j’ai entendu dire (cette lecture me comblerait donc d’un double plaisir), ou du moins selon les fragments qui meublent mon imaginaire. Je sais évidemment que les Argonautes se sont rendus à Toronto.
Je me suis un peu intéressé à la mythologie grecque grâce (c’est un merveilleux mot dans le contexte de l’Olympe) une éducation assurée par des jésuites (c’est du sérieux !). J’ai un faible pour la philosophie présocratique, que je trouve très zen. J’ai aussi appris que Démosthène plaçait des cailloux dans sa bouche pour s’exercer à mieux articuler. Leçon que j’ai retenue lorsque je fus appelé à réciter, au secondaire, une fable de La Fontaine, à tel point que j’imagine pouvoir la livrer aujourd’hui. Étonnamment, c’est un des seuls livres découverts dans les affaires de mon père, après son décès : Les fables de La Fontaine, illustrées par Vimar, qu’il avait reçues à la distribution des prix au Collège de Saint-Boniface.
On ne peut évidemment pas évoquer le nom du père sans faire surgir de la Grèce celui d’Œdipe. J’ai aussi écrit là-dessus dans un autre livre, L’incomparable, autour de Sappho et d’un autre voyage que je n’ai pas réussi à entreprendre vers la Grèce. Il y est question de la fameuse réponse qu’Œdipe donne à la question du Sphinx : « C’est l’homme ». L’errant avait, semble-t-il, résolu l’énigme et le Sphinx le laissa passer, pour son plus grand aveuglement. Car il s’agit, au fond, d’une espèce de cheval de Troie. La bonne réponse, c’est : moi, Œdipe. La fatalité est alors levée. Freud et Lacan sont passés dans ces parages, pour découvrir que l’enjeu n’est ni dans le signifié ni dans le signifiant, mais dans le réseau de signifiance, « l’anneau qui fait tout tenir ensemble ». J’ai vu aussi, au cours de mes années collégiales, qu’Anouilh et Giraudoux, entre autres, y avaient versé, après le Père-du-Nom-du-Père, Sophocle, qui m’a permis de saisir que le théâtre n’est pas une place où l’on joue une histoire, mais une véritable scène, un lieu où il se produit quelque chose de profondément intérieur, aussi public puisse-t-il paraître.
Enfin, L’Iliade et L’Odyssée sont des livres que j’ai lus sans les avoir lus. Pas dans le sens où Pierre Bayard nous apprend Comment parler des livres que l’on n’a pas lus. Car j’ai un peu lu ces deux classiques, sans les avoir lus véritablement. L’Iliade m’a inspiré dès l’école primaire et je me souviens de l’endroit où j’ai composé ma première « œuvre ».
Sans doute, avais-je déjà écrit des compositions à l’école. J’aime bien le mot composition. Le petit Robert le définit ainsi : « Action ou manière de former un tout en assemblant plusieurs parties, plusieurs éléments ; disposition des éléments ». Le terme s’applique aussi bien à la création d’un tableau que d’un texte, et de surcroît au processus même de l’imprimerie. Cette fois, c’était autre chose qu’un devoir d’école. Ce fut le lieu d’une véritable scène. Jeune, j’étais asthmatique et je manquais souvent l’école (ce qui ne me déplaisait pas). Je me revois assis au bureau de mon grand-père : le sous-main en papier buvard, vert, l’encrier et le sigle en bronze de mon grand-père, en tête de Janus (ce n’est pas grec, mais impressionnant). J’ai composé une histoire de prince et de princesse, et je me souviens que lui se nommait Pâris. Je ne pouvais avoir retenu ce nom que d’une lecture, car j’ai mis l’accent. Un nom qui évoquait aussi celui d’une ville. C’est peut-être pourquoi, dans Le soleil du lac qui se couche, j’ai donné le nom d’Ueno à un des personnages principaux. Ueno est aussi un quartier de Tokyo.
J’avais, je l’avoue, lu L’Iliade… en bande dessinée, dans la série « Classic Comics ». Les couleurs de cette série étaient moins vibrantes que celle des Disney et des Looney Tunes, à tel point que j’ai longtemps conservé le souvenir qu’elles étaient classiques, c’est-à-dire en noir et blanc. Plus précisément, je l’ai lu en anglais. Jusqu’à l’âge de douze ans, j’ai résidé au centre-ville de Winnipeg, bien loin de la rue Deschambault. Nous étions une petite communauté, comme chez Astérix le Gaulois, d’irréductibles francophones. Pas de librairie française dans le quartier pourtant. Je m’approvisionnais en comics à la pharmacie du coin : des super-héros à Mickey Mouse en passant par les classiques, L’Iliade, L’Odyssée, Roméo et Juliette, Hamlet, Macbeth (ah ! les sorcières : « Double, double toil and trouble. Fire burn and cauldron bubble »). Les trois mousquetaires, Notre-Dame de Paris… En english yes, mais j’avais fait à douze ans mon cours classique avant d’arriver au Collège de Saint-Boniface. À cet égard, on me permettra une petite immodestie : au bac, nous subissions l’examen de littérature anglaise avec les centaines d’étudiants de l’Université du Manitoba. L’année du cours sur Shakespeare, j’avais obtenu la meilleure note de la province. Le recteur du Collège en était pas peu fier et se vantait largement de l’enseignement prodigué par son établissement. Ce qu’il ne savait pas, c’est que je m’en étais remis à mon ancienne collection de « Classic Comics » pour revoir mon Shakespeare.
Je ne suis pas grand lecteur. Cela aussi remonte possiblement à ma fréquentation des illustrés. Même les pages de l’Histoire sainte étaient illustrées. Je retiens encore le récit d’Absalom pris aux branches de l’arbre par les longues tresses de sa chevelure. Il a fallu que j’en parle dans La disparate. Par contre, je n’ai jamais pu terminer un roman de la comtesse de Ségur. D’ailleurs, j’aime bien entretenir aux yeux des autres l’illusion que je lis peu et je n’ai donc pas à m’évertuer aux acrobaties de Pierre Bayard. En fait, je lis assez, mais surtout je voltige (« Float like a butterfly, sting like a bee ») autour de livres qui piquent ma curiosité… et où je pique. Souvent ce sont des choses inutiles pour une carrière, comme on dit ; les dix-neuf tomes du Journal littéraire de Paul Léautaud, par exemple. Surtout, je relis, beaucoup, les textes qui m’ont plu. Cas d’espèce : les Illuminations (Rimbaud), ou Vision à New York (Sollers), ou Le plaisir du texte (Barthes). Et si je me souviens, ici, de quelques épisodes de lecture, j’ai la mémoire obscure devant l’élément cinématographique, c’est-à-dire « l’histoire » qu’on raconte. J’ai dû relire cinq ou six fois Une saison dans la vie d’Emmanuel, chaque fois avec un plaisir renouvelé, mais ayant oublié le déroulement du prétexte. Il m’a semblé, depuis le jour de Janus que l’écriture était ailleurs.
Il y a aussi ces livres qu’on ne lit jamais, mais qu’on achète pour leur couverture, pour la texture du papier, en raison du format, du caractère typographique, d’une phrase inopinée, d’une couleur, toutes ces choses qui sont l’étendue magique du livre au-delà de son texte.
En effet, l’image a accompagné la lecture tout au cours de ma vie. Je me souviens fort bien d’avoir joint un dessin à ma petite composition autour du prince Pâris. Je me suis intensément intéressé aux arts plastiques et j’ai longuement hésité entre les études en lettres et les beaux-arts à la fin de mon bac. Cette fréquentation m’a aussi conduit, au cours des ans, à la composition d’œuvres littéraires plus texturées : les collages de Pièces à conviction, les réécritures de Montréal poésie, ou encore la fresque littéraire (quatre pieds par huit pieds) Généalogie de lieu.
On pourrait trouver paradoxal que le comic (c’est peut-être le fou du roi) où le texte d’origine disparaît magistralement pour faire place à l’histoire illustrée m’ait conduit à voir dans l’écriture autre chose que la représentation d’une histoire (qui n’est, au fond, qu’une éphéméride), mais à découvrir, dans la contexture, le texte, qui n’est pas le prétexte auquel il est trop souvent asservi, tant à l’écran que sur la page du roman. Bien sûr, les illustrations de ma jeunesse m’ont conduit aux tableaux et dès lors qu’on connaît la tactilité de la peinture, on sait que l’écriture est tout à fait autre chose que ce que l’on croyait, et on sait que plus jamais notre écriture ne sera qu’un simple agent. Je dois dire que cette familiarité avec l’art plastique a sauvé mon écriture. L’image en écriture n’est pas, elle non plus, une narration cinématographique. De cette première expérience avec L’Iliade, que je n’ai pas tout à fait lu, j’ai aussi tiré la conclusion qu’on pouvait écrire plus court.
En fait, je suis convaincu que le jour où je l’emporterai avec moi, je découvrirai que L’Odyssée est autre chose qu’un récit de voyage, mais plutôt celui d’un éternel retour où je me retrouverai parmi les dieux plus nombreux que les mille manifestations du Dao, moi-même plus heureux qu’Ulysse, dans l’épiphanie des mots.