Franc-tireur resté fidèle à l’esprit négateur du mouvement dada, Georges Ribemont-Dessaignes (1884-1974) fut sa vie durant un écrivain marginal. Dans aucune de ses nombreuses activités GRD ne s’est « installé » et il n’a jamais procédé autrement que par ruptures. Avec le milieu paternel de la grande bourgeoisie comme avec l’art officiel dont il n’accepta aucun des compromis mercantiles.
Après avoir tourné la partition pour Camille Saint-Saëns (sans conviction) et Gabriel Fauré (attentivement) venus en amis taquiner le piano familial, après une formation artistique dans quelque académie de peinture où il fait scandale, GRD trouve ses véritables pairs dans le cercle des Duchamp, avant la Première Guerre, comme il l’évoque dans son livre de souvenirs1. Marcel Duchamp, avec qui il a de profondes discussions, témoignera à plusieurs reprises de la haute estime dans laquelle il tient GRD. Le groupe dadaïste le reconnaît immédiatement comme l’un des siens grâce à sa pièce L’Empereur de Chine, écrite en 1916. Pamphlétaire hors pair, il devient l’un des plus radicaux polémistes du mouvement. Son refus d’obédience au dogme surréaliste le conduit à rompre avec André Breton et à se rapprocher de Georges Bataille, avec qui il partage une fascination certaine pour le bas et le sordide. Sa production littéraire hors du commun fait de lui le collaborateur assidu d’une multitude de revues.
Le roman est sans doute la partie la moins connue de l’œuvre malgré un prix littéraire (Les Deux Magots en 1934 pour Monsieur Jean ou L’amour absolu). De 1922, date de l’écriture de L’autruche aux yeux clos, qui paraît deux ans plus tard, à la fin de sa vie (Éliel ou L’Apocalypse, un roman inédit terminé en 1972), 24 romans, voire 27 si l’on tient compte de récits supposés ou inachevés, naissent sous la plume de GRD. Douze ont été publiés. Même taux de publication pour la quarantaine de nouvelles qu’il a écrites. Ses productions les plus régulières furent les ciné-romans populaires généralement signés R. Dessaignes, parmi lesquels figurent ces « odieux petits romans policiers2 » reprochés par Breton qui parurent par dizaines. À l’occasion il servit aussi de nègre à un journaliste chargé de publier les mémoires posthumes de Sarah Bernhardt3. Pour la circonstance, il n’hésita pas à inventer de toutes pièces le chapitre consacré à la diction et celui sur le maquillage. On devine aisément les raisons qui l’ont conduit à ces productions : les mêmes qui le virent éleveur de porcs, maraîcher, moniteur de ski, aubergiste et fait-diversier. Pour sa gloire, certes discrète, Ribemont–Dessaignes fut aussi peintre (sa vocation première), musicien, peut-être le seul à pouvoir revendiquer le titre de compositeur dada, dramaturge, poète, essayiste, critique musical, homme de radio et rédacteur en chef de la prestigieuse revue Bifur…
Romancier surréaliste
Comme la poésie et le théâtre, ses récits sont traversés par deux courants successifs. Les nouvelles réunies dans Dada et les sept romans de la période 1924-1929, à quoi il faut ajouter Élisa en 1931 – sans doute le plus bataillien des récits de GRD –, constituent la période surréaliste. Roman et surréalisme se dissolvent alors sous sa plume en une réaction chimique à laquelle il donne le nom de « réalisme inaccepté4 », nouvelle « table de dissection » sur laquelle réalité et surréalité se rencontrent et cessent de se percevoir en termes 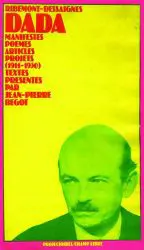 contradictoires jusqu’à ouvrir le champ à une veine moins convulsive à partir d’Adolescence ou Le vestiaire de la personnalité (1930), qui peut être lu, avec Monsieur Jean (1934) et Smeterling (1945), comme une variation caustique sur les trois âges de Don Juan. Poétique, le roman prend en compte l’homme dans sa dimension sociale pour faire entendre « l’étrange force mystique de la voix collective » : « Aujourd’hui plus que jamais, la Réalité est une apparence et les progrès rationalistes de la science confirment cette affirmation de l’Irrationnel. Réalité, soit, puisque c’est ainsi que cela s’appelle, mais réalité inacceptée, et si là-dessus se greffe pour les intellectuels un mode d’expression, ce sera un Réalisme inaccepté qui ouvrira de nouvelles fontaines de la Poésie et, plus que l’artificiel populisme, la poésie miraculeusement neuve de la masse populaire en proie à sa propre vie, à ses petites difficultés, à son destin tragique, à son débat de chaque heure, tandis qu’à chaque geste infime, à chaque pas, la Réalité fuit en ricanant sitôt que le pauvre homme veut la saisir5 ».
contradictoires jusqu’à ouvrir le champ à une veine moins convulsive à partir d’Adolescence ou Le vestiaire de la personnalité (1930), qui peut être lu, avec Monsieur Jean (1934) et Smeterling (1945), comme une variation caustique sur les trois âges de Don Juan. Poétique, le roman prend en compte l’homme dans sa dimension sociale pour faire entendre « l’étrange force mystique de la voix collective » : « Aujourd’hui plus que jamais, la Réalité est une apparence et les progrès rationalistes de la science confirment cette affirmation de l’Irrationnel. Réalité, soit, puisque c’est ainsi que cela s’appelle, mais réalité inacceptée, et si là-dessus se greffe pour les intellectuels un mode d’expression, ce sera un Réalisme inaccepté qui ouvrira de nouvelles fontaines de la Poésie et, plus que l’artificiel populisme, la poésie miraculeusement neuve de la masse populaire en proie à sa propre vie, à ses petites difficultés, à son destin tragique, à son débat de chaque heure, tandis qu’à chaque geste infime, à chaque pas, la Réalité fuit en ricanant sitôt que le pauvre homme veut la saisir5 ».
Le premier Ribemont-Dessaignes mêle fantasmagorie surréaliste et rupture avec les conventions narratives. Du vivant de l’auteur, aucun de ces écrits n’a fait l’objet d’une réédition, à l’exception du Bar du lendemain en 1972 chez Gallimard. Les éditions Jean–Michel Place proposeront Ariane en 1977. Ce court récit de 1925, représentatif de « l’Esprit nouveau » que traquent alors les jeunes surréalistes dans l’errance nocturne et l’épiphanie de la femme nue, préfigure Nadja de Breton. En 1979, Jean-Pierre Begot, auteur de la première thèse consacrée à GRD, livre aux éditions Plasma une nouvelle édition de Frontières humaines, récit halluciné de 1929 auquel La grande beuverie de René Daumal doit beaucoup.
Ce n’est qu’en 1988 que les éditions Allia entreprennent la réédition partielle des romans. Aujourd’hui épuisés, ces récits se préparent à retrouver les rayons des libraires.
Dès le premier roman, L’autruche aux yeux clos (1924), est planté le décor de l’univers dessaignien. GRD y détourne les conventions romanesques, n’hésitant pas à recourir au collage (un court chapitre est constitué de deux articles du journal Le Matin du 1er décembre 1922, procédé qui sera repris dans Ariane) ni à inventer un chassé–croisé international où les contrées traversées sont aussi précises dans  leur appellation (Mexique, France, New York, Colombie, Autriche, Balkans) qu’inexistantes dans leur description, comme le sera le Grand Nord du Bar du lendemain en 1927. L’objet de cette course-poursuite : une héroïne tellement fuyante… qu’elle change d’identité sans prévenir : Marie Azote, aux prises avec le héros Boy Hermès. Noms fantaisistes où le grotesque le dispute à la mythologie, représentatifs d’une richesse onomastique qui emprunte aussi à la Bible. L’héroïne, qui veut se soustraire à la possession de Boy qui l’a gagnée aux cartes et qu’elle aime, se prostitue à l’envi, car « [son] état est celui d’une virginité indéflorable ». Putain vierge qui refleurit dans d’autres romans… L’extravagant Dr Venise, épigone du père Ubu qui veut créer une nouvelle race à partir de sa propre semence, annonce « L’Auteur »–dictateur de Frontières humaines, et la curieuse Estelle de Malabar, qui conserve son linge de corps dans le cercueil de son mari, est la première d’un long cortège de femmes qui appellent le désir par la répugnance de leur chair. Mais aux hommes qui la possèdent elle n’apportera rien de la révélation attendue : lot commun du héros dans sa quête obsessionnelle de la femme. Autres constantes de cet univers en devenir : l’interrogation sur le langage et son corollaire désespéré : la strangulation ; et la mort comme étape ultime de la connaissance, celle que va traquer l’héroïne de L’autruche aux yeux clos, devenue « Princesse Verbale » auprès des agonisants des champs de bataille.
leur appellation (Mexique, France, New York, Colombie, Autriche, Balkans) qu’inexistantes dans leur description, comme le sera le Grand Nord du Bar du lendemain en 1927. L’objet de cette course-poursuite : une héroïne tellement fuyante… qu’elle change d’identité sans prévenir : Marie Azote, aux prises avec le héros Boy Hermès. Noms fantaisistes où le grotesque le dispute à la mythologie, représentatifs d’une richesse onomastique qui emprunte aussi à la Bible. L’héroïne, qui veut se soustraire à la possession de Boy qui l’a gagnée aux cartes et qu’elle aime, se prostitue à l’envi, car « [son] état est celui d’une virginité indéflorable ». Putain vierge qui refleurit dans d’autres romans… L’extravagant Dr Venise, épigone du père Ubu qui veut créer une nouvelle race à partir de sa propre semence, annonce « L’Auteur »–dictateur de Frontières humaines, et la curieuse Estelle de Malabar, qui conserve son linge de corps dans le cercueil de son mari, est la première d’un long cortège de femmes qui appellent le désir par la répugnance de leur chair. Mais aux hommes qui la possèdent elle n’apportera rien de la révélation attendue : lot commun du héros dans sa quête obsessionnelle de la femme. Autres constantes de cet univers en devenir : l’interrogation sur le langage et son corollaire désespéré : la strangulation ; et la mort comme étape ultime de la connaissance, celle que va traquer l’héroïne de L’autruche aux yeux clos, devenue « Princesse Verbale » auprès des agonisants des champs de bataille.
Ce court roman, et en 1924 cette appellation fait figure de provocation, est révélateur de l’héritage dadaïste et du monde selon GRD : une gigantesque farce sanglante où s’agite complaisamment la mesquinerie humaine. Il se conclut sur ces mots : « Vraiment on passe sa vie à attendre la mort, mais il est assez facile de vivre ».
L’ irruption du réel
À l’autre extrémité de la production publiée de GRD, Le temps des catastrophes, en 1947, décrit toujours un monde en ruine mais la violence, la solitude et la mort n’y ressortissent plus de la fable, dépassée désormais par la réalité. Le narrateur avance à visage découvert : derrière le « je » du personnage principal, son activité de « poète », des événements intimes et la localisation du récit dans le sud de la France, apparaissent les traits de l’auteur. Comme dans les œuvres précédentes, l’humanité y est définie par son fonctionnement 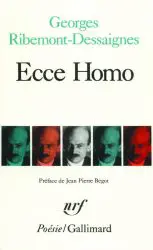 physiologique, en proie à un terrible va–et–vient entre les deux pôles de sa verticalité : « [L]a chute n’est jamais assez profonde, si elle ne met en cause les tourments de l’argent et ceux du ventre ». Ces derniers donnent leur titre au deuxième récit (« Profondeur du ventre ») et font écho à la fin de Smeterling, porte–parole d’une race « au ventre terrifiant dont le bon fonctionnement déchaîne les guerres6 ».
physiologique, en proie à un terrible va–et–vient entre les deux pôles de sa verticalité : « [L]a chute n’est jamais assez profonde, si elle ne met en cause les tourments de l’argent et ceux du ventre ». Ces derniers donnent leur titre au deuxième récit (« Profondeur du ventre ») et font écho à la fin de Smeterling, porte–parole d’une race « au ventre terrifiant dont le bon fonctionnement déchaîne les guerres6 ».
Possession, dévoration, autant d’images d’un univers jusque–là métaphorique auquel la guerre offre désormais une troublante consistance. Il serait tentant de trouver dans le chaos mondial l’explication du silence romanesque qui suivra, comme si l’auteur s’était retrouvé réduit à l’impuissance par le fracas du réel. Sa production inédite, en grande partie postérieure à la Seconde Guerre, comporte certes dix récits, mais d’une facture très différente, où l’autobiographie (Jeunesse7) le dispute à la chronique villageoise (Éliel). Point d’orgue possible de l’œuvre romanesque, Le temps des catastrophes marque l’entrée dans une nouvelle ère : celle d’une vision apaisée de l’amour. L’auteur vient de rencontrer à la même époque que son récit celle qui deviendra sa seconde épouse. Nouvelle porosité entre le réel et la fiction : ce dernier roman est le seul qui finisse sur une note d’espoir, celui de l’amour pacifié et de la liberté retrouvée que symbolise la cigarette partagée par le narrateur et sa compagne, et qui leur « apparaissait comme un commun baiser donné à la liberté, et donné à l’amour, en même temps ». Cependant, l’ultime phrase du récit invite à méditer sur la relativité de cet espoir : « La liberté, une petite fumée… »
La révolte désespérée
Si un fil rouge traverse l’œuvre de GRD, on l’a compris : il est teinté de sang, celui de la tragique condition humaine dont la vision culmine dans Frontières humaines et son surréalisme baroque, récit nietzschéen dans lequel la femme, violée, éventrée, disséquée, mutilée, rejoint la cohorte des héroïnes dessaigniennes « retournées comme un gant », pour reprendre la comparaison récurrente de l’auteur, sur lesquelles les personnages masculins échouent à trouver un sens au monde. Car « le monde est femelle », écrit-il dans Frontières humaines, et le  sexe scopique qui l’interroge ne découvre que vanité et vacuité. Les femmes n’enfantent pas chez GRD, ou alors mettent au monde un « enfant crevé8 », ou un être dégénéré comme celui à qui Titine donne le jour dans L’autruche aux yeux clos. Tout au plus l’activité sexuelle est-elle considérée comme un exutoire : « Tous les appétits de l’âme ne se répandent bien au-dehors que par le bas. La cervelle gazouille quand le ventre agit9 ».
sexe scopique qui l’interroge ne découvre que vanité et vacuité. Les femmes n’enfantent pas chez GRD, ou alors mettent au monde un « enfant crevé8 », ou un être dégénéré comme celui à qui Titine donne le jour dans L’autruche aux yeux clos. Tout au plus l’activité sexuelle est-elle considérée comme un exutoire : « Tous les appétits de l’âme ne se répandent bien au-dehors que par le bas. La cervelle gazouille quand le ventre agit9 ».
Qu’ils soient du sexe ou de l’estomac, « les soucis du ventre tirent une partie de l’être par en bas, mais lui laissent des tourments dans la tête10 ». Préoccupé de « mangeaille » et de « matelas11 », l’être humain – et l’homme en particulier puisque c’est lui qui se pose en victime de la femme et de la société – n’a d’autre recours que celui de maudire la « race humaine que travaille le besoin de sa pérennité12 » et qui, « à part ses soucis génésiques, a un estomac à remplir […]. Encore le ventre à victuailles est–il plus riche en accommodements que le ventre à ovaires ! Ô monde, sale femelle13 ! » L’appel dégradant du « ventre » ne laisse à l’homme d’autre choix que la fange, en toute conscience et sans renoncer à la révolte désespérée qui oppose aux bassesses du corps les hauteurs de l’esprit : « Mâle invectivant les malheurs de l’amour, huant la femelle fécondée et qui ne conçoit qu’en laissant derrière elle les cendres et les ruines de la dissolution, crachant sur les menstrues et les accouchements de la société, j’userai de la seule liberté humaine, stérile et sèche, qui pourtant ne soit pas vaine, celle de l’esprit qui non seulement récuse les ordres de ses maîtres, refuse de servir, mais les assassine. Sans eux, le néant ? Soit14 ».
Cloué au pilori d’une verticalité mouvante, le personnage dessaignien ne trouve d’échappatoire que dans la négation. Invectivant Dieu dans un éclat de rire où la créature se retourne armée contre le Créateur, conspuant les femmes responsables de « l’inconvénient d’être né » (comme le formulera aussi Cioran), l’Homme selon GRD ne peut donner sens à sa vie que par le cri déchirant de son refus brandi devant l’abîme.
1. Georges Ribemont-Dessaignes, Déjà jadis ou du Mouvement dada à l’espace abstrait, Julliard, Paris, 1973 [1958].
2. André Breton, Second manifeste du surréalisme, Gallimard, Paris, 1985 [1930], p. 120.
3. Sarah Bernhardt, L’art du théâtre, Sauret, Monaco, 1993 [Nilsson, Paris, 1923].
4. Georges Ribemont-Dessaignes, « Réalisme inaccepté », Dada, Manifestes, poèmes, nouvelles, articles, projets, théâtre, cinéma, chroniques (1915-1929). Nouvelle édition revue et présentée par Jean-Pierre Begot, Ivrea, Paris, 1994, p. 360-361.
5. Ibid, p. 361.
6. Georges Ribemont-Dessaignes, Smeterling, Allia, Paris, 1988 [1945], p. 275.
7. Georges Ribemont-Dessaignes, Jeunesse, « récit », inédit, 526 feuillets dactylographiés. Document conservé à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet.
8. Georges Ribemont-Dessaignes, Élisa, Grasset, Paris, 1931, p. 130.
9. Georges Ribemont-Dessaignes, « Le bocal de poison rouge », dans La divine bouchère, Le Castor Astral, Paris, 2006 [1931], p. 134.
10. Georges Ribemont-Dessaignes, Le temps des catastrophes, Calmann-Lévy, Paris, 1947, p. 26.
11. Georges Ribemont-Dessaignes, Monsieur Jean ou L’amour absolu, Allia, Paris, 1991 [1934], p. 154.
12. Georges Ribemont-Dessaignes, Smeterling, op. cit., p. 272.
13. Ibid., p. 275-276
14. Ibid., p. 276.
Ouvrages disponibles de Georges Ribemont-Dessaignes :
Romans : Smeterling, préface de Jacques Simonelli, Allia, 1988 ; Adolescence ou Le vestiaire de la personnalité, préface de Jacques–Élie Moreau, Allia, 1989 ; Monsieur Jean ou L’amour absolu, avant-propos de Joë Bousquet, Allia, 1991 ; Clara des jours, Allia, 1991 ; L’autruche aux yeux clos, postface de Jacques Simonelli, Allia, 1993 ; Céleste Ugolin, postface de Gilles Losseroy, Allia, 1993.
Poésie : Cryptogrammes, n°1 (poèmes et dessins), Chave, 1968 ; La ballade du soldat, Chave, 1984 ; Ecce Homo, préface de Jean–Pierre Begot, Gallimard, 1987 ; Sérénade à quelques faussaires, textes réunis et présentés par Jacques Simonelli, Allia, 1991 ; Cryptogrammes, n°2 (poèmes et dessins), Chave, 2000.
Nouvelles : Trois épîtres, préface de Jacques Simonelli, Fourbis, 1989 ; La divine bouchère, édition établie et présentée par Gilles Losseroy, Le Castor Astral, 2006.
Recueil : Dada, Manifestes, poèmes, nouvelles, articles, projets, théâtre, cinéma, chroniques (1915-1929), Ivrea, 1994.
Catalogue d’exposition : Un hommage à Georges Ribemont-Dessaignes, Chave, 1975.
Compositions musicales : « Le Nombril interlope » et « Pas de la chicorée frisée » [1920], Festival Dada Paris, CD ltm recordings, 2008.
Enregistrement : Entretiens avec Georges Ribemont-Dessaignes (juillet 1947), CD audio, INA, 1999.
Sur Georges Ribemont-Dessaignes : Jean-Pierre Begot, L’œuvre de Georges Ribemont-Dessaignes de 1915 à 1930, Thèse de 3e cycle présentée à la Faculté des lettres de Paris III, 1972 ; Groupe Éluard, « Actes du colloque international Georges Ribemont-Dessaignes (1984) », Les Mots la Vie, n°s 3-4, Université de Nice, 1986 ; Gilles Losseroy, Georges Ribemont-Dessaignes romancier, Thèse de doctorat présentée à la Faculté des lettres de Nancy II, 1995.
Gilles Losseroy est maître de conférences à l’Université de Lorraine (équipe de recherche Littératures, Imaginaire, Sociétés). Spécialiste du théâtre, il est aussi metteur en scène.









