Notre époque aime croire qu’elle a inventé le tourisme, mais peut-être n’en a-t-elle que multiplié les adeptes et les périples. Elle se berce aussi de la prétention que les touristes d’aujourd’hui rivalisent de curiosité fiévreuse et de témérité avec Hérodote ou Livingstone, mais peut-être nos découvreurs modernes obéissent-ils souvent aux conditionnements de la publicité et se bornent-ils au dépaysement compatible avec la sécurité.
Heureusement, deux équipes d’observateurs de l’activité touristique ont tôt fait de limiter les malentendus. Dans le premier cas, on reconstitue, à grand renfort de documents publicitaires, l’histoire des propositions touristiques formulées par des générations de promoteurs et de transporteurs au sujet du Québec. Dans le second cas, l’attention se déplace vers les stratégies touristiques des localités et des régions québécoises, y compris le rôle qu’y assume leur recours aux surnoms glorieux. Dans les deux survols, le lecteur bénéficie d’une recherche vivante et exemplaire.
Destination Québec, Une histoire illustrée du tourisme
En puisant à pleines mains dans les collections publiques et privées de documents publicitaires et en croisant les regards du professeur Marc H. Choko et de deux chercheures de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Michèle Lefebvre et Danielle Léger, la 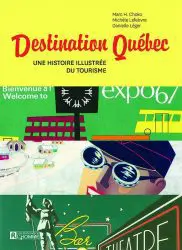 première équipe dresse un bilan
première équipe dresse un bilan
multidisciplinaire de l’activité touristique québécoise depuis son berceau. Dans Destination Québec, Une histoire illustrée du tourisme1, il est en effet question de strates sociales, de modes, de culture, de mythes utilisés ou créés, d’époques et de création. De bout en bout, le décor demeure le Québec, mais le cours du temps modifie constamment et parfois brusquement les demandes des publics et les choix de l’industrie et des artistes. Textes et illustrations font voir d’où procède le tourisme québécois et quelles influences lui ont dicté ses orientations.
Au commencement, comme dirait l’évangile selon saint Jean, était… la richesse. Du moins celle de quelques-uns. Et cette richesse éprouvait deux besoins interreliés : celui de la détente et celui d’être vu en train de se détendre. Se réunir avec ses égaux en un lieu calme et huppé, tel fut le motif qui, il y a bientôt deux siècles, conduisit une clientèle de privilégiés anglophones à Rivière-Ouelle, à Murray Bay (La Malbaie), à Rivière-du-Loup, dans les centres de ski des Laurentides… Photographies et affiches à l’appui, il est vite patent que l’industrie touristique sollicita d’abord une classe aisée dont le premier souci n’était pas d’épargner : ce qu’offre la publicité n’appartient pas au quotidien de la population, mais à celui des sommités financières et politiques. Canadiens anglophones et riches Étatsuniens monopolisent l’attention des promoteurs. À ce stade, des moyens de transport sélectifs et souvent peu abordables écrèment la clientèle ; bateau et train dominent donc la publicité.
Tout change dès l’instant où l’automobile envahit le décor. Elle rend le tourisme accessible à l’ensemble de la population et multiplie les points de chute. La publicité, en un clin d’œil, fait amende honorable : l’anglais coexiste avec le français, les attraits conviennent davantage à la classe moyenne, le souci d’épater le voisin perd de son magnétisme.
Sans lourdeur, les auteurs observent que la publicité change de ton et apprend le réalisme lorsqu’elle cesse d’être contrôlée et créée par des gens qui connaissent peu le Québec profond et qui, de toute façon, s’adressent à une élite financière dont les perceptions ressemblent aux leurs. Sur les deux versants de cette minorité, le Québec est présumé folklorique, suranné, traditionnel, cléricalisé. Les mœurs auront substantiellement changé avant que le public visé et ses publicitaires s’en aperçoivent et en tiennent compte. La démocratisation provoquée par l’automobile rendit la publicité subitement inadaptée et même obsolète : d’urgence, elle dut s’adapter au Québec réel.
À noter, une bonne moitié des documents retenus par cet ouvrage provient de la BAnQ ; autant dire que la mémoire collective est assurée.
Le Québec autrement dit, Et un tour du monde en surnoms
L’album2 que proposent Henri Dorion et Pierre Lahoud semble, à plus d’un égard, la suite logique et chronologique du précédent : puisque les choix touristiques sont, depuis l’automobile, à portée de main du Québécois moyen, il était (presque) prévisible que la population elle-même dise ce qu’elle attend du tourisme et ce qu’elle offre à ses voisins. En effet, tous et toutes ont désormais la possibilité de vérifier les affirmations des promoteurs, de comparer tel site de villégiature à celui qu’a photographié le voisin, de prendre conscience de ce que le tourisme coûte et de ce qu’il peut rapporter. Pourquoi, dès lors, ces innombrables touristes virtuels ne deviendraient-ils pas les publicistes de leur milieu de vie ? Pourquoi, puisqu’ils savent l’efficacité sur eux des slogans publicitaires, ne coifferaient-ils pas d’une épithète aguichante leur propre cadre de vie ? Quitte à s’inspirer, dans le choix des superlatifs, des appellations qui les attirent eux-mêmes à l’étranger ou dont le prestige est dans l’air.
Voilà donc des dizaines de municipalités en mode publicitaire. Ici et là, c’est le produit local qui sert d’étendard, depuis la pomme de Rougemont jusqu’au lin de Saint-Léonard. Ailleurs, c’est une activité créée de toutes pièces qui sert de tremplin : vol libre au Mont-Saint-Pierre, montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu, omelette géante à Granby… Ailleurs encore, c’est à une nature caractéristique que l’on demande de titiller les regards étrangers : Salaberry-de-Valleyfield vante sa parenté avec Venise, le cap Wolstenholme, comme Gaspé, se présente en point ultime avant l’océan, le réservoir de Manicouagan intrigue même les astronautes… Et, comme il se doit, le passé sollicite ceux qui veulent connaître leurs origines pour mieux façonner l’avenir : le Haut-Richelieu renippe ses forts, la Grosse-Île tisonne de douloureux souvenirs, Saint-Denis honore les patriotes et Saint-Jean-Port-Joli, les émules de Médard Bourgault…
Dorion et Lahoud savent apaiser finement l’inflation touristique. Même si photographies et bilans témoignent de mérites réels, la vraie Venise demeure où elle est, la Petite Italie de Rosemont doit respect à celle de New York, Compostelle attire plus que Sainte-Anne-de-Beaupré. En souriant, on fait savoir qu’ici aussi la tentation est forte d’imiter les rodomontades de Tartarin et les « greatest of the world » de nos voisins. À trop vanter le clocher, on risque d’en adopter l’esprit…
Ëtre vu et se voir
Vu sous l’angle du tourisme, le Québec aura donc connu une autre révolution tranquille. D’abord patrouillé par une strate sociale privilégiée, il ne pouvait mettre en évidence qu’une partie de ses atouts : le rouet était un symbole, la sauvagerie un cliché, le clocher une constante. Tablant sur l’engouement de leur clientèle pour un Québec enfermé dans les stéréotypes, embauchés par des empires maritimes ou ferroviaires aux actionnaires distants, les publicitaires s’en tenaient forcément à un Québec partiel. L’entrée en scène de l’automobile bouscula les habitudes et les références : nouvelles clientèles, autres sources de fierté, meilleure communication entre la société réelle et ses chantres. Et les localités ont fourni leur part d’efforts. Peut-être ces deux ouvrages racontent-ils l’histoire d’une révolution pas si tranquille.
1. Marc H. Choko, Michèle Lefebvre et Danielle Léger, Destination Québec, Une histoire illustrée du tourisme, L’Homme, Montréal, 2013, 348 p. ; 34,95 $.
2. Henri Dorion et Pierre Lahoud, Le Québec autrement dit, Et un tour du monde en surnoms, L’Homme, Montréal, 2013, 272 p. ; 37,95 $.
EXTRAITS
Dans son récit de voyage de 1861, Maurice Sand prête à des touristes américains une réflexion qui pourrait bien être celle de maints vacanciers, toutes époques confondues : « J’ai été aussi loin qu’on peut aller sans changer mes habitudes ».
Destination Québec, p. 48.
La Basse-Ville, qui loge longtemps les Canadiens français les moins bien nantis, est explorée par les touristes les plus téméraires, curieux d’observer le mode de vie anachronique de ses habitants.
Destination Québec, p. 146.
Les annales touristiques sont ponctuées d’épisodes témoignant de l’attrait durable qu’exercent la figure de l’autochtone et les modes de vie des communautés amérindiennes. Pour les visiteurs de marque européens, notamment les artistes de la scène, cette visite chez les Amérindiens revêt un caractère quasi protocolaire et constitue un temps fort de leur séjour en terre d’Amérique.
Destination Québec, p. 68.
Coaticook est une des dix agglomérations québécoises qualifiées de perles, avec Ville-Marie, Plessisville, Roberval, Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Lambert, Percé, Sainte-Rose-du-Nord, Shawinigan et Hull (avant son incorporation dans la ville de Gatineau). Il serait périlleux, et surtout délicat, de juger de la pertinence de tels surnoms ou d’établir une hiérarchie de ces villes et villages ennoblis. Il appartient à chacun d’en juger.
Le Québec autrement dit, p. 30.
Petite note toponymique amusante : le village de Rivière-au-Renard est situé dans le canton de Fox, dont le nom semble honorer la mémoire d’un homme d’État anglais, Charles James Fox, qui s’était opposé à la séparation de la colonie en Haut-Canada et Bas-Canada. Effet du hasard ou traduction ?
Le Québec autrement dit, p. 127.
Saint-Denis – le Village des patriotes.
On définit le patriote comme une personne qui, aimant sa patrie, est prête à la servir. Or, servir sa patrie n’est pas nécessairement servir ses maîtres. Il arrive que, devant leur injustice, le patriotisme prenne une autre couleur et devienne contestation et même révolte
Le Québec autrement dit, p. 200.









