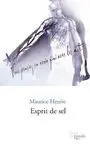Le titre est au diapason du texte : il promet un décapant que l’ouvrage répandra avec efficacité, culture et bonne humeur. Caustique, l’auteur sait l’être à ses dépens autant qu’à ceux des clichés, des scléroses, des frilosités. Il s’applique même une médecine plus sévère qu’à ses contemporains. Il estime, par exemple, avoir déjà dit tout ce qui, à ses yeux, « valait la peine d’être dit », alors que le lecteur a sous les yeux la preuve qu’Henrie doit écrire encore et encore. En déclarant qu’il n’écoute plus d’histoires et n’en lit plus, Maurice Henrie, une fois encore, sous-estime indûment sa propre production. On lui doit, en effet, plusieurs superbes romans : Le balcon dans le ciel (Prise de parole, 1995, prix Trillium), La chambre à mourir (L’instant même, 1988), Une ville lointaine (L’instant même, 2001)…
La sévérité de l’auteur se justifie mieux à propos d’autrui. Quand un bilingue rencontré par hasard troque l’anglais pour sa pitoyable langue maternelle, Henrie ne lui trouve plus le moindre charme : « La bulle éclate. Mon amitié offerte se résorbe d’un coup. Malgré moi ». La gent politique encourt le même anathème : « Pour bien réussir, les politiciens doivent faire la preuve qu’ils sont capables d’atteindre et de maintenir un niveau minimum de médiocrité. Il faut aussi qu’ils jouissent d’une lenteur d’esprit véritable, que viennent seconder une dignité onctueuse et une confiance abusive en leurs moyens ». Des noms viennent aussitôt à l’esprit… L’économie nord-américaine ? « Elle récompense richement les enragés du muscle et de l’endurance, les tapeurs de balles et les lanceurs d’objets de toutes formes. Mais elle n’a jamais pu ou voulu incorporer dans son jeu, c’est-à-dire reconnaître publiquement et remercier adéquatement, ceux qui font progresser, par exemple, la physique nucléaire ou la médecine. »
Comme dans plusieurs de ses ouvrages précédents, Maurice Henrie accorde toute sa place au thème de la mort. « On se détourne instinctivement de la mort, écrit-il. On accuse même de morbidité celui qui ose en parler ouvertement. Surtout s’il en parle souvent, ce qui est trop souvent. » Ce souci est chez lui signe de bon sens, preuve de lucidité, gage de liberté. Tant pis pour les craintifs !
Voilà un grand essayiste qu’on souhaite tolérant à l’égard du grand romancier qui lui est lié.