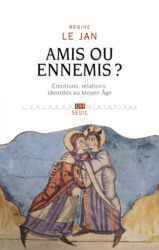Ma première lecture du Journal dénoué remonte à l’été 1976. J’habitais alors Saint-Hyacinthe et c’est perdu au parc Casimir Dessaules que je le traversai, entre Gérard de Nerval et Antonin Artaud, J.R.R.Tolkien et Carlos Castañeda. Je crois bien que ce livre fut l’un de ceux qui me conduisirent le plus franchement à ce qui allait me permettre, non sans quelques incroyables ratés, d’accéder à la vie, c’est-à-dire à mes études en littérature. C’est pourquoi je lui conserve aujourd’hui encore tout mon respect, en autant que cela ait quelque sens s’agissant du récit de l’initiation qu’un homme se donne à l’idéal fou à travers les textes. Voilà qui explique mon émotion à le reprendre près de 30 ans plus tard.
En fait, je viens de redécouvrir que nombre de ceux qui comptèrent parmi mes auteurs furent au départ ceux de Fernand Ouellette. Non pas que les André Suarès, Rainer Maria Rilke, Fédor Dostoïevski lui eussent appartenu en propre, loin de là. Ils sont le fait d’une génération. Mais la manière dont il soumit Henry Miller (il commença par Tropique du Capricorneet moi par Tropique du Cancer), Pierre Jean Jouve (un de mes premiers travaux universitaires porta sur En miroir), Léon Bloy, SSren Kierkegaard et Friedrich Novalis, entre autres, m’apparaît maintenant d’une telle intensité – on sait qu’elle irradie de François d’Assise – qu’il est presque grossier de réduire cette œuvre à l’Hexagone, quelle que soit l’importance de ce mouvement dans notre petite littérature. Ouellette, homme des cimes conjuguant très jeune illumination et action, inscrit en chaque mot le sens sanguin de l’extrême, la direction du tragique. Condamné à l’irrémédiable, au poids du surmoi, il tente de s’échapper par les cieux pour mieux retomber dans le corps. La musique aussi, celle de Mozart et de Varèse, l’ouvre à la luminosité, à la densité de l’humain, à sa violence et sa dignité, à sa hauteur et son ignominie.
Fernand Ouellette est le poète québécois qui me fit entrevoir, par son « histoire intérieure », siège de son mi-dire, manière d’énoncer la vérité, l’incandescence et la fébrilité, l’intensité de la langue et de la pensée lorsqu’elles se rencontrent dans la chair passionnée et translucide. De cela, je le remercie.