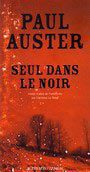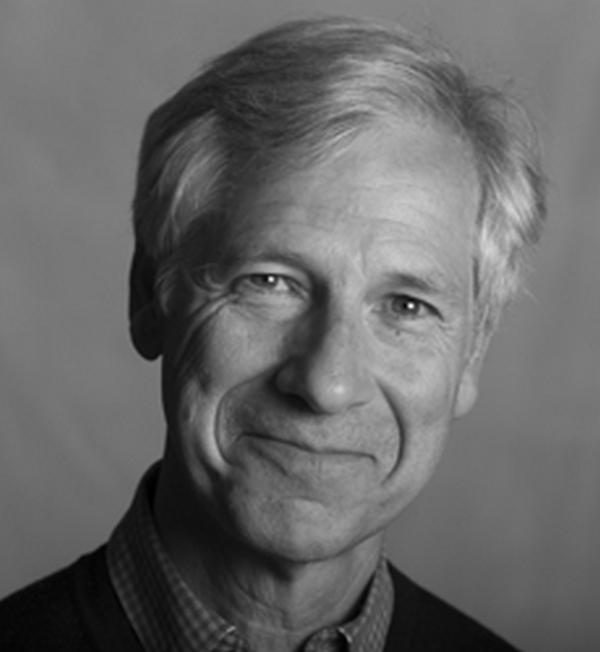« Seul dans le noir, je tourne et retourne le monde dans ma tête tout en m’efforçant de venir à bout d’une insomnie, une de plus, une nuit blanche de plus dans le grand désert américain. » Ainsi débute le tout dernier roman de Paul Auster, Seul dans le noir1, le propos résumé en une seule phrase, le ton et le style donnés dès le coup d’envoi (sobre, rythmé, efficace), le lecteur attaquant déjà la seconde phrase : « À l’étage, ma fille et ma petite-fille sont endormies, seules, elles aussi, chacune dans sa chambre ».
Tour à tour, le narrateur nous livrera par bribes l’histoire de sa fille qui ne parvient pas à se remettre d’une séparation et qui cherche à sa façon à fuir le monde en écrivant une biographie de Rose Hawthorne (la plus jeune des trois enfants de Nathaniel Hawthorne), celle de sa petite-fille fortement éprouvée par la mort atroce de son jeune amant parti travailler en Irak, et la sienne, celle d’un critique littéraire à la retraite âgé de 72 ans, condamné à l’immobilité à la suite d’un accident de voiture, absurde comme tous les accidents, dévastateur comme tout ce qui remet en question une vie, les choix que l’on a faits comme ceux que l’on n’a pas faits. Pour échapper à sa situation, il invente des histoires, une histoire en fait : celle d’un pays fédéré qui se désintègre de l’intérieur.
Tout au long du roman, les récits se croisent et s’entrecroisent, chacun d’eux faisant écho aux autres, aux drames qui s’y jouent. Dans cette mise en abyme habilement menée, où la notion de mondes parallèles, empruntée à Giordano Bruno, ajoute par moments une teinte fantastique au récit, le narrateur se projette lui-même dans une invraisemblable histoire (mais l’est-elle vraiment ?) où certains États américains optent pour la sécession afin de se soustraire à la bêtise d’un président qui a plongé le pays dans un incommensurable chaos, thème cher à Paul Auster, qui prend ici une importance accrue. Le personnage principal, un magicien au nom très austérien d’Owen Brick, se retrouve malgré lui plongé au cœur du conflit dont il cherche d’abord à nier l’évidence pour se soustraire à la mission qu’on lui a assignée : assassiner nul autre que le narrateur du récit qui prend forme au fil des pages puisque, imaginant cette guerre, il en est responsable et, en l’éliminant, c’est aussi la guerre qu’on éradiquera. Logique implacable de mondes parallèles s’imbriquant l’un dans l’autre comme un puzzle pour enfants surdoués.
Seul dans le noir ne doit pas être perçu comme la réponse de Paul Auster aux événements du 11 septembre, au sens où l’auteur chercherait à expliquer l’inexplicable. Qui plus est, ces événements, comme pour mieux confondre Owen Brick, n’ont jamais eu lieu dans cette Amérique au décor de carton-pâte qui n’est pas sans rappeler la vision hollywoodienne du rêve américain. Les questions importent ici davantage que les réponses, le roman s’inscrivant dans la poursuite de la quête d’identité entreprise depuis la trilogie new-yorkaise. L’effondrement de la société, tel qu’imaginé dans Le voyage d’Anna Blume, atteint toutefois une intensité nouvelle.
Plus que dans les autres romans, Paul Auster met le lecteur face à sa propre inaction, prolongement de la paralysie de ses personnages, qui tous cherchent à se soustraire à leur situation présente, ce qu’illustre cet échange entre deux protagonistes : « Alors, demande le personnage du magicien à sa conjointe qui a été mise au courant de la mission qu’il doit accomplir, qu’est-ce que je dois faire ? Rien, lui répond-elle. Comment ça, rien ? On recommence à vivre, poursuit-elle. Tu fais ton boulot, moi le mien. On mange, on dort, on paie les factures. On lave la vaisselle et on passe l’aspirateur. On fait un bébé ensemble. Tu me mets dans la baignoire et tu me shampouines les cheveux. Je te frotte le dos. Tu apprends des nouveaux tours. On va voir tes parents, et on écoute ta mère se plaindre de sa santé. On continue, mon chou, on vit notre petite vie. Voilà ce que je veux dire. Rien ».
L’absence de démarcation entre chacune des histoires, et entre chaque type de discours, accentue l’impression qui se dégage du roman, celle d’une longue nuit entrecoupée de moments d’angoisse, d’accalmie et d’espoir. Le traitement romanesque vise à tout ramener sur un même plan : l’échange entre les personnages, l’action imaginée par le narrateur et la condition de ce dernier qui le confine à l’immobilité, reclus dans une chambre d’une maison où sa fille et sa petite-fille cherchent aussi à réapprendre à vivre. Le constat qui s’en dégage est dur, voire impitoyable lorsqu’on passe en revue les événements qui ont marqué la vie des personnages : abandon, mort violente, incapacité d’agir. N’étaient la tendresse, la complicité qui unit les personnages, voire par moments un certain humour de situation, le roman serait des plus sombres. Mais tel n’est pas le cas.
Et ce monde étrange continue de tourner, rappellera au narrateur sa fille qui a retenu ce vers de Rose Hawthorne pour illustrer sa propre thèse. Quant au romancier, il clôt son propos en réunissant dans une dernière phrase, comme le ferait un dramaturge en rappelant sur scène ses personnages avant la tombée du rideau, les trois protagonistes mis en scène dès le début du roman : « Oui, papa, dit-elle, en examinant sa fille d’un œil soucieux, ce monde étrange continue de tourner ».
1. Paul Auster, Seul dans le noir, trad. de l’anglais (états-Unis) par Christine Le Bœuf, Actes Sud, Arles/Leméac, Montréal, 2009, 182 p. ; 25,95 $.
EXTRAITS
Il n’y a pas qu’une seule réalité, caporal. Il existe plusieurs réalités. Il n’y a pas qu’un seul monde. Il y en a plusieurs, et ils existent tous parallèlement les uns aux autres, mondes et antimondes, mondes et mondes fantômes, et chacun d’entre eux est rêvé ou imaginé ou écrit par un habitant d’un autre monde. Chaque monde est la création d’un esprit.
Seul dans le noir, p. 75.
C’est comme si on entrait dans un rêve, n’est-ce pas ? Le même endroit, mais tout est différent. L’Amérique sans guerre. C’est difficile à digérer. On prend tellement l’habitude des combats que ça s’insinue en nous, dirait-on, jusqu’à l’os, et au bout d’un certain temps on ne peut même plus imaginer un monde sans guerre.
Seul dans le noir, p. 116.
Nous voici au cœur des choses, au cœur obscur de la nuit noire, encore quatre bonnes heures à tirer et tout espoir de dormir totalement anéanti. La seule solution, c’est d’abandonner Brick, de m’assurer qu’il aura un enterrement convenable, et d’inventer une autre histoire. Quelque chose de terre-à-terre, cette fois, qui fasse contrepoids à la machine fantastique que je viens de fabriquer. Giordano Bruno et la théorie des mondes multiples. Matière à provocation, certes, mais d’autres pierres, aussi, méritent qu’on les déterre.
Seul dans le noir, p. 123.