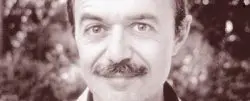Romancier, essayiste et journaliste (il a dirigé le magazine Lire), Pierre Assouline est l’auteur de plusieurs biographies remarquées (Hergé, Georges Simenon, Gaston Gallimard, Albert Londres, etc.). Son dernier roman, Lutetia (Gallimard), a obtenu en 2005 le prix Maison de la presse. Il rédige aussi, depuis quelques années, un blog littéraire très suivi, « La république des livres ».
Pierre Assouline a publié, l’an dernier, un ouvrage intitulé Rosebud, qui se veut une méditation sur le métier de biographe à travers l’exploration de plusieurs « éclats de biographies » consacrés à des personnages aussi différents que Paul Celan, Rudyard Kipling, Jean Moulin, Pierre Bonnard ou Henri Cartier-Bresson.
Nuit blanche : L’écriture de Rosebud a dû vous demander beaucoup de travail, car on y trouve, en somme, la matière de cinq ou six biographies différentes.
Pierre Assouline : En effet, l’écriture de ce livre m’a pris beaucoup de temps, beaucoup plus que je ne l’aurais cru. Pour pouvoir écrire trente pages biographiques sur chacun de mes personnages, j’ai dû lire et travailler autant que si j’avais écrit tout un livre sur chacun d’eux, car la recherche de base est pratiquement toujours la même. Par ailleurs, pour écrire ces trente pages, il a fallu que je condense la documentation accumulée ; or, pour condenser, il me fallait nécessairement avoir réuni une abondante matière dès le départ. Je me suis donc laissé prendre au jeu. Pour rédiger le texte sur Rudyard Kipling, par exemple, j’ai lu toute son œuvre et tout ce qui a été écrit sur lui ; cette tâche m’a occupé pendant des mois et des mois. Je n’imaginais pas tout le travail préparatoire que ces « éclats de biographies » pouvaient représenter. Je ne le regrette pas, mais ça a été extrêmement long.
Dans Rosebud, le portrait que vous faites du poète Paul Celan est particulièrement émouvant. J’ai cru comprendre que vous appreniez l’allemand en vue de mieux vous préparer à rédiger sa biographie.
P. A. : J’apprends l’allemand pour mieux appréhender la poésie de Celan, et aussi dans l’intention d’écrire un jour un livre sur lui. Mais je ne me sens malheureusement pas prêt à faire sa biographie. Je pars du principe que lorsqu’on écrit la biographie d’un écrivain, justement, il faut comprendre parfaitement sa langue, pour la simple et bonne raison qu’il faut d’abord se plonger dans ses archives. La bibliothèque de Celan est pleine de livres abondamment annotés par lui en allemand ; je ne suis pas encore assez bien outillé pour m’attaquer à toute cette documentation. Je sais que d’autres biographes feraient traduire ces notes, qu’ils engageraient des documentalistes ; je préfère faire ce travail moi-même, et comme je ne parle pas assez bien la langue de mon « héros », cela me paraîtrait très difficile.
« Je n’ai jamais eu autant de mal à finir un livre », écrivez-vous à la fin de Rosebud. D’où vous est venue cette difficulté ?
P. A. : Ce livre, en fait, n’a pas de véritable conclusion. J’aurais pu écrire plusieurs chapitres supplémentaires, car j’ai d’autres essais du même genre qui attendent dans mes cartons. À vrai dire, j’ai suffisamment de matériel pour publier, si je le voulais, deux autres volumes de Rosebud. De plus, une biographie, c’est une tâche sans fin ; alors cinq biographies en une, c’est un travail cinq fois inachevé. Pour ajouter encore à cette impression d’incomplétude, j’ai choisi de terminer mon livre sur un chapitre tout entier consacré à l’inachèvement en art.
Il y a beaucoup d’échos d’un texte à l’autre : ainsi, dans plusieurs chapitres, il est question du suicide et du rapport au père ; Rudyard Kipling et Paul Celan composent tous deux un poème dédié à leur fils ; Cartier-Bresson – à qui un chapitre est consacré – réapparaît dans le texte consacré au peintre Pierre Bonnard À l’origine, Rosebud a-t-il été conçu selon une structure, une méthode – à travers des jeux d’opposition ou de rapprochement entre les chapitres consacrés aux différents personnages ?
P. A. : J’ai d’abord rédigé les chapitres séparément ; au départ, ils n’ont donc rien à voir les uns avec les autres – sauf évidemment l’intérêt du biographe. Le dernier chapitre, qui porte principalement sur Bonnard, s’est imposé de lui-même parce que, comme je l’ai dit, il traite de l’inachèvement. Pour les autres parties, je ne m’étais pas fixé de règles.
Cela dit, j’ai quand même tenu à mettre au centre du livre un texte un peu plus léger, un peu plus souriant : « Les chaussures neuves de Mr. Owen », portant sur les subtilités de ce qu’il est convenu d’appeler le « snobisme » anglais. Il m’est apparu que plusieurs chapitres de Rosebud – ainsi ceux qui sont consacrés à la mort du fils de Rudyard Kipling, au suicide de Paul Celan, à la tentative de suicide de Jean Moulin, par exemple – pouvaient paraître un peu sombres. En ce sens, on peut dire qu’il y a effectivement des échos, des résonances d’un texte à l’autre. Il y a ce qui est prévu et ce qui n’est pas prévu.
Si je ne me trompe pas, Rosebud est votre premier véritable essai littéraire – selon le sens que lui donne le critique Jean Marcel : un « discours réflexif » élaboré par un « JE non métaphorique », portant sur un « objet culturel » au sens large.
P. A. : Oui. De tout ce que j’ai écrit, c’est le premier ouvrage qui possède clairement ce caractère. C’est exactement ce que je voulais faire. Après la parution de mon roman Lutetia – qui a connu un grand succès –, j’aurais pu écrire un autre ouvrage de fiction, mais j’ai renoncé à le faire parce que je devais écrire cet essai. Le succès de Rosebud sera peut-être moindre que celui de Lutetia, mais la question n’est pas là.
Vous avez éprouvé le besoin d’utiliser le « je » dans un livre ?
P. A. : En fait, après avoir écrit dix biographies, j’ai surtout voulu contribuer, avec cet essai, à une réflexion sur le renouvellement du genre. Il me semble en effet que la biographie, en France, commence à se tarir, à se fossiliser. D’abord, le public en est moins friand ; ensuite, les biographes ont un peu épuisé les sujets et les héros ; ils n’ont pas vraiment cherché à les renouveler. On continue à publier des ouvrages sur les rois de France alors que les lecteurs ne suivent plus. J’ai eu envie de chercher des voies nouvelles. On me propose encore souvent d’écrire des biographies traditionnelles, ça ne m’intéresse pas de recommencer tout de suite ; je cherche autre chose. C’est l’époque autant que la personne qui m’intéresse : quand j’ai écrit Le dernier des Camondo, par exemple, j’avais l’idée de faire un récit plus qu’une biographie. Là aussi je cherchais autre chose. Maintenant, le Rosebud, comme « genre » littéraire, pourrait susciter, chez les autres comme chez moi, une autre façon de pratiquer l’art de la biographie.
Croyez-vous que la biographie mène nécessairement à l’autobiographie ?
P. A. : Dans tout ce qu’on écrit on est plus ou moins autobiographe : en direct, de biais, de manière frontale ou indirecte, on parle toujours de soi, qu’on le veuille ou non. Pour moi, l’autobiographie ou les mémoires d’un biographe se révèlent à travers ses livres, dans la mosaïque de ses biographies. André Maurois constitue un bon exemple de ce phénomène : il a écrit ses mémoires, qui ne sont guère intéressants. En revanche, si vous prenez ses biographies les plus connues – celles de Disraeli, de Shelley, de Byron, de Victor Hugo – et que vous les lisez l’une après l’autre, vous aurez un autoportrait en creux de Maurois.
La critique a souvent dit que Paul Celan cherchait, dans ses poèmes, à traduire la condition émiettée de l’homme moderne. La pratique du Rosebud ne serait-elle pas aussi une autre façon de traduire cet émiettement ?
P. A. : Je le crois. C’est une façon de s’intéresser à la vérité d’un homme plus qu’à l’exactitude des événements de son existence. Il s’agit de chercher la trace plutôt que la preuve, car ce sont les fragments et les détails qui font sens chez les gens.
À quelques reprises, dans Rosebud, vous évoquez la singulière faculté qu’ont les biographes d’agir comme des « médiums », d’être hantés par les personnages qu’ils étudient. Je pense aux nombreuses suites de coïncidences – vous utilisez le terme connivences, les surréalistes, eux, parleraient sans doute de hasards objectifs – qui vous ont frappé pendant vos recherches : les points de contact « historiques » entre Balzac et Picasso, la chaîne de hasards qui relie Paul Celan, Mirabeau, Apollinaire, Beckett Sans parler des liens mystérieux qui, au hasard des livres à écrire, vous ramènent souvent au parc Monceau. Pensez-vous que le biographe possède un don, une faculté particulière ?
P. A. : Ce n’est sans doute pas un don, mais on peut supposer que le biographe a une sorte de prédisposition. Vous citez Paul Celan et Samuel Beckett : en écrivant mon livre, je me demandais si ces deux grands auteurs s’étaient connus pendant qu’ils vivaient à Paris. Or, quand on a retrouvé le corps de Celan dans la Seine, après son suicide, il y avait dans son portefeuille deux billets pour une représentation d’En attendant Godot. On pouvait déjà voir, dans cette coïncidence, un rapprochement possible entre les deux écrivains, mais on m’a assuré qu’ils ne s’étaient pas connus. Par la suite je me suis rendu à l’École normale supérieure (ENS) pour consulter des archives. Le directeur m’a révélé que Beckett et Celan avaient tous deux été, au même moment, répétiteurs à l’ENS – l’un en anglais, l’autre en allemand – mais on m’a répété qu’ils ne s’étaient pas connus ou qu’ils n’avaient pas osé se parler. Je me suis dit : quand même, c’est incroyable, quel dommage que cette rencontre n’ait pas eu lieu
Je termine donc mes recherches, je sors de la salle avec le responsable des archives Paul Celan, qui me demande de le suivre. Il me montre alors un auditorium « Beckett » et, juste à côté, un auditorium « Celan ». Le chapitre de Rosebud consacré à Paul Celan se termine sur cette rencontre virtuelle entre les deux écrivains.
Je me suis dit : c’est un signe. Pour attraper ce signe il faut être biographe, parce que le biographe est prédisposé à interpréter les hasards. Cette qualité est similaire à celle d’un bon photographe qui voit d’abord, dans une scène de rue, des lignes géométriques et des volumes ; l’image se trouve immédiatement découpée dans son regard. Le photographe a une prédisposition naturelle ; il voit une composition là où vous et moi ne voyons qu’une image banale. Il ne s’agit pas d’un don inné, mais à force d’exercer cette faculté, elle se transforme en une prédisposition presque naturelle.
En un mot : un biographe, c’est quelqu’un qui est apte à capturer les signes au bon moment, parce qu’il est naturellement attentif aux détails significatifs.
Et maintenant, à quoi travaillez-vous ?
P. A. : Je suis en train d’écrire un roman qui, comme Lutetia, sera basé sur une enquête. Je cherche à décrire le monde et la société française tels qu’ils sont observés, au fil des siècles, par un personnage qui se trouve dans un tableau de Dominique Ingres : La baronne Betty de Rothschild. Cette personne, sur cette toile, regarde le monde, partout où elle est accrochée, et elle raconte ce qu’elle voit.
Pierre Assouline a publié :
Biographies : Monsieur Dassault, Balland, 1983 ; Gaston Gallimard, Balland, 1984, Folio, 2006 ; Une éminence grise, Jean Jardin, Balland, 1986, Folio, 1988 ; L’homme de l’art, D. H. Kahnweiler, Balland, 1987, Folio, 1989 ; Albert Londres, Vie et mort d’un grand reporter, Balland, 1989, Folio, 1990 ; Simenon, Julliard, 1992, Folio, 1998 ; Hergé, Plon, 1996, Folio, 1998 ; Le dernier des Camondo, Gallimard,1997, Folio, 1999 ; Cartier-Bresson, L’œil du siècle, Plon, 1999, Folio, 2001 ; Grâces lui soient rendues, Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes, P1on, 2002, Folio, 2004 ; Rosebud, Éclats de biographies, Gallimard, 2006.
Romans : La cliente, Gallimard, 1998, Folio, 2000 ; Double vie, prix des Libraires, Gallimard, 2001, Folio, 2002 ; État limite, Gallimard, 2003, Folio, 2005 ; Lutetia, prix Maison de la presse, Gallimard, 2005, Folio, 2006 ; Le portrait, Gallimard, 2007.
Récit : Le fleuve Combelle, Calmann-Lévy, 1997, Folio, 2004.
Entretiens : Le flâneur de la rive gauche, avec Antoine Blondin, François Bourin, 1988, La Table Ronde, 2004 ; Singulièrement libre, avec Raoul Girardet, Perrin, 1990.
Enquêtes : De nos envoyés spéciaux, avec Philippe Dampenon, J. C. Simoën, 1977 ; Lourdes, Histoires d’eau, Alain Moreau, 1980 ; Les nouveaux convertis, Albin Michel, 1982, Folio, 1992 ; L’épuration des intellectuels, Complexe, 1985, réédition augmentée, 1990 ; Musulmanes : une chance pour l’islam, Folio, 1992 ; Germinal, L’aventure d’un film, Fayard, 1993.