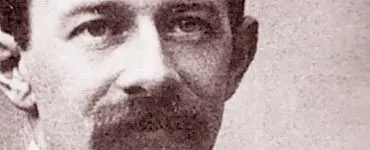Ni le Grand Prix de littérature de l’Académie (1942) ni le Grand Prix national des lettres (1955) n’ont suffi à assurer à Jean Schlumberger une place dans l’histoire de la littérature, une place que lui-même n’aura pas disputée très âprement. La vanité l’indispose.
S’il existe un type du bon deuxième, Jean Schlumberger le représente assez bien, installé, dirait-on, à l’ombre des grands, dont André Gide, au premier chef, l’ami de longue date avec qui, en compagnie de quelques autres (dont Jacques Copeau et Marcel Drouin), il va fonder la Nouvelle Revue Française en 1909.
Jean Schlumberger en écrit l’article inaugural, « Considérations », où il signale l’orientation générale de la revue. C’est à Gide qu’il consacrera, jusqu’à la mort de celui-ci en 1951, de nombreuses pages de ses Carnets (restés en grande partie inédits jusqu’au travail récent de Pascal Mercier1). Pourtant, ni le talent ni les compétences ne lui font défaut : en administrateur éclairé, Schlumberger savait tirer les ficelles (il juge d’ailleurs « Gide toujours un peu comique quand il opine gravement sur des questions administratives auxquelles il n’entend rien ») ; sa diplomatie et son sens des affaires sont reconnus. C’est à ses talents que firent justement appel les Gallimard quand tour à tour ils lui firent part de leurs doléances respectives dans une histoire de succession. « De mieux en mieux, note-t-il alors, je découvre les obstacles psychologiques qui rendent difficiles les solutions simplistes. » C’est qu’on avait l’habitude et le sens des affaires dans la famille de riches industriels protestants dont est issu Schlumberger.
L’amère paternité
De ces jeux de coulisses, on en retrouvera dans les principaux récits de Jean Schlumberger. Le lion devenu vieux en est rempli. Saint-Saturnin leur fait également la part belle. Je considère comme une œuvre majeure, voire un chef-d’œuvre, ce dernier roman auquel échappa le Goncourt (deux voix contre sept en faveur de Mal d’amour de Jean Fayard). On comprend très mal, à relire cette saga de la famille Colombe, que l’Histoire ne l’ait pas retenue, qu’il n’en soit pas plus question que de Schlumberger lui-même dans les manuels et les histoires de la littérature.
Comme plusieurs de ses romans et récits, Saint-Saturnin explore les liens familiaux, plus particulièrement les relations paternelles, sous un angle qu’indiquait assez bien le titre d’un de ses plus anciens livres, L’inquiète paternité, récit de jeunesse sans grande portée littéraire, dont le propos et certains éléments formels annoncent néanmoins le meilleur de l’œuvre. Chez Jean Schlumberger, l’ascendant féminin, voire plus proprement maternel, compromet d’entrée de jeu cette paternité. Il écrit dans Un homme heureux: « Durant deux générations, les femmes, dans notre famille, ont surpassé les hommes en force de caractère. […] [U]ne moitié de ma vie s’est passée à corriger ce qu’une éducation conduite par des femmes – fussent-elles éminentes – laisse de débile dans un homme ». C’est ce qui incline le vieux William Colombe, dans Saint-Saturnin, à dire : « Le père de famille ! […] Quand les hommes d’aujourd’hui se servent de ce mot, on croirait qu’ils n’en connaissent plus le sens ». D’un autre monde est William Colombe, personnage central du roman, propriétaire du domaine familial de Saint-Saturnin. D’un autre ordre, d’un système voué à l’effritement puis à la disparition, une disparition prochaine marquée par celle de sa femme, Elisabeth, dont l’agonie et la mort ouvrent le récit. Leurs trois enfants sont réunis, dont les deux fils, Louis et Nicolas, symboles respectifs de la continuité et du renouveau, qui mettront en œuvre plusieurs moyens pour préserver l’héritage. C’est là le propos du roman, la fin d’un monde, illustrée par la double faillite du père : perte progressive de la raison (il ira jusqu’à se comparer très favorablement à Napoléon) et dilapidation de la fortune dans des affaires plus que douteuses, affaires auxquelles mettra un frein in extremis le jeune Gilbert de Sinnis, un des petits-fils de William, jeune homme rompu à la discipline et à la stratégie militaires. S’il se révèle ainsi dangereusement ouvert sur l’extérieur, le domaine ancestral n’en est pas moins un monde essentiellement clos, et cette clôture est manifeste sur le plan romanesque, car l’action se déroule toute à l’intérieur des limites du domaine. Les seuls échos de Paris sont rapportés, et ailleurs n’atteint Saint-Saturnin que par le biais de lettres que s’échangent les protagonistes. Significativement, les ancêtres Colombe se sont portés acquéreurs d’une maison dont les précédents occupants n’avaient laissé aucun descendant (« Ils sont morts sans ; que l’oubli les emporte ! »). Cette table rase indique combien tout est du pur Colombe, aussi bien dans cette maison « construite en matériaux qui vont durer des siècles » que sur le domaine. Pourtant, si solides soient-elles, les fondations en sont ébranlées. La paternité se révèle fragile et incertaine, quand elle n’est pas carrément honnie ou refusée : haine de Gilbert pour son père, mépris de William pour son fils Nicolas, qu’il qualifie d’eunuque et de raté. Les autres romans témoignent d’une désaffection similaire. La tendresse que Richard Eydieu (Un homme heureux) ne peut donner à son fils ni ne trouve chez lui, il la reporte sur l’enfant de sa maîtresse. Dans L’inquiète paternité, déjà, Cyrille s’en prétendait dégoûté avant d’aimer ce fils dont il apprendra qu’il n’est pas de lui mais de l’ami chéri et disparu. Comme le dit un personnage du Lion devenu vieux : « Il y a brouille entre son mari et son fils aîné. […] J’ai promis de tout faire pour les réconcilier. L’Abbé dira ce qu’il voudra : c’est aussi rétablir l’ordre que de remettre bien les fils avec les pères ». Réparer, rétablir, réconcilier, c’est une tâche à laquelle s’emploieront plusieurs des personnages de Schlumberger. La tentative de réhabilitation de la mémoire d’autrui constitue l’autre thème majeur de l’œuvre. « Ce n’est pas mon apologie que je suis impatient d’écrire, c’est leur louange », écrit Blaise Eydieu à son fils à propos de sa femme et de ses parents, « trois figures à tant d’égards admirables ». Tâche au demeurant ingrate et malaisée : « […] il me semble avoir constamment trahi ceux que […] je souhaitais servir ».
Un homme peut-il atteindre le meilleur de lui-même, un homme peut-il donner sa pleine mesure ? Une vie y suffit-elle ? C’est une des questions omniprésentes dans les romans de Schlumberger. Ou bien l’on est soi-même et pour soi-même son propre apologiste, comme le vieux William Colombe, ou bien l’on cherche à restituer la mémoire d’autrui, un camarade ou un parent : ce sont Le camarade infidèle, Le lion devenu vieux, Un homme heureux. À moins que, désireux d’éliminer père et mère et les inconfortables retours sur soi auxquels ils obligent, on propose une sorte d’utopie socialiste et fraternaliste, un monde d’hommes d’où seraient curieusement absents les liens verticaux, c’est-à-dire hiérarchiques (ce sera l’Histoire de quatre potiers, qui met en scène un petit-fils de William Colombe). Comme le proclame le jeune Gilbert de Sinnis, « [l]’homme moderne n’a besoin ni de femmes ni d’enfants ». Le fantasme d’une paternité sans enfant, c’est en quelque sorte celui de Blaise Eydieu, comme c’était celui de Cyrille.
La scène romanesque
On a reproché à Jean Schlumberger d’être moins qu’un romancier, un vulgaire « faiseur de romans » (Henri Clouard). C’était se méprendre ou sur ce qu’est le roman, ou sur la conception qu’en avait l’auteur, de même que sur son évolution comme romancier.
Revenant sur L’inquiète paternité en 1958, au moment où paraissent ses œuvres complètes, Jean Schlumberger lui-même en parlait comme d’« un petit drame construit tout au présent, en scènes rapides, selon l’optique du théâtre plus que du roman ». Cette optique est patente dans Le camarade infidèle, où il se fait plus analytique et plus abstrait. Par son débat sur la notion de fidélité de même que par la transformation de l’espace narratif en une scène où les entrées et sorties des personnages ponctuent le récit et où portes et fenêtres jouent un rôle important, ce récit est doublement cornélien (constat facile, je l’admets, dans la mesure où Schlumberger n’a jamais caché son admiration pour l’auteur du Cid, mais constat qui s’impose). Les dialogues constituent d’ailleurs l’essentiel de l’action proprement dite. Que font les personnages du Camarade infidèle ? Ils parlent. Ils écoutent aussi. Ils surprennent des conversations. On sent que la transposition pour la scène se ferait aisément, au point où on peut avoir l’impression contraire, à savoir que ce récit serait l’adaptation d’une pièce (ce qui n’est pas le cas). Par ailleurs,il n’est pas facile de s’y retrouver lors d’une première (et unique) lecture puisque les personnages jouent, cachent, mentent sur ce qu’ils éprouvent ou savent, et ce, sans que le narrateur omniscient établisse immédiatement la part de vérité, soit les faits concernant Robert Heuland, le camarade défunt de Vernois, le héros du roman. Heuland était un type moyen, plutôt bon à rien, aux dires de sa belle-famille. Mais un bon camarade, apprécié des autres sur le champ de bataille où il meurt dans d’atroces souffrances, déchiqueté par un obus. Vernois trouve sur Heuland mort des lettres de Clymène, sa femme. À la lecture de l’une d’elles, il décide de la rencontrer : entend-il rétablir la vérité sur Heuland ou séduire sa veuve ? Peut-être un projet servira-t-il l’autre.
Le titre est à double entente : ce camarade infidèle, ce peut être Heuland, dont on apprendra qu’il trompait sa femme, et ce peut être Vernois, qui ne sait trop de quel côté faire pencher la balance entre son désir pour Clymène (un prénom classique à souhait) et sa volonté de préserver l’image et le souvenir de Heuland. Il gagne d’ailleurs sur les deux tableaux. S’il trahit Heuland, il le fait favorablement, c’est-à-dire en revalorisant l’image de son camarade mort. Le jeune fils Heuland lui-même sera séduit par Vernois, et une fois de plus une paternité déviée ou biaisée sera envisagée.
Cette tentative de préserver la vérité sur un ami défunt fait également l’objet du Lion devenu vieux, récit magnifique qui réussit à donner le sentiment de lire la langue du XVIIe siècle, non pas en la reproduisant, mais en fabriquant une langue et un ton qui soient à la fois classiques et contemporains. Écriture riche2 et parfois tortueuse. Comme le roman d’ailleurs, où sont entremêlés récits immédiats et récits rétrospectifs, récits du cardinal et sur le cardinal. Ici encore, on baigne dans une atmosphère quelque peu théâtrale, et j’ajouterais : très agréablement théâtrale, faite de dissimulations, de fausses confidences et de vrais mensonges, de tractations, d’hypocrisies et de jeux de coulisses au sein des représentants de l’Église et de la noblesse, qui se battent pour préserver la part de prestige que les révélations contenues dans les Mémoires du cardinal de Retz pourraient leur faire perdre. Jean Schlumberger se montre habile dans la manière de mener une double intrigue : le narrateur doit, à la fois, sauver de la destruction les Mémoires de son maître et réussir à écrire puis à transmettre la lettre où il s’explique, c’est-à-dire le récit que nous lisons.
Récits à la première personne, lettres, monologue intérieur : Jean Schlumberger privilégie les écritures du soi. Même Saint-Saturnin, le plus romanesque de ses romans, alterne entre les interventions d’un narrateur omniscient, les lettres et carnets des différents personnages. Sans en avoir exactement les caractéristiques formelles, certains chapitres s’apparentent au monologue intérieur, une forme à laquelle Schlumberger a parfois recours (voir son recueil de nouvelles Les yeux de dix-huit ans). Il expose l’intériorité des personnages au moyen d’une sorte de dialogue à une seule voix, dialogue qui tient davantage du monologue intérieur que de l’échange. En montrant, par exemple, comment Les yeux de dix-huit ans « concilie deux éléments théoriquement contradictoires », Michel Raimond a bien analysé l’usage habile qu’il en faisait avant de conclure que « [l]a hantise profonde de Schlumberger […] est la lutte à mener par tous les moyens et dans toutes les circonstances contre l’éparpillement du moi3 ». Ce faiseur de romans maîtrise les outils du métier mieux que ne le laisse entendre le critique Henri Clouard.
Comme le vieux William Colombe, Jean Schlumberger est d’un autre âge, d’un autre système de valeurs, d’un autre monde. Ces propos de Gide pourraient très bien être les siens : « Notre époque a brusquement détruit la signification des problèmes qui nous occupaient4 ». Lui-même fera son possible pour se déprendre de ce système ancien, du carcan protestant et de l’avenir que, croyait-il, lui fabriquerait, tout balisé, la tradition familiale, interrompant d’abord ses études en théologie pour se consacrer à l’histoire des religions puis à la littérature, faisant paraître en 1903 un premier recueil qu’il ne jugera même pas bon de reprendre dans ses œuvres complètes (pas plus d’ailleurs que son premier roman, Le mur de verre, qu’il juge naïf). Son œuvre est celle d’un moraliste, au sens fort du terme, c’est-à-dire dénuée de moralisme. En son sens littéraire aussi, comme on dit de Corneille qu’il est moraliste. Et notre incompréhension devant l’oubli dont il a été victime, la mienne en tout cas, est d’autant plus profonde dès lors que je constate la qualité de récits tels que Saint-Saturnin, Le lion devenu vieux, Un homme heureux et Le camarade infidèle.
1. Notes sur la vie littéraire (1902-1968), édition établie et présentée par Pascal Mercier, Gallimard, 1999.
2. Michel Raimond écrit à ce propos : « On songe, devant cette langue appliquée et éclatante, à la prose de Valéry, et à ce fameux monologue de Teste » (La crise du roman, Des lendemains du Naturalisme aux années vingt, Corti, 1966, p. 295).
3. Ibid., p. 293.
4. Notes sur la vie littéraire, op. cit., 1er mai 1933, p. 182.
Œuvres de Jean Schlumberger :
Poèmes des temples et des tombeaux, Mercure de France, 1903 ; Le mur de verre, Ollendorf, 1904 ; Épigrammes romaines, Bibliothèque de l’Occident, 1910 ; L’inquiète paternité, NRF, 1911 ; On naît esclave, en collaboration avec Tristan Bernard, L’Illustration théâtrale, 1912 ; Les fils Louverné, NRF, 1914 ; L’enfant qui s’accuse,NRF, 1919 ; Un homme heureux, NRF, 1921 ; La mort de Sparte, NRF, 1921 ; Césaire ou la puissance de l’esprit, NRF, 1921 ; Le camarade infidèle, NRF, 1922 ; Le lion devenu vieux, NRF, 1924, « L’imaginaire », Gallimard, 1999 ; L’amour, le prince et la vérité, Au sans pareil, 1927 ; Les yeux de dix-huit ans, NRF, 1928 ; Saint-Saturnin, NRF, 1931 ; Histoire de quatre potiers, NRF, 1935 ; Plaisir à Corneille, Gallimard, 1936 ; Essais et dialogues, Gallimard, 1937 ; Stéphane le glorieux, Gallimard, 1940 ; Jalons, Valiquette, Montréal, 1941 ; Le procès Pétain, Gallimard, 1949 ; Éveils, Gallimard, 1950 ; Madeleine et André Gide, Gallimard, 1956 ; Passion, Gallimard, 1956 ; œuvres (quatre tomes), Gallimard, 1958 ; Rencontres, Feuilles d’agenda, Pierres de Rome, Gallimard, 1968 ; In Memoriam, suivi d’Anniversaires, Gallimard, 1991 ; Correspondance 1901-1950, André Gide et Jean Schlumberger, édition établie et présentée par Pascal Mercier et Peter Fawcett, Gallimard, 1993 ; Notes sur la vie littéraire (1902-1968), édition établie et présentée par Pascal Mercier, Gallimard, 1999 ; Correspondance : 1907-1946, Aline Mayrisch et Jean Schlumberger, édition établie et présentée par Pascal Mercier et Cornel Meder, Publications nationales, Luxembourg, 2000.
EXTRAITS
Je comprends aujourd’hui, plus fortement que je n’ai jamais fait, combien toute vie m’est venue de mon père, que ce soit par lui ou contre lui.
Un homme heureux, Œuvres, Gallimard, p. 182.
Vois-tu, mon ami, me dit-il, notre tort c’est de croire que les jeunes gens reprendront jamais nos pensées telles que nous les leur abandonnons. Ils se sont fait un monde à leur usage où tout nous semble déplaisant, où rien n’est plus à la même place que dans le nôtre. Ils ont tout changé : non seulement le présent, mais le passé même. On se retourne et on ne le reconnaît pas.
Le lion devenu vieux, « L’imaginaire », Gallimard, p. 97.