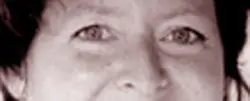Les livres jamais lus sont des regards alignés, parfois plus menaçants qu’invitants. Au fond de l’œil le plus narquois, l’impression de lire : « Tu n’auras pas assez d’une vie ». Depuis les premières bibliothèques visitées, sous ces regards impitoyables, je ressens aussi de la honte, car l’ignorance me fait rougir. Mon ignorance, mais aussi celle des autres quand elle est prise à la légère.
Il y a de beaucoup plus grands lecteurs que moi. Ces personnes sont en général d’agréable compagnie, elles font preuve d’indulgence devant tout ce que je n’ai pas lu et, en même temps, elles me donnent envie de découvrir les œuvres qui les ont marquées. Par contre, il y a des gens qui utilisent leurs lectures comme des faire-valoir et lorsque je me trouve en leur présence, dans des mondanités, j’ai envie de courir et d’aller pleurer comme une enfant que l’on force à terminer un livre auquel elle ne comprend rien.
Des livres jamais lus, il y en a trop. Tant de bons titres nous échappent parce qu’ils sont cachés au fond des mégalibrairies. Les livres pratiques sont en meilleure position, bien illustrés pour ceux qui ne savent plus lire.
Chez moi, depuis quelques années, les nouvelles acquisitions sont déposées sur un chariot en bois qui me vient de ma mère. C’est le chariot des intentions. J’ai dû me rendre compte, l’année dernière, que j’avais eu deux fois la même intention, en ce sens que j’avais acheté deux fois le même livre sans m’en rendre compte… Cela m’a inquiétée, sur le coup, puis j’ai eu l’occasion d’en rire avec des copines flamandes à qui cela était arrivé. J’aime rire avec elles. Est-ce un hasard si elles sont flamandes et si ce sont les livres d’un auteur flamand qui m’ont accompagnée dès mes débuts en écriture ? Des livres complices, ceux du très grand écrivain Hugo Claus.
J’ai découvert l’écriture de Hugo Claus à l’époque où nous n’avions pas encore le chariot des intentions. Mon compagnon de vie avait déposé le recueil de nouvelles L’amour du prochain sur la table basse désordonnée qui trônait alors au milieu de notre salon. Un petit livre à la couverture rouge, avec une aquarelle de Hugo Claus en haut de page, une traduction de Marnix Vincent éditée chez Maren Sell. Je préparais mon premier recueil de nouvelles L’œil de verre et, en lisant L’amour du prochain, j’ai ressenti une excitation que je n’avais jamais éprouvée autrement que dans l’écriture. J’ignorais en quoi cette lecture – par exemple, une histoire de taureau qui entre tout bonnement dans le salon d’un homme seul ou une autre, décrivant un nouveau-né qui semble avoir une tête de raie – pouvait susciter chez moi le même plaisir que j’avais à écrire. On le sait, une véritable expérience littéraire se vit bien au-delà de ce qui est raconté. Il est si réducteur de parler d’un livre en s’en tenant strictement à l’histoire. Je souhaiterais faire autrement en parlant des textes de Hugo Claus.
Dans L’amour du prochain, il y avait quelque chose qui me rejoignait et qui ne tenait pas tant à ce qui était raconté qu’à ce que je ressentais pour des protagonistes à la fois si semblables et si différents de nous, des êtres pleins d’étrangeté que l’auteur fait vivre avec un humour souvent burlesque, mais un humour qui entraîne nécessairement le trouble. Je viens de relire la postface de L’amour du prochain, dans laquelle on retrouve quelques extraits d’une conversation entre Hugo Claus et son traducteur. « Comment, dit l’auteur, ne pas être submergé quotidiennement par le caractère burlesque des choses ? Il vaut mieux rire, tout en sombrant. Ne fût-ce que par hygiène. Alors l’humour noir est de mise. Et libre au lecteur d’y trouver une référence au surréalisme et à la pataphysique. »
Un peu comme avec mes copines flamandes, j’avais un rire complice avec Hugo Claus, en le lisant. L’impression que son livre m’autorisait à poursuivre l’écriture de L’œil de verre pendant laquelle mes fous rires s’entremêlaient de tristesse. J’aurais voulu que cette lecture de L’amour du prochain ne se termine jamais. Pour la faire durer, j’en parlais à mon entourage qui me répondait « Ah oui, Hugo Claus, l’auteur du roman Le chagrin des Belges ! » Le chagrin des Belges était incontournable, il s’agissait d’un succès mondial et je ne l’avais pas lu. Et, curieusement, je ne souhaitais pas le lire. Était-ce pour mieux protéger le lien à la fois fragile et intime que je croyais maintenir en lisant des livres moins connus de l’auteur (relativement moins connus puisqu’ils avaient tout de même été traduits) ? En tout cas, j’ai continué à bouder son livre incontournable, et sans doute mon plaisir aussi, en optant plutôt pour de courts et délicieux romans comme L’espadon, Le désir ou L’étonnement et pour ses formidables nouvelles (là-bas, en Belgique, on prétend que les romanciers pratiquent la nouvelle « par distraction » !). Au fil de ces lectures, je ressentais toujours la même excitation mêlée de vertige face à l’existence. Puis un jour, le fameux roman Le chagrin des Belges, qui comptait 828 pages, a atterri sur le chariot des intentions parce qu’on me l’a offert. Je l’ai souvent transporté en vacances, mais ne l’ai jamais lu.
Quelques années plus tard, je venais de publier mon troisième recueil de nouvelles Le cri des coquillages et j’avais déjà l’habitude de cette question que l’on pose systématiquement aux écrivains, à savoir qui sont les auteurs qui les ont le plus marqués ou influencés. N’aimant pas me répéter dans les entrevues, j’avais souvent tenté de trouver de nouvelles réponses en repassant dans ma tête les titres qui figuraient dans ma bibliothèque (et non pas sur le chariot des intentions). Mais, invariablement, je répondais : « Hugo Claus », un des rares auteurs que je continue de lire lorsque je me trouve en période de création. À la Foire du livre de Bruxelles, une journaliste m’a posé la fameuse question et, ce jour-là, j’ai résisté plus que de coutume avant de laisser tomber le nom de mon auteur flamand. Je me trouvais dans son pays d’origine et je ne voulais pas avoir l’air d’une racoleuse qui nomme un écrivain en fonction du pays où elle se trouve. Quand j’ai finalement consenti à murmurer le nom de Hugo Claus, la journaliste, qui m’avait lue deux fois plutôt qu’une, s’est tout de suite exclamée : « Mais bien sûr ! De manière très différente, vous explorez l’inconfort ». Effectivement, il s’agissait d’inconfort. Ceux qui commentent l’œuvre de Claus ne passent pas à côté. Pour ma part, c’est à ce moment-là que j’ai véritablement compris qu’à travers l’étrangeté des protagonistes de Hugo Claus, il y avait effectivement l’inconfort, le malaise, moteur même de ma propre écriture. J’étais émue de cette révélation et, en même temps, je craignais que la journaliste ne profite de l’occasion pour me faire parler du Chagrin des Belges…
En ouverture de mon plus récent recueil de nouvelles On ne regarde pas les gens comme ça, j’ai placé une citation de Hugo Claus puisque, une fois de plus, un de ses livres (Le dernier lit) a été une sorte de phare pendant que je travaillais à mon manuscrit. Je m’étais sentie chez moi dans ces trois récits où la solitude est immense. L’utilisation de mots anglais, plus ludique que dans ses publications précédentes, contribue à camper des personnages contemporains dans des univers réalistes, pour ensuite les faire glisser dans quelque chose d’onirique, avec un humour grinçant. Je crois que je vais chercher une grande liberté d’écriture dans les livres de Claus.
À l’hiver 2004, je suis partie en n’omettant pas de prendre Le chagrin des Belges dans mes bagages, pour une résidence d’écriture de trois mois à Amsterdam, ville dans laquelle Hugo Claus publie la plupart de ses livres. Là-bas, je me suis parfois imaginé que je le verrais. À la Maison des traducteurs où je logeais, certains le connaissaient personnellement et auraient aimé favoriser une rencontre, mais cela ne s’est pas fait. Si tel avait été le cas, c’est sûr que je me serais précipitée sur Le chagrin des Belges en guise de préparation ! Un après-midi, je me suis longuement promenée le long du canal Singel que j’affectionne particulièrement. Au moment où j’ai commencé à sentir la fatigue, je me suis souvenue de ce passage de la nouvelle « Olga et moi »: « ‘Ah, ce que je suis fatiguée, dit Olga, c’est que j’ai marché toute la nuit.
– Ça ne fait qu’embellir tes beaux mollets.
– Ben, dit-elle, j’en ai assez’ et elle prit un petit élan et se mit à voler, elle planait à l’horizontale, à peu près à hauteur de ma poitrine ; elle étendait les bras à angle droit et les agitait, battait des pieds.
‘Hé, Olga, m’écriai-je, qu’est-ce qui te prend ?’ »
Ne pouvant pas voler, j’ai choisi de m’arrêter à la place du Spui. Dans la vitrine de la librairie Athenaeum pendait une gigantesque affiche, une très belle photo de Hugo Claus installée pour marquer son soixante-quinzième anniversaire de naissance. Ses yeux clairs me fixaient. Puis, étrangement, j’ai eu l’impression qu’ils se fondaient avec ces regards alignés de livres jamais lus dont la librairie débordait.
Lorsque je suis revenue des Pays-Bas, j’ai replacé Le chagrin des Belges sur le chariot des intentions. Et quand on m’a invitée à écrire au sujet d’un livre jamais lu, j’ai immédiatement su de quoi il s’agirait. Je me suis dit : « Je profiterai même de l’occasion pour le lire ! » Mon compagnon de vie venait de partir pour plusieurs semaines et j’ai pensé que Hugo Claus réussirait à mettre un peu de baume sur l’absence. Le chagrin… J’allais chercher le livre quand le téléphone a sonné. Un appel outremer. De très loin, mon compagnon se mit à me raconter sa traversée, me faisant part des lectures qu’il avait entreprises dans l’avion. Alors j’ai su qu’avant de partir de la maison, il était passé par le chariot des intentions, qu’il avait attrapé mon exemplaire du Chagrin des Belges et qu’il en était ravi.