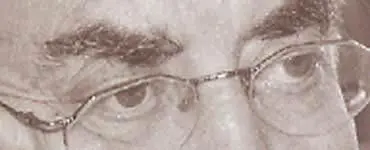Il y a une vingtaine d’années, me promenant à Athènes, à Delphes et à Héraklion, je me suis senti constamment à distance, écarté, comme renvoyé à un état de spectateur. Je reconnaissais les noms des lieux : références littéraires récurrentes. Les livres en sont remplis. Des dieux et des déesses, des rois et des reines souvent pris dans des affrontements, des conflits allant jusqu’aux meurtres. Tout au long des années, j’ai côtoyé à distance ces personnages mythiques ou historiques en ne franchissant jamais une cloison qui, sans parler d’intimité, rendait leur réalité secrète. Un espace indéfini m’en séparait. Sans abandonner l’effort de comprendre, j’ai mis du temps à commencer à me poser des questions.
Mon adolescence est remontée à la surface. J’ai eu entre les mains la traduction arabe de l’Iliade. J’en lisais quelques pages et, me trouvant devant un chemin bloqué, j’abandonnais pour recommencer une semaine, puis un mois plus tard. Rien à faire. Une impasse. Impossible de suivre les divinités dans leur cheminement tant elles m’apparaissaient irréelles. Ni produits de l’imagination ni surgissements de rêves : irréelles, totalement hors d’atteinte et, ma patience portée à bout, mon intérêt s’amenuisait et finissait par s’épuiser. Toutefois, à force de réitération des références, les noms étrangers sont devenus familiers et ne piquaient plus ma curiosité. Ni énigmes ni mystères mais des entités en mouvement dans un univers clos.
Enfant, quand à la nuit tombante ma mère tentait de m’endormir, elle me racontait l’histoire de ma famille, son enfance brisée par la mort de son père, ses difficultés de jeune mariée, revenant toujours au récit biblique qui se confondait avec celui de ma famille. Mon grand-père maternel portait le nom de Joseph et, par sa volonté, deux de mes oncles, ceux de Ménaché et d’Éphraïm, à l’instar des enfants de l’ancêtre biblique. Mon grand-père paternel avait pour nom Yehouda, il introduisait une autre suite dans la filière biblique. Il donna à l’un de ses fils le nom de David, celui du roi descendant de cet ancêtre et poursuivant l’héritage. Le nom de mon père, Nessim, désignait les miracles dont Dieu est l’auteur. Plus tard, j’ai trouvé mon propre prénom dans un psaume de David.
Ainsi, à partir de ma naissance, la Bible m’a accompagné et ma langue maternelle, l’arabe, ne m’en éloignait nullement non seulement en raison de la proximité de cette langue avec l’hébreu mais aussi à cause de la familiarité des musulmans avec les personnages bibliques et, par conséquent, avec mon histoire familiale.
À dix-huit ans, j’ai fait à Paris la découverte du christianisme et il ne m’a pas semblé étranger puisqu’il puisait ses origines dans notre livre, même si une ligne de séparation était tracée. Pourtant, je ne cessais d’être défié par ces personnages étrangers qui, tout en me tenant à distance, ne se réduisaient pas à des ombres, me rappelant constamment à l’ordre. Gide et Thésée, Camus et Sisyphe, Sartre et Œdipe, Joyce et Ulysse.
Ayant le sentiment d’être cerné de toutes parts, je tentais de formuler des interprétations grâce à des références sommaires à cette Grèce lointaine qui ne cessait pourtant de frapper à ma porte, me forçant à prendre acte de sa présence. Elle ne me hantait pas puisqu’elle me tenait à l’extérieur. Je pouvais lire Joyce sans passer par Homère.
À partir de l’adolescence, les Hellènes étaient perpétuellement présents dans mes lectures. Taha Hussein n’affirma-t-il pas que leurs rapports avec l’Orient étaient prédominants ? Ils empruntèrent aux Égyptiens certaines de leurs perceptions des mécanismes de l’esprit humain, et si nombre de leurs textes n’avaient pas été recueillis et préservés par les Arabes, ils auraient été perdus pour l’humanité. Aussi, la Grèce était tellement présente que ses croisements avec les autres civilisations m’apparaissaient comme des passages naturels, fussent-ils imperceptibles. Traversant le Péloponnèse, les noms dont fourmille la littérature avaient alors des existences concrètes et, pourtant, la distance élevait devant moi un écran aussi puissant qu’un barrage. Ces divinités étaient les produits d’une pure imagination, fût-elle séculaire, fût-elle intégrée au mythe, telle une réalité seconde quoique inventée.
Enfant, je m’étais aperçu, inconsciemment d’abord, que la réalité ne pouvait être saisie qu’à travers une histoire que j’étais appelé à répéter, à relater à mon tour, pour l’intégrer à ma propre existence. Et toutes les histoires finissaient par me conduire à celles du Livre premier. Certains personnages ont acquis avec le temps un caractère mythique mais que ce soit Abraham ou Moïse, ils sont nés et morts comme les autres. Les divinités Hellènes étant imaginaires, je ne parvenais pas à raconter des histoires imaginées par d’autres. Ma propre imagination m’aurait alors semblé frappée de stérilité, réduite à l’emprunt et à l’imitation et, par conséquent, superflue. Présomption ou indice d’une incapacité ? Les histoires réelles étant enregistrées, inscrites, elles laissaient la voie toute libre à l’imaginaire et à ses débordements. Il n’y avait pas de fiction dans les littératures arabe et hébraïque. En arabe, les contes populaires, que ce soient Kalila et Domna ou Les mille et une nuits, ne faisaient pas partie de la littérature sérieuse avant que l’Occident ne les rehausse à un autre statut et furent, de toute façon empruntés à l’Inde et à la Perse. Question primordiale, essentielle que j’ai posée dans mon premier essai Le réel et le théâtral. Ce qui me frappait alors était, à côté de nombreuses traductions du grec à l’arabe des œuvres philosophiques et scientifiques, l’absence de toute œuvre théâtrale. Sophocle et Aristophane n’avaient pas de place à côté de Socrate et Platon, compagnons, dans l’esprit, d’Averroès et d’Avicenne. Et c’est grâce à l’Occident contemporain que la fiction a fait son entrée en arabe et en hébreu.
Obéissais-je à une tradition antique, voire archaïque, dans mon abstention d’aborder l’Iliade et l’Odyssée ? Avais-je peur de bouleverser, en le désorganisant, un cheminement choisi à partir des premiers balbutiements d’écrivain ? J’ai publié ma première nouvelle, écrite dans ma langue maternelle, l’arabe, à quatorze ans. Inconsciemment, tout écrit me paraissait être alors une narration, y compris les idées. D’où, encore aujourd’hui, le besoin de parler le plus souvent à la première personne dans mes essais.
Quand, plus tard, j’ai tenté d’aborder l’Iliade et l’Odyssée, ils me semblaient être si familiers que toute lecture devenait inutile comme s’il s’agissait d’une relecture, une appréhension réitérée d’un savoir commun, universel.
Il y a une vingtaine d’années, pour mon premier voyage en Chine, je n’avais pas cherché à m’instruire au préalable sur le passé de ce continent. Je me disais que j’avais du mal à démêler les complexités de mes propres traditions hébraïque et arabe. Et, voici qu’en plein Beijing, à l’intérieur d’une mosquée, d’une architecture totalement chinoise, j’ai pu lire sur le mur, dans le texte, une sourate du Coran. J’ai compris alors que l’Orient et l’Occident sont des notions relatives comme le sont les cultures et, à l’extrême limite, les langues. Je me suis alors dit que même si j’avais fait, peut-être involontairement, le choix de ma propre histoire du monde, de ma propre mythologie, je pouvais aborder d’autres histoires comme des dimensions parallèles de la mienne, que je pouvais les accueillir sans les craindre comme menaces. De sorte qu’aujourd’hui, en y repensant, je crois que je suis prêt à lire l’Iliade et l’Odyssée.