En 1958, un recueil de nouvelles, Avec ou sans amour, révèle Claire Martin et pose avec maîtrise le thème qui va se développer dans les livres ultérieurs : les rapports entre les êtres. Suivront des romans : Doux amer, Quand j’aurai payé ton visage, et les deux volumes de souvenirs d’enfance, Dans un gant de fer, qui vaudront à l’auteure à la fois la notoriété et des attaques virulentes. Claire Martin s’éloigne alors et se tait. On peut croire l’œuvre terminée. Et voilà qu’à partir de 1999 paraîtront presque coup sur coup Toute la vie, L’amour impuni, La brigande et Il s’appelait Thomas.
Quand un écrivain ou un artiste sort d’une longue période de silence, il est d’usage d’affirmer qu’il a « retrouvé une seconde jeunesse ». Chez Claire Martin cette jeunesse n’a jamais été perdue : elle éclate dans ce qu’aujourd’hui elle écrit, comme dans la vivacité du regard et de la parole, dans la fraîcheur du rire. Et cependant, au récit de ce que fut son enfance, le lecteur se dit qu’elle revient de loin…
Un retour nécessaire : l’enfance
Dans un gant de fer est publié après trois livres de fiction mais la rédaction de ces souvenirs leur est contemporaine : 1957-1966, indique la dernière page. Nul doute que là réside la source profonde de l’œuvre, dans l’expérience intense de la souffrance de l’enfant, son désarroi, sa solitude face à l’autorité écrasante, dans la soif d’amour ; et, pourrait-on dire, malgré les apparences, parce que Claire Martin ne raconte pas son histoire intime dans ses nouvelles et ses romans. Qu’on ne se trompe pas sur l’emploi fréquent du je de la narration : « Pour moi, un roman c’est une histoire dont les personnages ne sont pas capables de garder le secret. De là vient que mes romans sont écrits à la première personne ». Sans doute – comme le souligne fort bien Jean-Louis Major –, la rédaction de l’autobiographie a-t-elle fait place nette pour que puissent paraître et évoluer des personnages qui ne sont pas, ou qui sont en partie, ou faiblement, des doubles ou bien des reflets de l’auteure.
L’autobiographie s’arrête au moment où Claire Martin atteint l’adolescence et qu’elle échappe à la tutelle du père et des religieuses. Poursuivre le récit serait sans doute vain. C’est de ses premières années qu’il lui fallait parler : l’écrire est un acte de libération. Des gens qui se taisent et des enfants qui n’osent pas questionner. Ou si, par exception, ils osent, ils sont sévèrement tancés, punis, parfois battus : comment mettre en doute la parole de l’adulte, même l’interroger sur les raisons de son jugement, de son acte, comment même s’informer ? Les adultes : le père, d’abord, dont il est insuffisant de dire qu’il est tyrannique et écrase la famille. Absolu, aveugle, prompt à de terribles emportements, sa colère continue lui étant nécessaire comme une drogue, d’une rigidité morale qui met toujours à la bouche « le devoir », qui exclut tout sentiment, incapable d’affection pour les huit enfants et pour leur mère, elle toute de patience, de douceur, de tendresse. Il fait le vide autour d’eux et autour de lui. Comment, pour l’enfant, survivre ? Par la solidarité avec les frères et sœurs, par l’évitement, par la ruse. Car c’est bien à la duplicité face à l’adulte qu’est obligé ainsi le jeune être. « J’avais trois ans et demi. C’est bien peu pour choisir la haine et le mépris. » Phrase terrible…
Au pensionnat elle retrouve moins de violence ouverte, certes, mais le même air irrespirable. Les interdits y sont aussi nombreux, tout aussi absurdes. L’enfant y vit dans un sentiment permanent de faute. Les punitions tombent d’un ciel opaque sur la fillette, de la bouche de ces femmes aigries, frustrées, puériles, devenues despotiques, qui, pour la plupart, n’ont sans doute pas choisi d’entrer au couvent. Dans un gant de fer est un des premiers livres au Québec à décrire en ces termes l’expérience du pensionnat religieux qui a marqué, parfois jusqu’au traumatisme ineffaçable, cette génération de femmes « victoriennes », élevées dans la peur du siècle et dans celle de l’au-delà, donc, tout simplement et brutalement, incapables de vivre. « L’étape la plus étouffante de l’aventure féminine. » Et voilà qu’une femme maniant la plume – et quelle plume ! – osait parler. Même si la réalité ici montrée s’est éloignée de nous, point n’est besoin d’un grand effort pour imaginer le scandale : une intouchable institution était mise en cause ! Cependant – est-il besoin de rappeler ces évidences ? – Dans un gant de fer n’est pas un pamphlet, il n’instruit pas un procès, il n’est pas un brûlot destiné à saper les fondements de la société de l’époque. Le livre décrivait, il témoignait avec courage d’une souffrance, de l’absence dans ce jeune âge de la bonté. L’enseignement y a laissé en friche l’esprit et le cœur. À travers ces pages l’adulte est mis face à ses responsabilités, et le plus souvent il s’y est dérobé.
Dans cette prison qui prend la relève de la première, se pose la même question : comment survivre ? À voir l’acharnement de certaines religieuses, Claire Martin s’est demandée si elle ne portait pas avec elle « une odeur de soufre »… C’est l’esprit de contradiction qui l’a sauvée – prémices et marque de ce qui est devenu chez elle esprit d’indépendance –, et un état d’exaspération constant. Celui que tant de femmes de sa génération ont nourri, sans toujours l’avouer : « Comment, dit-elle, une partie de l’humanité a-t-elle pu décider que l’autre moitié ne comptait pas ? »
N’a-t-elle donc pas éprouvé le désir de vengeance ? Il a très tôt disparu. Des regrets, certes. De ne pas avoir dit au père ce qu’elle a vécu. De ne pas avoir su apprécier la nature – rarement présente dans l’œuvre – alors que l’enfant était toute prise par le drame quotidien de la maison. De ne pas avoir poussé plus loin la connaissance de la musique et de la peinture, à une époque où « les femmes en savaient toujours trop ». De bonne heure, elle a trouvé des voies pour canaliser le plus noir de la colère : pour ne pas donner prise aux ragots et encourir des punitions, elle apprend l’art de fabuler. De là à l’art d’écrire… Et puis, comme dans la famille où il y avait la mère si aimante, la grand-mère et le grand-père, au pensionnat quelques figures savaient écouter l’enfant, la stimuler, la respecter et l’aimer, telle cette Mère du Bon Conseil, tôt disparue.
Ces pages de souvenirs n’ont pas une ride. Elles gardent toute leur intensité, toute leur charge d’émotion à laquelle le lecteur ne résiste pas. Aucune gesticulation ni rhétorique, nul pathos dans ce qui fut si souvent pour l’enfant un enfer. Nulle trace d’apitoiement sur soi-même. Ces souvenirs, Claire Martin les a écrits avec la netteté, la vigueur lucide et directe, ce mélange paradoxal de proximité et de distance avec lequel elle considère le train du monde, les êtres et sa propre vie. L’œuvre de fiction, malgré tout l’écart qui la sépare de l’autobiographie, n’est pas d’une autre trempe. Un trait peut en rendre compte : la justesse.
Claire Martin manifeste aujourd’hui une sérénité d’autant plus étonnante que l’enfance qu’elle nous raconte risquait de l’emprisonner à vie. Elle s’est dégagée par elle-même. Grâce aussi à l’homme qu’elle a épousé en 1945, « tout le contraire du père », et qui fut aussi pour elle, ce que les professeurs des pensionnats n’avaient pas été, « un très bon pédagogue ». Pendant deux ans elle travailla à Radio-Canada. Elle fut celle qui annonça sur les ondes la fin de la guerre, « un sentiment d’une intensité extraordinaire ». Mais comme bien d’autres institutions d’alors, Radio-Canada ne gardait pas à l’emploi les femmes mariées. Claire Martin va s’établir à Ottawa.
Débuts de la fiction
S’ouvre pour elle une dizaine d’années de création intense. Dès le premier livre de fiction publié, Avec ou sans amour (1958), l’écriture atteint une maîtrise évidente. Mis à part quelques textes (dont l’un sur Colette), Claire Martin n’avait rien publié : « Il n’y avait rien dans mes cartons ». Cependant, déclare-t-elle, « je me suis toujours considérée comme un écrivain ». « Un matin, désœuvrée, j’ai commencé à écrire. » C’était en avril 1957. Tardivement, donc, mais « c’était ce que j’avais à faire ». Sans hâter le pas. Ces nouvelles adoptent la forme du conte fantaisiste, de la lettre, de la comédie ou du drame en miniature. Un homme s’efforce de transformer à son goût sa partenaire – situation réversible ! La femme vieillissante se demande si elle peut encore plaire. Un homme tue sa femme, s’enfuit, revient. Des maîtresses découvrent qu’elles sont toutes trompées. Comment souffler à une amie son amoureux, et la monnaie rendue… Comment les femmes savent cultiver l’art de se discréditer mutuellement. Ainsi sont traités, ou esquissés, quelques-uns des thèmes et situations que les romans développeront plus amplement, entre doux et amer, selon un dosage très personnel, un glissement de l’un à l’autre. Déjà l’attaque est franche et variée, le récit s’accomplit selon une courbe narrative impeccable. Des notes plus sourdes, plus douloureuses parfois, mais aussi une verve humoristique, voire une drôlerie, qui ne seront jamais totalement absentes des œuvres ultérieures.
Le couple en demi-teintes
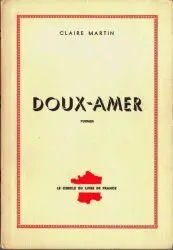 Après ces nouvelles qui sont bien plus que des gammes préparatoires, vient le premier roman en 1960, justement intitulé Doux amer, au Cercle du Livre de France. Claire Martin a reçu les encouragements de Pierre Tisseyre, « éveilleur de vocation littéraire » – elle lui vouera toute sa vie reconnaissance et amitié. Un couple, comme il en reparaît souvent dans les récits de Claire Martin, vit l’unique, le miraculeux de l’amour en ses débuts, mais déjà l’homme et la femme savent qu’ils ne se tiendront pas longtemps à cette hauteur (on songe ici à L’épithalame de Jacques Chardonne). L’ombre plane sur le couple avant même qu’il ne devienne triangle, par Gabrielle, qui confie un manuscrit au mari. Il le publie, Gabrielle devient une écrivaine appréciée, fêtée. Une complicité (fausse), une amitié (complexe), des compromis s’établissent entre les trois protagonistes, et aussi de la hargne mal rentrée, les mensonges, les faux-fuyants, des paroles blessantes. Après l’élan des débuts amoureux, le désenchantement sur la solidité des liens que nous pensions assurée – le thème reparaîtra sous une autre forme dans le roman le plus récent, La brigande. Et la souffrance qui accompagne la trahison. Le récit rétrospectif introduit peu à peu des nuances mouvantes où l’ambiance change imperceptiblement, par indices qui peu à peu font corps. Ici comme dans ses autres livres, Claire Martin pratique la litote et le non-dit, l’art de suggérer. Alors qu’elle entreprend maintenant sa huitième relecture d’À la recherche du temps perdu, elle aime rappeler le « N’expliquez rien » de Marcel Proust comme une règle d’or de la narration. Un dénouement sans éclats de voix, sans spectacle : la fin des illusions, un apaisement un peu triste et résigné. Un apaisement quand même.
Après ces nouvelles qui sont bien plus que des gammes préparatoires, vient le premier roman en 1960, justement intitulé Doux amer, au Cercle du Livre de France. Claire Martin a reçu les encouragements de Pierre Tisseyre, « éveilleur de vocation littéraire » – elle lui vouera toute sa vie reconnaissance et amitié. Un couple, comme il en reparaît souvent dans les récits de Claire Martin, vit l’unique, le miraculeux de l’amour en ses débuts, mais déjà l’homme et la femme savent qu’ils ne se tiendront pas longtemps à cette hauteur (on songe ici à L’épithalame de Jacques Chardonne). L’ombre plane sur le couple avant même qu’il ne devienne triangle, par Gabrielle, qui confie un manuscrit au mari. Il le publie, Gabrielle devient une écrivaine appréciée, fêtée. Une complicité (fausse), une amitié (complexe), des compromis s’établissent entre les trois protagonistes, et aussi de la hargne mal rentrée, les mensonges, les faux-fuyants, des paroles blessantes. Après l’élan des débuts amoureux, le désenchantement sur la solidité des liens que nous pensions assurée – le thème reparaîtra sous une autre forme dans le roman le plus récent, La brigande. Et la souffrance qui accompagne la trahison. Le récit rétrospectif introduit peu à peu des nuances mouvantes où l’ambiance change imperceptiblement, par indices qui peu à peu font corps. Ici comme dans ses autres livres, Claire Martin pratique la litote et le non-dit, l’art de suggérer. Alors qu’elle entreprend maintenant sa huitième relecture d’À la recherche du temps perdu, elle aime rappeler le « N’expliquez rien » de Marcel Proust comme une règle d’or de la narration. Un dénouement sans éclats de voix, sans spectacle : la fin des illusions, un apaisement un peu triste et résigné. Un apaisement quand même.
Sans doute Claire Martin a-t-elle mis dans ce roman beaucoup d’elle-même : non pas son histoire personnelle mais, à travers le personnage de Gabrielle, tout le travail de l’écrivain. Plus encore, un regard porté sur les êtres, une observation attentive qu’il n’est point besoin de convertir en termes psychologiques ni en concepts philosophiques.
 Histoire d’amour encore, avec les subtiles variations de l’attrait-rejet entre un homme et une femme, dans Quand j’aurai payé ton visage, où par la métaphore du feu se succèdent tiédissements et réchauffements. Le récit, plus ample que le précédent, narrativement plus audacieux, se fait à plusieurs voix se répondant en écho, entre Jeanne la mère, les deux fils Bruno et Robert, celui-ci amoureux de Catherine sa belle-sœur, chacun poursuivant son monologue intérieur. Et il y a le père dont les préjugés envers les pauvres et les juifs, le souci du paraître, du respectable, l’exercice de l’autorité, font le parfait représentant de la bourgeoisie dans sa version bien-pensante. En des accès de lucidité et de colère, Jeanne voit le mensonge dans lequel elle a vécu, et, avec combien plus de violence, Catherine aussi, par son amour pour Robert. Celui-ci se dresse contre le père, contre les règles du clan, il s’enfuit, brave l’opprobre et la malédiction. Il semble que, par là, la fiction donne suite à l’autobiographie de Dans un gant de fer, qu’elle réalise dans l’imaginaire ce qui n’a pu être accompli dans la réalité. Robert et Catherine connaîtront, comme les protagonistes de Doux amer, l’enchaînement passion-nuages-querelles-rupture dans l’illusion que le couple peut se suffire à lui-même. Ils ont franchi l’interdit de l’amour adultère quasi incestueux mais il faut voir dans cette transgression avant tout la forme particulière de la révolte contre un ordre social et un ordre moral. Plus profondément, plus essentiellement, le roman est un refus du mensonge sur lequel reposent tant de vies, à un point tel que le mensonge devient la texture même de la vie. La révolte, dit aujourd’hui Claire Martin, « c’est de ne pas supporter la vie qu’on était supposé avoir », c’est littéralement vivre selon sa vérité.
Histoire d’amour encore, avec les subtiles variations de l’attrait-rejet entre un homme et une femme, dans Quand j’aurai payé ton visage, où par la métaphore du feu se succèdent tiédissements et réchauffements. Le récit, plus ample que le précédent, narrativement plus audacieux, se fait à plusieurs voix se répondant en écho, entre Jeanne la mère, les deux fils Bruno et Robert, celui-ci amoureux de Catherine sa belle-sœur, chacun poursuivant son monologue intérieur. Et il y a le père dont les préjugés envers les pauvres et les juifs, le souci du paraître, du respectable, l’exercice de l’autorité, font le parfait représentant de la bourgeoisie dans sa version bien-pensante. En des accès de lucidité et de colère, Jeanne voit le mensonge dans lequel elle a vécu, et, avec combien plus de violence, Catherine aussi, par son amour pour Robert. Celui-ci se dresse contre le père, contre les règles du clan, il s’enfuit, brave l’opprobre et la malédiction. Il semble que, par là, la fiction donne suite à l’autobiographie de Dans un gant de fer, qu’elle réalise dans l’imaginaire ce qui n’a pu être accompli dans la réalité. Robert et Catherine connaîtront, comme les protagonistes de Doux amer, l’enchaînement passion-nuages-querelles-rupture dans l’illusion que le couple peut se suffire à lui-même. Ils ont franchi l’interdit de l’amour adultère quasi incestueux mais il faut voir dans cette transgression avant tout la forme particulière de la révolte contre un ordre social et un ordre moral. Plus profondément, plus essentiellement, le roman est un refus du mensonge sur lequel reposent tant de vies, à un point tel que le mensonge devient la texture même de la vie. La révolte, dit aujourd’hui Claire Martin, « c’est de ne pas supporter la vie qu’on était supposé avoir », c’est littéralement vivre selon sa vérité.
Intermède : le théâtre
En 1970 paraît le texte de la pièce Les morts qui sera représentée deux ans plus tard au théâtre du Rideau vert à Montréal. Elle a du succès, ce qui n’empêche pas l’auteure d’éprouver une véritable « horreur » de voir son texte passer entre tant de mains, défiguré par les additions parasites de la mise en scène. Heureux Sacha Guitry qui, lui, de l’écriture à la représentation était son propre maître ! L’expérience théâtrale de Claire Martin a donc été isolée, et la pièce – au titre peu heureux, elle le reconnaît – s’efface derrière les œuvres narratives. Et c’est dommage ! Quel texte vif, vivant, intelligent, qui sans cesse rebondit, se relance dans un dialogue ininterrompu entre deux femmes évoquant la mort de deux hommes portant le même prénom, aimés, ou qui auraient pu l’être ! Non pas la tristesse, la complaisance nostalgique qui seraient prévisibles, mais sous le badinage, la gravité. « Plus personne ne parle d’amour comme j’aime », dit celle qui se raconte. Propos et personnages décalés par rapport à l’époque, à ses usages sans finesse, à son vocabulaire passe-partout, à ses facilités et vulgarités, femmes qui aiment l’intelligence du cœur, la pudeur dans l’expression du sentiment : on reconnaît bien là Claire Martin. Et l’art de retourner les lieux communs de la pensée comme ceux du langage – et d’en rire ! Un récit-dialogue dans la ligne de Jacques le fataliste – mais à l’époque l’auteure ne connaissait de Denis Diderot que La religieuse –, et réflexion sur les mots qui composent ce dialogue. « Les mots me fascinent, leur usage. Et de cet usage, celui que j’en peux faire, moi. » Profession de foi de l’écrivaine, qui n’a pas besoin d’être décodée ni lue entre les lignes ! Mais, dit l’interlocutrice dans la pièce, écrire a ses pièges : « Je crains parfois que vous ne voyiez les autres avec votre œil de romancière et que ce que vous disiez d’eux ne soit pas tout à fait fidèle ». Un piège ou un privilège ?
Le silence
Après plusieurs séjours en France (où trois de ses livres ont paru chez Robert Laffont) Claire Martin va s’y établir en 1972. Elle part « complètement dégoûtée » d’avoir attiré tant de critiques malveillantes, voire d’invectives. Elle ne veut plus être étiquetée comme « la plus française de nos romancières », « la Franco-française ». La mode dans les lettres québécoises est alors, on s’en souvient, au joual et à une conception naturaliste du roman et du théâtre. Claire Martin, cela va de soi, ne s’aligne pas ! On lui reproche de bien écrire le bon français, de pratiquer la littérature d’un autre temps et d’un autre pays. Dans sa famille, dit-elle, on attachait beaucoup d’importance à la correction de la langue. Claire Martin possède une élocution naturelle nette et ferme qu’elle a développée par la lecture à haute voix. Ce souci passe évidemment dans l’écriture. Et le Grand Robert est sur sa table de salon… Elle a beaucoup lu, et en désordre – le grand-père possédait une bibliothèque et chez les Ursulines, même si elle était contrôlée, la lecture était obligatoire. Les livres à la mode dans les années vingt : Pierre Benoît, Pierre Loti, Henry Bordeaux. Puis Proust, en commençant par Contre Sainte-Beuve et Les plaisirs et les jours. André Gide, très admiré dans Paludes, La porte étroite, le Journal. Les écrivains que l’on range habituellement dans « la tradition française » du roman psychologique : Paul Morand, Jacques Chardonne, Julien Green, mais aussi le Voyage au bout de la nuit, et aujourd’hui encore Julien Gracq. Ces références sont sans ambiguïté, comme la marque qu’elles ont pu laisser sur l’œuvre.
Après 1970, dit Claire Martin, « je n’ai plus rien fait » en écriture. Mais elle connaît le bien-être de la vie de couple, le soleil, les paysages du Midi, les rencontres, les amis. Elle revient à Québec en 1982 puis repartira pour la France chaque hiver. Elle paraît avoir alors renoncé à la littérature.
L’élan nouveau
Des proches le déplorent. André Ricard, Gilles Dorion qui a entrepris de rassembler ses textes, la poussent à reprendre la plume. Elle se laisse convaincre. Gilles Pellerin est prêt à la publier à L’instant même. En 1999 paraît Toute la vie, où figurent – comme le précise Gilles Dorion dans sa préface – des nouvelles parues dans des périodiques avant 1969 et d’autres, récentes et inédites. On raconte une histoire autour d’une table : « C’est une façon qui, depuis Boccace, depuis Chaucer, peut faire d’une soirée vide une conversation intéressante ». Souvenirs de l’enfance : l’apprentissage de la lecture. Une traversée de l’Atlantique en avion. Des images, des saynètes inspirées par le Midi et ses habitants. Ensemble divers, un peu composite, mais où le lecteur retrouve la Claire Martin de la « première manière » : courts textes alertes, pour la plupart allègres, au dessin et à l’expression nets. Pages sans prétention où l’auteure revient au bonheur d’écrire.
L’élan est, de fait, donné ! Deux romans voient le jour à un an d’intervalle. Un large public redécouvre Claire Martin qui sait rendre sensible la gravité des destinées sous la touche légère. L’amour impuni aborde le thème de la relation homosexuelle entre deux hommes avec une pudeur extrême. Un universitaire dans la trentaine « travaille souvent comme un forcené » et se reconnaît la vocation de la paresse. Ce lecteur de Montaigne tient en toute liberté une sorte de carnet. Philippe, encore étudiant, croise sa route. « Je ne sais si je me trompe, si j’ai raison, si je m’abuse, j’ai cru voir un léger mouvement sur son visage, une connivence, mais il parlait toujours, un peu penché, sans que ses yeux me quittent un instant, sans ciller, sans exprimer autre chose qu’une extrême attention. Je me découvre capable de soutenir ce regard. » Les débuts de ce qui est peut-être l’amour, ou qui ne l’est peut-être pas, dans un entre-deux du sentiment. Une brève fugue ensemble. « Le reste se télescope un peu dans ma mémoire. Il est très tendre, très doux. » La vie à deux. Un été passe, un automne, le cahier est délaissé. La mère de celui qui le tient meurt. Le chagrin, mais aussi le bonheur avec Philippe. « Le cocon familial est refermé avec Philippe en plus et maman en moins. » Voilà, c’est tout. Pas d’autre intrigue, pas d’autre drame que ces modulations de la vie. Des feuillets, des notes égrenées comme celles d’une musique délicate et savante.
 En épigraphe de La brigande, une phrase de Paul-Jean Toulet : « À travers le passé ma mémoire t’embrasse ». Cora, à qui ses romans ont apporté « une certaine renommée et un peu d’argent » et dont un accident a fait une veuve, va voir Nicette à l’hôpital peu avant sa mort. Et le passé revient. Il y eut d’abord un groupe d’amis, dont Cora, avec Nicette connue depuis l’enfance, son mari Maurice, Vincent « arrivé parmi nous comme un passereau », quelques autres. Quel couple Maurice et Nicette ont-ils fait ? Et que s’est-il passé entre elle, Cora, et l’amie de toujours ? Qu’est-il donc advenue de « l’amitié qui compte tellement et qui se détisse » ? Nicette était-elle estimable, sincère, ou indifférente, pire peut-être ? Relire les lettres anciennes que lui remet Maurice apportera-t-il la vérité ? Lui aussi retrouve matière à douter, des silences de l’épouse sur des affaires peu claires qu’elle a conduites. Cora : « j’ai le sentiment d’avoir devant moi une sorte de dossier de la rancune, de la jalousie ». Mais Claude, le médecin qui courtise Cora lui révèle que Nicette, apprenant sa maladie, a refusé de se soigner, « une sorte de vengeance contre on ne sait quelle part d’elle-même ». Et Claude, « cet homme aux mains douces et fortes » aide Cora à panser la douleur de la trahison et à tirer un trait sur cette amitié.
En épigraphe de La brigande, une phrase de Paul-Jean Toulet : « À travers le passé ma mémoire t’embrasse ». Cora, à qui ses romans ont apporté « une certaine renommée et un peu d’argent » et dont un accident a fait une veuve, va voir Nicette à l’hôpital peu avant sa mort. Et le passé revient. Il y eut d’abord un groupe d’amis, dont Cora, avec Nicette connue depuis l’enfance, son mari Maurice, Vincent « arrivé parmi nous comme un passereau », quelques autres. Quel couple Maurice et Nicette ont-ils fait ? Et que s’est-il passé entre elle, Cora, et l’amie de toujours ? Qu’est-il donc advenue de « l’amitié qui compte tellement et qui se détisse » ? Nicette était-elle estimable, sincère, ou indifférente, pire peut-être ? Relire les lettres anciennes que lui remet Maurice apportera-t-il la vérité ? Lui aussi retrouve matière à douter, des silences de l’épouse sur des affaires peu claires qu’elle a conduites. Cora : « j’ai le sentiment d’avoir devant moi une sorte de dossier de la rancune, de la jalousie ». Mais Claude, le médecin qui courtise Cora lui révèle que Nicette, apprenant sa maladie, a refusé de se soigner, « une sorte de vengeance contre on ne sait quelle part d’elle-même ». Et Claude, « cet homme aux mains douces et fortes » aide Cora à panser la douleur de la trahison et à tirer un trait sur cette amitié.
Le tout récent roman (ou longue nouvelle ?) Il s’appelait Thomas présente la même sûreté de touche et d’écriture. Sur l’arrière-plan, discrètement traité, d’une petite ville – qui pourrait être aussi bien dans le Midi qu’en Nouvelle-Angleterre –, deux couples se forment. Thomas, devenu pasteur sans autre vocation que de répondre au vœu de sa mère, rencontre Nellie, belle, discrète, droite. Le médecin, le seul ami qu’ait Thomas dans cette paroisse où il ne faut pas donner trop de prise à la curiosité, aime de son côté. Il encourage Thomas à vaincre ses peurs. Celui-ci mourra brusquement dans une noyade mais il aura connu l’amour véritable. Il aura osé être heureux. Et Nellie mettra au monde un enfant : « Il est si beau, il a comme une signature les yeux de Thomas, que toute la paroisse oublie d’être scandalisée. On n’est pas éloigné de le regarder comme un enfant mythique […] un cadeau des dieux ».
Un art exigeant
À côté de la phrase de Paul-Jean Toulet, quelques mots : « Petit pan de mur jaune avec un auvent ». On reconnaît les dernières paroles que se répète Bergotte après avoir contemplé la Vue de Delft de Vermeer. Ils ont, non seulement pour ce roman mais pour toute l’œuvre de Claire Martin, valeur d’emblème. Ce petit pan de mur jaune, Vermeer est parvenu à le peindre à force de travail, d’attention, de ferveur. D’un détail banal pris dans la réalité, il a fait un objet précieux. C’est semblable transmutation que Claire Martin tend à opérer, et elle y réussit. Point d’intrigues complexes, de rebondissements surprenants, de tape-à-l’œil. Les personnages couvrent un éventail réduit, mais le récit les fait vivre, palpiter, s’approcher et s’éloigner avec leur secret hors d’atteinte. Effet du regard que l’auteure porte sur eux, qui les fait paraître successivement, parfois simultanément, familiers et distants. Effet d’une ironie et d’une tendresse. Effet d’une écriture qui privilégie le vif, le léger, non pas bondissante, parce que retenue – qui se retient parce que, au-delà, à un certain point commenceraient le bavardage et l’explication. Et aussi parce qu’un personnage, comme un être de chair et d’os, demande à être respecté dans son mystère. Ces pages, un élan les porte, d’un mot, d’une notation vers l’autre qui la complète et la prolonge en harmoniques. Bonheur de l’écriture, et aussi bonheur par l’écriture, cette faveur, entre autres, que la vie a accordée à Claire Martin. Lorsqu’elle se retourne sur son passé, malgré toute la souffrance qui l’a d’abord marquée, elle peut aujourd’hui déclarer : « J’ai été une femme extraordinairement heureuse ».
Claire Martin a publié :
Avec ou sans amour, Le Cercle du livre de France, 1958 et Robert Laffont, 1959 ; Doux-amer, Le Cercle du livre de France/Robert Laffont, 1960 ; Quand j’aurai payé ton visage, Le Cercle du livre de France/Robert Laffont, 1962 ; Dans un gant de fer : la joue gauche, Le Cercle du livre de France, 1965 ; Dans un gant de fer : la joue droite, Le Cercle du livre de France, 1966 ; Les morts, Le Cercle du livre de France, 1970 ; Moi, je n’étais qu’espoir, Le Cercle du livre de France, 1972 ; La petite fille lit, Éditions de l’Université d’Ottawa, 1973 ; Toute la vie, L’instant même, 1999 ; L’amour impuni, L’instant même, 2000 ; La brigande, L’instant même, 2001 ; Il s’appelait Thomas, L’instant même, 2003.
À jour 2003 : bibliographie à compléter. Claire Martin est décédée le 18 juin 2014 à Québec.











