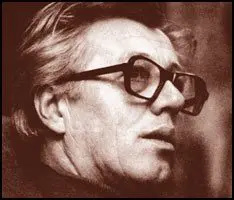Dans Maria Chapdelaine, trois hommes prétendent à la main de la belle héroïne : un bien sympathique coureur des bois, intrépide et libre, un émigrant installé aux États-Unis, qui promet aisance et vie facile, et un modeste cultivateur, simple et honnête, qui connaît la vie difficile des défricheurs.
Árpá Vigh : Maria choisirait le premier, mais celui-ci « s’égare » et trouve la mort dans l’hiver canadien. Alors, malgré les voix de sirènes du Sud, elle accepte d’épouser le troisième et de rester dans le « pays austère », motivée dans sa décision, notamment, par d’autres voix, intérieures et profondes, lui disant : « Nous sommes venus il y a trois cents ans, et nous sommes restés. […] Autour de nous des étrangers sont venus, qu’il nous plaît d’appeler des barbares ; ils ont pris presque tout le pouvoir ; ils ont acquis presque tout l’argent ; mais au pays de Québec rien n’a changé. Rien ne changera, parce que nous sommes un témoignage. » Que signifient ces phrases pour un écrivain hongrois de Roumanie qui, dans une de ses pièces de théâtre, redoutable et redoutée pendant longtemps, Noël en Transylvanie, pleure l’exil et attend le retour d’une fille qui, fuyant le pays, est partie, elle aussi, aux États-Unis pour y chercher son bonheur ? Pour un écrivain qui, en 1991, terminait une de ses professions de foi par cette phrase : « Nous restons ici où nous avons toujours été et serons là où nous sommes maintenant : dans notre pays natal depuis onze cents ans » ?
András Sütõ1 : Malheureusement aucune œuvre de Louis Hémon ne m’est jamais parvenue. Je sais par une encyclopédie littéraire que Maria Chapdelaine a été traduit en hongrois et publié à Budapest en 19582. Le lecteur canadien comprendrait difficilement sans explication pourquoi nous, Hongrois de Roumanie, nous n’avons pas pu acheter pendant longtemps en Transylvanie3 des livres publiés en Hongrie. Certes, un accord culturel a obligé l’État roumain à en importer quelques-uns, dûment triés par des censeurs paranoïaques, mais ce n’était qu’un emplâtre sur le visage de la dictature. 1958 marque d’ailleurs une année tragique pour nous : c’est cette année-là qu’on a prononcé à Kolozsvár la sentence de mort de l’Université hongroise. Après 1948, année de l’étatisation des écoles, ce deuxième coup a détruit le système culturel de deux millions de Hongrois transylvains, et a dégradé progressivement les relations entre la Roumanie et la Hongrie. Dans les années 70, Nicolae Ceausescu avait déjà élevé cet autre « mur de Berlin » au-dessus duquel même un oiseau ne pouvait passer vers l’Ouest, en direction d’une Budapest soupçonnée de révisionnisme. Le roman de Hémon est donc resté au-delà de ce mur, tout comme la Bible, livre particulièrement chassé par les douaniers spirituels de Bucarest. C’est à cette époque que le monde chrétien a pris connaissance, sidéré, de la destruction de 50 000 exemplaires de la Bible, don de la communauté occidentale aux fidèles protestants transylvains ; probablement sur l’ordre de madame Ceausescu, ils ont été envoyés au pilon et transformés en papier de toilettes. Une infamie notoire, à dimension historique. Comme sacrilège et insulte à la culture, elle a dépassé le cynisme du calife Omar, qui ordonna de chauffer les bains municipaux d’Alexandrie avec les papyrus de la célèbre bibliothèque de cette ville. Le dictateur ou Madame ne se seraient jamais permis de léser de la même manière l’orthodoxie, la religion d’État des Roumains, en brûlant leurs bibles. Seulement les exemplaires détruits avaient été rédigés en langue hongroise, pour apporter le message de Dieu sur l’amour et sur l’origine satanique de la haine. La xénophobie de ces athées fanatiques voulait frapper, abaisser et humilier une fois de plus les fidèles hongrois de Jean Calvin. Quel était leur objectif ? Depuis Trianon, c’est-à-dire depuis trois quarts de siècle, tous les enfants connaissent le but final du nationalisme roumain : l’assimilation ou la condamnation à l’exil des minorités parlant d’autres langues, surtout des Hongrois, des Allemands et des Juifs. Bien sûr, pas aussi ouvertement que Dieu l’avait fait en chassant Adam et Ève du Paradis. Pensez-vous ! Mais avec une perfidie et une hypocrisie diaboliques, de sorte que l’exil de centaines de milliers de gens a été salué en Occident comme l’incarnation même du « droit à la libre circulation des personnes ». Et ce n’est pas fini, puisqu’on y encaisse toujours avec satisfaction les déclarations des cryptocommunistes de l’Europe de l’Est, suivant lesquelles ils assureraient des « droits bien au-delà des normes européennes » à toutes leurs minorités respectives. Nous avons l’habitude de faire allusion aux conséquences inévitables de ce genre de privation de droits en citant Petõfi, ce poète de la révolution qui écrivait en 1847 : « Le peuple demande encore, donnez-lui donc maintenant, / Ou vous ne savez pas comme il est terrible, le peuple / Quand il se lève et ne demande plus, mais prend et saisit ? » À l’époque, Vienne avait pris peur des paroles du poète. À présent, nos dirigeants roumains se contentent d’en sourire. Ils savent bien que s’ils refusent systématiquement les revendications d’autodétermination de la minorité hongroise, celle-ci se lèvera un jour pour de bon, ne demandera plus, mais prendra. Quoi exactement ? Eh bien, la route : le peuple choisira de partir pour la Hongrie, la Suède, les États-Unis, le Canada L’exode hongrois rappelle de plus en plus celui des Juifs des temps anciens et affecte tous ceux pour qui les valeurs morales de l’humanité signifient encore quelque chose, et qui est la solidarité.
C’est ici que nous rejoignons votre exemple québécois qui évoque les doutes de Maria Chapdelaine. Ces doutes sont aussi les nôtres, et je n’imaginais guère, à l’époque où j’écrivais mon Noël en Transylvanie, que nos angoisses historiques trouveraient un écho si lointain. Bien entendu, ce serait une erreur de croire que la situation des Québécois du Canada et celle des Hongrois de Roumanie soient parfaitement identiques. Parce que, si mes informations sont exactes, les Québécois aspirent depuis longtemps à une souveraineté nationale. Or, la souveraineté ne figure pas actuellement parmi nos revendications politiques. Les deux millions de Hongrois de Roumanie se contenteraient d’une autonomie pareille à celle des Autrichiens du Sud du Tyrol, qui vivent en Italie, ou à celle des Suédois en Finlande. Il est inutile de dire que ces aspirations suscitent encore des passions irrationnelles dans les milieux gouvernementaux roumains.
« La langue est la dernière enceinte qui nous protège », écriviez-vous naguère, rappelant la devise d’une ancienne revue hungarophone de votre pays. Pensez-vous toujours que le rempart de la langue maternelle soit suffisant pour préserver l’identité d’une minorité nationale dans un État-nation de langue différente ? Et qu’est-ce qu’un écrivain peut faire pour que ce rempart continue à le protéger ?
A. S. : Des exemples historiques prouvent qu’une langue nationale garantit la survie de la communauté même dans les pires circonstances, pendant les persécutions ethniques les plus graves, mais pas éternellement. La privation des droits a créé des métaphores telles que la langue notre mère, la langue notre forteresse, la langue notre patrie, etc. Il est bien vrai que la langue peut servir de bouée de sauvetage pour l’individu jeté dans la tourmente, mais, je le répète, ce n’est qu’un secours provisoire. Les longues années difficiles viennent à bout de la résistance de l’individu et de la communauté : ils se soumettent aux forces de l’assimilation, ou bien ils quittent définitivement leur terre natale. Comment expliquer autrement le fait que le nombre des Hongrois de Roumanie n’a augmenté que de 15 % durant les 75 dernières années, tandis que celui des Roumains de Transylvanie a quadruplé pendant la même période ?
Vous me demandez ce qu’un écrivain peut faire en pareille situation. Si j’étais jeune, je répondrais : « Tous les Hongrois doivent avoir comme devoir suprême », etc. Mais maintenant, à la veille de mes 70 ans, connaissant le danger des généralisations, je me contente de dire : que celui à qui sa conscience d’écrivain ou d’artiste le permet agisse suivant l’exemple de Voltaire qui, en tant que protecteur des persécutés, sert encore de modèle aux clercs. Savez-vous comment il se souvenait, le 24 août de chaque année, de la nuit de Saint-Barthélémy ? Il tombait malade, il avait de la fièvre. Et ce n’était pas métaphorique. Je crois que la blessure que lui causaient les horreurs du fanatisme était bien réelle et ne se cicatrisait jamais. Voltaire m’a beaucoup influencé, et je reprends sa formule selon laquelle il est dommage que nous n’ayons pas réussi à couper la tête au monstre du nationalisme, mais seulement à lui tirer les oreilles.
Au Canada, la démocratie parlementaire a permis que – malgré la conquête anglaise au XVIIIe siècle, et malgré la supériorité économique aussi bien que démographique des anglophones dans ce pays – le Québec (d’ailleurs à peu près quinze fois plus étendu que la Transylvanie) décrète en 1977 que le français sera la seule langue officielle chez lui. Imaginons (rêvons un peu) que le Parlement des départements transylvains, qui sont peuplés par une écrasante majorité de Hongrois, vote une loi qui rendrait leur langue exclusive dans l’enseignement, dans le monde du travail ou dans l’affichage publicitaire. Seriez-vous partisan d’une telle loi ?
A. S. : Comme je viens de le dire, notre situation, pour des raisons objectives, diffère sensiblement de celle des francophones du Québec. Il n’est pas possible de juger la Roumanie de la même manière que le Canada qui est une confédération. La région où nous vivons est déterminée historiquement par des relations ethniques et une évolution économique tout à fait particulières, et par la présence d’agglomérations linguistiquement uniformes aussi bien que mixtes. Les Hongrois de Roumanie exigent pour eux une autonomie et les formes adéquates de l’autodétermination même là où ils sont numériquement en minorité. Le rêve n’est qu’un jeu de l’esprit, plus proche de la licence poétique que de la politique qui, elle, est la science des possibilités réelles. Pour ma part, je suis partisan d’une loi qui fasse profiter tous les habitants de la Roumanie des droits de l’homme, de ces droits qui ont déjà fait leurs preuves dans les démocraties occidentales.
Mais permettez-moi de revenir à quelques mots qui m’ont frappé dans votre question. Chez nous, en Roumanie, terre de tant d’interdictions anti-hongroises et anti-minoritaires, je ne me suis pas étonné des coups de sang du maire de Kolozsvár à cause des affiches sur lesquelles, à l’occasion d’un anniversaire de Bartók, le programme musical avait également été imprimé en hongrois. Comme vous le savez, à l’origine du pogrom anti-hongrois de Marosvásárhely4 de mars 1990, il y avait également un conflit linguistique. Que s’était-il passé au juste ? Une chose horrible ! Sur la vitrine d’une des pharmacies de la ville, à côté du mot roumain Farmacie, on avait peint la traduction hongroise (la ville compte 130 000 habitants hongrois). À l’annonce de cet « outrage à la nation », plusieurs milliers de citoyens roumains ont réagi violemment par de la casse et des insultes, sans ménager les journalistes étrangers, pour protester contre cette attaque à leur État-nation. L’Europe entière est au courant maintenant : l’attaquant était un seul mot hongrois. Mondo cane ! Je n’ai plus besoin de vous expliquer davantage pourquoi je ne comprends pas tout à fait le bien-fondé de la fameuse loi 101. Indépendamment du nombre des langues officielles d’un pays ou d’une région autonome, il n’est guère possible d’imposer des normes ou des interdictions linguistiques à la population civile. Mais juger une décision législative de si loin serait extrêmement périlleux de ma part. Par contre, je me réjouis à l’avance de ce que, grâce à cette conversation, les Québécois apprendront peut-être ce que le « syndrome de Trianon » signifie pour nous en Transylvanie.
1. Né en 1927, Sütõ (prononcer « chuteu ») a collaboré à plusieurs journaux et revues de langue hongroise en Roumanie, avant de se consacrer entièrement à l’écriture. Il met son style, d’une rare beauté langagière, au service des pauvres des campagnes de sa Transylvanie natale. Auteur d’une dizaine de volumes de nouvelles entre 1949 et 1961, de cinq comédies entre 1956 et 1968, de cinq volumes d’essais entre 1970 et 1987, il est surtout le dramaturge de sept grandes tragédies qui présentent chacune soit le combat, voué d’emblée à l’échec, de l’individu face aux intérêts du pouvoir, soit celui de la communauté hongroise de Roumanie pour sa survie culturelle : Le dimanche des rameaux d’un maquignon (1974), Caïn et Abel (1978), Étoile au bûcher (1975, porté à l’écran en 1978), Les noces de Suse (1980), Noël en Transylvanie (1985), Le commando de rêve (1987) et L’oiseau qui aboie (1993). Deux fois Prix d’État (Bucarest), Prix Herder (Vienne, 1979) et Prix Kossuth (Budapest, 1992), son théâtre n’a pas encore été publié en français.
2. La même traduction avait déjà paru en 1921 à Budapest.
3. Partie orientale de la Hongrie historique (environ 50 000 km2), la Transylvanie a été attribuée à la Roumanie aux termes du Traité de Trianon, le 4 juin 1920.
4. Dans ces émeutes des 16 et 17 mars 1990 à Marosvásárhely (en roumain Tîrgu Mures), András Sütõ, attaqué en pleine rue, a perdu un œil.