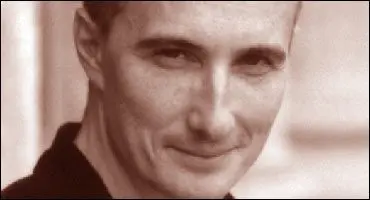Nuit blanche : Vincent Engel, à part écrire, que faites-vous ? De l’enseignement ?
Vincent Engel : J’enseigne à l’Université de Louvain la littérature française contemporaine. Chez nous, les matières sont fort compartimentées. Il y a la littérature française et la littérature belge de langue française. Et chez nous il faut dire, sans m’appesantir, que le discours de la littérature est un enjeu politique et je pense que c’est un peu la même chose au Québec. On a toujours balancé entre littérature française de Belgique et littérature belge de langue française et l’idéologie dominante consiste à parler de littérature belge de langue française. Mais beaucoup d’auteurs ne se reconnaissent pas ou ne se reconnaissaient plus dans cette manière de voir les choses. Par le passé, par exemple, des gens comme Nicolas Bouvier, André Baillon et, aujourd’hui, des auteurs comme Jacqueline Harpman, Charles Bertin considèrent qu’ils font partie de la littérature française de Belgique.
Amélie Nothomb aussi ou d’autres ?
V. E. : Elle, je ne le sais pas, mais je pense qu’elle ne se considère pas vraiment comme appartenant à la littérature belge de langue française. Elle fait partie des auteurs qui sont publiés à Paris et qui y obtiennent la reconnaissance. Et la reconnaissance passe encore et toujours par Paris. Donc, moi, j’ai le cours de littérature française et malicieusement j’explique à mes étudiants que je considère comme faisant partie du corpus tout ouvrage écrit en langue française et publié en France. Ce qui me permet de parler d’auteurs qui ne sont pas Français, d’autant que quand on regarde la littérature française d’après-guerre les grands auteurs « français » sont très rarement Français. Il y a Ionesco, Beckett, Cohen, Kundera, même si je n’aime pas Kundera. On peut citer Romain Gary, Cioran. Ils ne sont pas Français, ils sont devenus Français par fréquentation, par nécessité ou par amour du pays. Pourtant, ça constitue le corpus de la littérature française.
Et dans ce champ immense, est-ce que vous privilégiez un secteur, que ce soit la nouvelle, le roman… ?
V. E. : Oui, pendant un temps, c’est vrai que j’ai créé et animé un centre d’études de la nouvelle qui existe toujours, qui va prendre sa vitesse de croisière et qui va être pris en charge par René Godenne qui est quand même le spécialiste du genre et que cela passionne. On a organisé quatre colloques, on va lancer une revue électronique. Je ne suis plus vraiment convaincu que la question de genre est une question fondamentale. Pour moi, ce qui compte, c’est la fiction ; et je travaille beaucoup pour l’instant la question du rapport entre réalité, mémoire et fiction, à partir d’une question qui m’a toujours particulièrement touché dans la littérature : l’expérience. Comment une expérience peut être ou ne peut pas être traduite par la littérature et quel rôle la littérature joue dans la transmission de la mémoire d’une expérience qu’on dit par ailleurs indicible.
Je vais revenir à la mémoire qui est un thème fascinant chez vous, mais, petit détail à propos de l’enseignement universitaire chez vous, on réfère toujours à l’Université catholique de Louvain. Est-ce que le mot catholique a encore un contenu ?
V. E. : Pas beaucoup. En tout cas, moi, je ne suis pas catholique, je suis juif et je suis plus ou moins à l’université. Évidemment, j’ai été confronté à l’antisémitisme, ça je crois qu’on en trouve partout. Il y a des gens plus ou moins tolérants, plus ou moins intéressants comme dans toutes les universités. Par rapport au Vatican, l’Université de Louvain est très mal cotée. Ce n’est pas très sensible, sauf que, et je pense que c’est plus culturel qu’autre chose, dans la manière de percevoir les rapports sociaux, il y a des permanences qui sont, enfin qui moi me hérissent, un goût forcené par exemple pour l’humilité, humilité proclamée par ceux qui en ont le moins d’ailleurs bien entendu. Ou la conviction que tout moment de bonheur doit se payer lourdement.
Je reviens à la mémoire. De l’extérieur, en tant que lecteur, j’ai le sentiment que vous avez des rapports paradoxaux avec la mémoire. Je pense à Oubliez Adam Weinberger et, à l’inverse, à vos deux ou trois essais sur la Shoah. Dans un cas il faut se souvenir, dans l’autre il ne faut pas se souvenir.
V. E. : Quand je dis « oubliez », c’est une injonction effectivement contradictoire. Le titre m’est venu au tout dernier moment, peu de temps avant que le manuscrit soit envoyé à la composition chez Fayard, ce titre a surgi et je me suis rendu compte beaucoup plus tard en relisant un texte d’un lien avec la mère. Il est lié à ce que j’ai choisi en exergue du roman, cette petite phrase de l’Opéra des mendiants, l’opéra des gueux, donc un vieux machin, et qui est une phrase que j’adore : « Souvenez-vous de moi, mais oubliez mon destin ». Parce que, après avoir vraiment creusé la question, et je suis loin d’en avoir fait le tour, je suis convaincu que la mémoire ne peut pas faire l’économie de l’oubli, la mémoire a besoin de l’oubli pour fonctionner, mais l’oubli dont je parle ce n’est pas l’amnésie, ce n’est pas un oubli définitif, c’est un oubli comme une mise entre parenthèses, un oubli momentané, un oubli conscient du fait qu’il oublie, un oubli qui veut aussi construire une mémoire qui ne soit pas focalisée sur la mort, qui est plutôt focalisée sur la vie. Quand je dis « Oubliez Adam Weinberger », ce que je veux dire c’est d’oublier la catastrophe ou la tragédie qui a brisé le destin d’Adam ; mais souvenez-vous de ce qu’il était foncièrement en tant que personne humaine et que la vie ne lui a pas permis de réaliser.
Mais Adam refuse surtout de parler, il se souvient, mais il estime qu’il a quelque chose dans sa mémoire qui est indicible. La mémoire à ce moment-là n’est qu’autodestructrice ?
V. E. : Oui et non, parce qu’il finit quand même par le dire. Non, parce que le point de départ du roman est quelque chose de très ponctuel. En préparant un colloque avec la fondation Auschwitz à Bruxelles, j’avais été extrêmement choqué d’entendre les organisateurs qui disaient : « Le temps passe, il y a des témoins qui n’ont pas encore livré leur témoignage, il faut qu’on se dépêche parce qu’ils vont mourir bientôt. » J’avais trouvé ça sordide. D’abord, ça avait un côté « interrogatoire policier » avec le spot braqué sur le pauvre type : « Tu n’as pas encore parlé, maintenant on va te faire parler », ce qui est complètement déplacé par rapport à ce dont il est question. Je me suis dit : ils refusent d’entendre le témoignage que ces gens ont apporté par leur silence. Ça veut dire qu’on est en train de construire une mémoire qui va faire l’impasse sur cette notion fondamentale qu’il y a beaucoup de survivants qui n’ont pas parlé. Moi, si je me suis à ce point intéressé à la question de la Shoah, c’est parce que mon père ne m’en parlait pas et c’est le silence de mon père qui m’a conduit à faire des recherches et à aller voir. Alors, c’est vrai qu’Adam très longtemps se tait, mais quand même il finit par parler, il finit par élaborer quelque chose, il ne faut pas trop dévoiler la fin. Il finit par dépasser ce silence après un long oubli.
Il change tellement d’identité, pendant longtemps il ne veut pas parler et quand il parle, c’est presque une concession qu’il fait à la fin grâce à un nouveau petit personnage qui l’émeut et devant lequel il s’ouvre enfin. Non seulement il veut préserver son secret mais il prend des précautions, y compris le changement d’identité pour ne pas qu’on le retrouve. Il ne veut vraiment pas parler !
V. E. : Non, il ne veut pas parler et il y en a beaucoup d’autres.
Qui préfèrent ne pas parler ?
V. E. : Oui.
Je ne sais si vous connaissez le bouquin d’une Torontoise, Anne Michaels, sur ce même thème de la mémoire. Chassé de la Pologne, un petit bonhomme s’en va à travers le monde. Il sera élevé par un Grec qui n’est pas juif mais qui lui ressuscite la mémoire et la culture des siens. La jeune fille qui écrit ce livre fait partie de la génération qui a suivi ceux et celles qui ont vécu le drame et elle ne sait pas si elle doit se souvenir ou pas. Le titre est La mémoire en fuite (Boréal, 1998). La jeune fille qui n’a pas vécu cela vit dans une famille où on l’a abreuvée de souvenirs et elle ne sait pas quoi faire de ce dépôt-là. Elle se dit : « On me transmet ça comme une douleur que je ne peux pas ressentir, je n’ai pas de souvenirs pour me confronter à des souvenirs. » Dans votre cas non plus. Que devient alors la mémoire ? C’est ce que j’appelle votre paradoxe de la mémoire.
V. E. : On est dans une époque extrêmement compliquée de ce point de vue et là je fais une remarque qui dépasse de loin le cas particulier de cet événement historique. On vit à une époque où l’on ne veut rien oublier, on est saturé de mémoire, surtout en Europe. On trouve un bout de mur qui date du XIVe siècle, on n’y touche pas. S’il y a une horreur baroque qui a été ajoutée dans une église romaine, on va la laisser parce que c’est là, on restaure les partitions dans leur état le plus originel possible, on essaie de trouver des instruments d’époque, etc. Ça donne des choses parfois extraordinaires, mais surtout ça rend la mémoire totalement exorbitante, on ne sait plus tout retenir et le fait d’avoir des ordinateurs ne peut pas nous servir de mémoire, ce n’est pas une mémoire ce quelque chose qui n’est pas vraiment intégré. On ne peut plus rien oublier et je crois qu’on va arriver à quelque chose de pire que l’oubli, qui ne sera pas la mémoire, qui sera une saturation et une fixation. Pour moi la fixation c’est la mort. Je crois donc qu’on est obligé, pour qu’il y ait une mémoire, de passer par l’oubli et d’oser l’oubli. Dans ce texte que je ne connais pas, ce que j’entends dans ce que vous m’en dites, c’est « comment trouver l’écho de ma personnalité dans cette mémoire qui n’est pas la mienne ». C’est ça le problème de la génération qui suit l’expérience. Pourquoi dois-je me souvenir de quelque chose que je n’ai pas vécu ? C’est une chose de se souvenir de son passé à soi, mais c’est autre chose de faire sien un passé qui n’est pas le nôtre. On dit aux jeunes : « vous devez maintenir la mémoire de la Shoah parce que c’est une expérience radicale », mais en même temps on leur dit que c’est une expérience indicible et on leur dit que c’est une expérience inimaginable ; c’est impossible évidemment. Je crois, il faut oser dire, que la mémoire de la Shoah doit être une mémoire orientée vers la vie et pas bloquée par la mort. La mémoire ne doit pas être un monument aux morts, les gens sont morts là-bas, mais ceux qui sont morts étaient des gens qui voulaient vivre, qui allaient vivre. Le judaïsme, ce n’est pas la souffrance, le judaïsme n’est pas lié à la douleur. C’étaient des gens joyeux, tristes, embêtants, pas embêtants, enfin comme tout le monde et c’est de ça, je crois, qu’il faut se souvenir. Oublier une partie pour essayer de se souvenir de quelque chose de plus essentiel.
Est-ce que vous êtes un moraliste ? Au sens de Pascal ou de Camus ?
V. E. : Oui, au sens de Camus très certainement. Pour moi Camus c’est la référence.
Et pourtant – paradoxe au moins apparent surtout dans certaines de vos nouvelles – on a l’impression que choisir ou ne pas choisir, ça vaut pareil.
V. E. : Oui, chez Camus aussi. La lecture du Mythe de Sisyphe rend équivalents tous les choix. Il n’y a qu’une chose qui est importante, et qui pour moi est fondamentale dans l’œuvre de Camus, c’est de ne jamais accepter : ni le suicide, ni l’espoir. C’est rester dans une révolte et un mouvement permanents. Ne jamais accepter et ne jamais se consoler.
Mais il termine en disant : « Il faut imaginer Sisyphe heureux ».
V. E. : Heureux parce que, justement, il est continuellement dans la provocation et dans le retournement de ce qui était une condamnation et qui finit par constituer son identité.
Mais il choisit de résister ?
V. E. : Oui.
Il choisit de se révolter ?
V. E. : Oui, c’est le choix qu’il fait. Je pense quand même que ce choix est présent aussi dans ce que j’écris.
Je pense, vous me l’interpréterez, à cette première nouvelle, dans La guerre est quotidienne, où celui qui se destine à la littérature ne veut pas choisir. Il ne se mêle de rien et la vie l’oblige à trancher. Ne pas trancher, c’est quand même choisir ?
V. E. : Ah ! Oui.
Et pourtant tout vaut pareil ?
V. E. : Oui, en fait, il doit choisir, il est obligé de choisir parce qu’on est tous obligés de choisir, comme chez Camus il faut faire un choix.
Chez Camus, comme dans votre vocabulaire, il faut se révolter et ne jamais se résigner, mais vous avez des personnages qui rejettent cette option. Je vous demandais si vous êtes un moraliste pour savoir si je peux vous lire, vous, à travers telle ou telle de vos nouvelles et y lire vos convictions…
V. E. : Oui, le Meursault de L’Étranger est dans cette situation lui aussi. Il ne choisit jamais, il est conduit par les événements à accomplir une série d’actes qu’il n’a pas choisi de commettre, il ne peut pas dire non à telle et telle personne, il finit par tuer quelqu’un sans vraiment savoir ce qu’il fait et il y a, alors, prise de conscience. On pourrait discuter longuement de L’Étranger parce qu’on a une lecture un peu tronquée de ce roman. Meursault est un peu dans la position du personnage de ma première nouvelle qui est contraint à un choix. Mon personnage n’est pas dans la même position que Meursault, mais il est contraint à un choix indépendamment de sa volonté ou contre elle, mais il doit choisir. Dans son cas le choix n’a pas d’importance ou si vous voulez les conséquences du choix sont égales, mais je crois que Camus dit aussi qu’il faut choisir, mais finalement, au regard de l’absurde, que l’on choisisse telle chose plutôt que telle autre, ça n’a pas d’importance. Dans Le mythe de Sisyphe, Camus dit très bien que l’art est ce qui permet de vaincre la mort, mais que choisir l’art ou ne pas choisir l’art revient au même.
Je reviens à cette nouvelle, même si je ne veux pas en faire un microcosme. Vous avez un individu qui est un lâche. Jusque-là, il l’a été. Il aurait l’occasion de sortir de sa lâcheté par un choix. Chez Camus, quand Meursault tue parce qu’il a le soleil dans les yeux, il choisit. Mais votre personnage ne veut pas choisir et la vie le rattrape et dit : « Tu es obligé de choisir. » Est-ce que ça vaut la peine, est-ce que la liberté vaut encore le coup si tous les choix valent la même chose ?
V. E. : Non, mais je ne sais pas si cette nouvelle est exemplaire de tous mes personnages ; ce Charles, c’est moi d’une certaine manière. Charles de Vinelles, c’est mon nom, c’est moi. On donne très vite des grandes réponses, on dit : « Ah ! S’il y a la guerre, moi c’est sûr je rentre dans la résistance », mais je n’en sais rien du tout. J’ai poussé ce « je n’en sais rien du tout » à l’extrême en me disant ceci : pour moi, l’écriture compte beaucoup. Est-ce que je suis prêt à sacrifier ça pour quelque chose, ce que je vais dire est peut- être horrible, pour quelque chose d’aussi insignifiant qu’un enfant totalement acculturé ? C’est monstrueux comme question mais je crois qu’on doit pouvoir l’affronter parce que, si un jour on y est confronté, je ne suis pas sûr de la réponse que l’on y donnera.
Dans vos autres nouvelles, vous présentez des situations complètement différentes. Dans « Sapienbourg », deux amis correspondent. Thomasso et Johann s’aiment beaucoup et sont séparés l’un de l’autre. Une sorte de déterminisme implacable fait alors qu’ils s’en vont chacun dans sa direction. À la fin, ils dirigent deux armées rivales mais ils n’ont jamais choisi. Choisir ou non, ça donne la même chose…
V. E. : Oui, c’est vrai. C’est amusant parce qu’en deux jours j’ai été deux fois confronté à l’image contraire de ce que j’enseigne. Avant-hier, j’ai rencontré une journaliste à Montréal qui m’a dit par rapport à ce que je croyais que ce n’était pas tellement la révolte qui prévalait chez moi mais le refus. C’est vrai que je suis convaincu que le choix est extrêmement important et les exemples que vous me donnez montrent à suffisance que c’est vrai, qu’il y a souvent des cas où il n’y pas de choix.
Et choisir ne donne rien ?
V. E. : Oui, choisir ne donne rien.
Mais est-ce que vous reconstruisez le choix un peu comme vous le faites avec la mémoire ? Elle doit venir après l’oubli et l’oubli revient après elle. Y aurait-il un jeu sans fin dans la condition humaine ? Est-ce qu’il faudrait passer par l’absurde pour choisir l’absurde, pour sortir de l’absurde et ainsi de suite ?
V. E. : Non.
Êtes-vous un moraliste ?
V. E. : Je suis en train de gamberger beaucoup. Je suis convaincu, intellectuellement du moins, d’être extrêmement proche de la position de Camus, même plus que proche, convaincu que le constat de l’absurde ne peut conduire qu’à un dépassement de l’absurde, qu’à une lutte contre l’absurde et qu’à une nécessité de la raisonner. Je repense à d’autres personnages, dans La vie oubliée. C’est vrai, ils font certains choix mais beaucoup d’autres gestes sont dictés par les événements. Il y a un fatalisme très fort. C’est vrai que moins rationnellement et plus sentimentalement, j’ai un côté extrêmement fataliste. C’est même quelque chose que je commençais à oublier et que vous me forcez à ramener à la mémoire. Je suis très convaincu que les choses arrivent quand elles doivent arriver et qu’il y a une relative prédestination.
Il y a un thème ou un mécanisme qui me paraît récurrent : le changement d’identité, le masque, le carnaval de Venise, le double masque dans Raphaël et Laetitia… Que représente le masque ?
V. E. : Ça représente l’ennui d’être contingent, l’ennui d’être obligé de correspondre à une seule identité. C’est aussi la marque de la difficulté de faire comprendre aux gens que l’on n’est pas seulement l’expression ou l’image qu’ils ont de nous. Pour prendre un exemple très concret, j’ai des difficultés énormes à faire valoir dans mon université que je suis à la fois professeur et écrivain. S’il y a un endroit que je fréquente et où on ne parle jamais de mes bouquins, c’est mon département à l’université et je suis en littérature pourtant !
Le masque est obligatoire ?
V. E. : Le masque est obligatoire, mais je ne l’ai pas choisi.
On vous restreint à une seule identité monochrome et il n’y en a pas d’autres ?
V. E. : Voilà ! Et donc je sais qu’ils savent et je sais aussi qu’ils ne m’en parleront pas et ça c’est extrêmement désagréable, c’est constant. Les étudiants ont une image de vous qu’ils vont essayer de modifier. J’ai un collègue qui m’a précédé. Il écrivait et il a toujours écrit, peu, mais il a toujours tout publié sous pseudonyme. Il ne m’en avait jamais parlé ; de nouveau un masque… C’est une contrainte mais il y a le jeu aussi, qui me semble plus important. C’est la possibilité de démultiplier les choses, d’avoir des langages différents. Pour moi ce n’est pas une qualité ou un défaut, c’est comme ça, j’aime changer de style parfois assez radicalement même si on ne change pas jamais complètement ; faire assumer par un masque un style différent, avec des jeux, avec des pièces qui sont en train de se mettre ensemble. Tout va constituer une composition où chaque texte va trouver sa place avec des liens entre chacun et donc le masque devient vraiment un abîme, chaque masque étant le reflet d’un des aspects d’identité.
Votre pseudonyme Baptiste Morgan, est-ce cette volonté ?
V. E. : Certainement. Baptiste c’est moi à 18 ans, sans aucun doute. C’est un personnage insupportable, un emmerdeur, un orgueilleux, un prétentieux… Et j’ai beaucoup de tendresse pour lui ! Baptiste apparaît déjà comme personnage dans une nouvelle. Son oncle Sébastien Morgan est un photographe qu’Adam va voir après la guerre. Aristide Morgan, son arrière-grand-oncle, est narrateur dans Raphaël et Laetitia et dans le prochain roman, non seulement on aura la suite de l’histoire de Raphaël et Laetitia, mais Sébastien Morgan en devient un des personnages principaux. Baptiste est à la fois personnage et écrivain. Ce qu’il écrit ne s’intègre pas dans l’ensemble qui est en train de se constituer mais ce n’est pas moins important et représentatif de ce que j’ai envie de faire.
Quand je vous avais interviewé au Salon du livre de Québec il y a presque deux ans, je vous avais posé une question sur cet univers, ce lieu que je ne savais trop comment qualifier, de Maramisa. Où en êtes-vous ?
V. E. : Maramisa, c’est un autre grand projet que je poursuis. Il va y avoir un ensemble de textes, des nouvelles et des contes qui existent déjà mais qui n’ont pas été publiés, un premier roman… C’est un de ces grands romans que je ne veux pas écrire trop vite, je veux me laisser encore quelques années.
Mais qu’est-ce qu’est Maramisa ?
V. E. : Maramisa pour moi, c’est la réécriture de l’histoire du peuple juif. C’est vraiment ma vision du judaïsme, ce que je considère, de mon point de vue, comme étant l’essence du judaïsme.
Mais c’est un monde en dehors duquel on ne peut survivre ?
V. E. : C’est une des spécificités qui s’est imposée à moi, ce n’était pas réfléchi. Ce sont vraiment les personnages de Maramisa qui ont dicté cette nécessité ou cette impossibilité : on meurt en faisant un pas de trop, en s’éloignant de Maramisa et il y a vraiment une cohérence de cette civilisation, de ce peuple. Je suis, moi, l’archéologue de mon imaginaire. Je découvre là quelque chose qui attend d’être découvert – comment dire ? – qui me préexiste ou qui s’est constitué à mon insu et à la découverte de laquelle je vais marcher.
Vous gérez un fond ?
V. E. : Gérer un fond, oui.
Vous puisez dedans, vous l’exploitez.
V. E. : Et j’y vais vraiment avec l’avidité, la curiosité et l’innocence d’un découvreur.
Est-ce à cet univers ou à ce mécanisme, je n’aime pas le terme, qu’on peut rattacher le fait que certains de vos bouquins ou de vos nouvelles ne se terminent pas, ne concluent pas. C’est presque un pied de nez au lecteur. Je pense à Raphaël et Laetitia… Vous racontez une histoire extraordinaire et puis, et puis… on attend toujours la fin ! Saviez-vous au commencement que vous ne nous donneriez pas la fin ?
V. E. : En l’occurrence, non. Dans une première version, j’avais la fin. Et puis, en relisant, je me suis dit mais qu’est-ce que c’est mauvais, cette fin est ridicule, beaucoup trop explicite, ça n’a aucun intérêt ! J’ai donc retravaillé le texte et j’ai supprimé la fin. Je vous ai dit que le prochain livre va donner la suite, mais il ne va quand même pas donner la fin. On a trop longtemps défini la nouvelle comme étant un genre où la chute était presque tout et ça m’énerve. Je crois que, si c’est ça, la nouvelle est condamnée. Dans trente ans il n’y en aura plus. Si tout le monde dit que la nouvelle exige une chute, on enferme le genre dans une définition qui va l’asphyxier. Terminer sur une finale frustrante, c’est pour moi obliger le lecteur à imaginer et lui donner toute liberté d’imaginer ce qu’il veut. Je n’ai aucune envie de contrôler ce que les gens vont imaginer être la suite ou la fin de l’aventure de Raphaël et Laetitia. Au point où j’en suis maintenant, je n’en sais plus rien puisque j’ai abandonné la première fin que j’avais imaginée et que cette première fin n’a plus aucune raison d’être puisque Laetitia y mourait, alors que maintenant je peux vous assurer qu’elle continue à vivre et qu’elle se porte bien par la suite !
Et c’est la même chose avec Dominique Hardenne (La vie oubliée, L’instant même, 1998), c’est la même chose avec votre intellectuel français face à l’officier allemand… De plus en plus, me semble-t-il, vos textes laissent le lecteur libre d’imaginer la suite, mais ça le prive de ce que serait votre jugement de moraliste sur la question.
V. E. : Dans le cas de Charles de Vinelles, je me suis vraiment trouvé dans l’impossibilité de trouver une fin. Je ne sais pas ce que je ferais à sa place, mais il y aura une suite aussi et il y a un roman prévu. Charles de Vinelles trouve sa place dans l’ensemble, mais je ne vous dévoile pas la manière dont ça va se délier.
De notre côté nous ne dirons pas non plus qu’il n’y a pas de fin parce qu’il y a quand même des lecteurs qui tiennent à une fin.
V. E. : Et moi je tiens à les frustrer parce que je crois que c’est salutaire, même s’ils ont envie de me mettre leur poing dans la figure. Peu importe, j’en prends le risque, car je crois que toute frustration est extrêmement salutaire pour l’esprit.
Je termine en fermant la boucle. Vous êtes de la génération qui n’a pas connu l’Holocauste, qui en a entendu parler et qui ne sait pas toujours quoi faire de cela. Est-ce éternel ?
V. E. : Alors de deux choses l’une : ou ça ne l’est pas et alors il faut que j’arrête, ou il y a quelque chose qui sera éternel mais de portée suffisamment universelle pour parvenir aux générations suivantes. Ce que mon fils et ce que la génération de mon fils sauront de cet événement, ce sera la mémoire que ma génération aura réussi ou non à construire et dont ils feront peut-être encore tout autre chose. Admettons que nous échouions et que le constat soit une relégation dans l’oubli, rien ne nous dit que la génération de nos enfants ne va pas agir en archéologue…
Oublier ou retrouver des souvenirs ?
V. E. : C’est ça, si on les retrouve… Sinon, c’est vraiment fini, il y a eu trois générations, passons à autre chose. Je n’en sais vraiment rien, je suis curieux et j’entends faire ce que je peux pour faire ce que je crois devoir faire. On revient à la question du choix de tout à l’heure. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose et c’est indéterminable, mais je crois qu’on doit agir en fonction de sa conscience et de ce que l’on croit devoir faire.
Vincent Engel a publié :
Romans : Un jour, ce sera l’aube, Labor, Bruxelles, L’instant même, Québec, 1995 ; Raphaël et Laetitia, romansonge, Alfil, Paris, L’instant même, Québec, 1996 ; La vie oubliée, nature morte IV, L’instant même, Québec, Quorum, Ottignies, 1998 (sous le pseudonyme de Baptiste Morgan) ; Oubliez Adam Weinberger, Fayard, Paris, L’instant même, Québec, 2000 ; Retour à Montechiarro, Fayard, Paris, 2001.
Nouvelles : Légendes en attente, L’instant même, 1993 (Prix Franz de Werner) ; La vie malgré tout, confessions nouvelles, L’instant même, 1994 (Prix de la Renaissance de la nouvelle) ; La guerre est quotidienne, L’instant même/Quorum, 1999.
Essais : Fou de Dieu ou Dieu des fous, L’œuvre tragique d’Élie Wiesel, De Boeck, Bruxelles, 1989 ; Pourquoi parler d’Auschwitz ? Les Éperonniers, Bruxelles, 1991 ; Le genre de la nouvelle dans le monde francophone au tournant du XXIe siècle, Actes du colloque de l’Année Nouvelle, à Louvain-la-Neuve (dir.), L’instant même/Canevas, Frasne, 1995 ; Nos ancêtres les Gaulois, Impressions d’écrivains sur la francophonie (dir.), Quorum, 1996 ; La nouvelle de langue française aux frontières des autres genres, Volume I, Actes du colloque de Metz (dir.), Quorum, 1997 ; Au nom du père, de Dieu et d’Auschwitz, Peter Lane, Berne, 1997 ; L’histoire de la critique littéraire, du XIXe au XXe siècle, Academia, Ottignies, 1998 ; Frédérick Tristan ou la guérilla de la fiction, du Rocher, Paris, Paris, 2000.