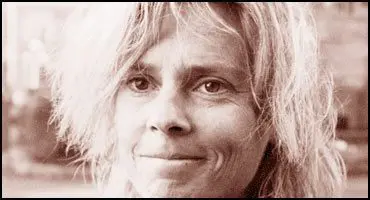En assumant une charge importante dans le domaine de l’édition et en favorisant l’oralité poétique à travers des enregistrements et des lectures publiques, Hélène Dorion travaille à protéger toujours plus la zone d’ineffable qu’elle et les poètes du clair-obscur refusent de voir banalisée comme toute autre production.
Il est difficile de prétendre rencontrer un poète, alors que ses cent cartes de visite l’incarnent déjà dans chacun de vos sens, langage y compris. Comment pourra-t-il bien se présenter à la suite de sa propre parole et des évocations qu’elle a su générer ? Et comment vous approcher par ce seul échange de cet îlot de phrases aux migrations profondes et complexes ?
De surcroît, l’émetteur du poème est aussi un être imprévisible et toujours inconnu, parfois « illuminant » dans ses répliques, à un autre moment soumis à l’absurdité du quotidien. Mais avec un trop grand bagage d’attentes, on risque d’oublier que le poète est là pour collaborer à notre initiative de connaissance, jouer comme il peut avec nos velléités d’être intense. Cependant, où est-il, le poète, « Sans bord, Sans rivage, Sans figure1 », quand son activité l’écartèle entre réel, possible, enfance et pouvoir ?
« Le poète jeté aux chiens2 »
Cette fugacité de la personne et surtout du poétique, Hélène Dorion doute qu’elle soit souvent rendue par le discours des médias de communication sur la littérature. Pour elle c’est davantage, outre la lecture, l’écoute des textes lus par leurs auteurs qui peut nous faire approcher de leur substance, directement dans le tissu de la voix où ils ont leur origine. « Entendre les poètes lire leurs textes permet aux gens de toucher à cette voix à l’intérieur d’eux, affirme-t-elle, ce qui n’est pas si évident dans le monde où l’on vit. » Autrement, la rencontre peut facilement ne pas avoir lieu, différée par la tentation biographique ou les généralisations relatives à la théorie, à l’histoire littéraire. « Le problème des étiquettes, dit encore Hélène Dorion, c’est que ça ferme les mots, alors qu’en poésie on travaille à les ouvrir, à les rendre féconds. »
La prêtresse et l’enfant
La façon qu’a Hélène Dorion de partager l’indicible, si elle n’est pas elle-même entièrement indicible, participe de la délicatesse dans la manipulation des traces laissées de l’origine. S’exprime à l’origine l’application naïve (au sens de l’art naïf) à traduire, sur les murs d’une grotte ou ailleurs, une interrogation naturelle pour une conscience en situation ambiguë. Toujours suspendue dans l’espace entre étonnement, terreur et enchantement.
Dans Les murs de la grotte, le deuxième livre qu’Hélène Dorion publie aux éditions de La différence, se trouvent ainsi auscultés de concert le monde des signes, l’univers physique, la réalité personnelle et une humanité plus large. Quelques textes publiés en édition bilingue allemand / français sous le titre La caverne de l’histoire avaient donné un aperçu de cette quête aux accents qui rappellent les philosophes présocratiques, eux-mêmes proches de la poésie, quête d’une parole première sous la surface emmêlée des différentes paroles, où l’accès au monde serait donné sous forme de fissure dans le tourbillon opaque des apparences.
« J’ai commencé à écrire, et c’était situé du côté de l’histoire humaine, à partir de cette image de la grotte qui évidemment évoque Lascaux, Platon, la naissance de l’écriture, la main, etc. Je me suis demandé : comment est-ce que le commencement de l’univers résonne en moi, à une échelle humaine et individuelle, dans un questionnement de l’origine. Père, mère, ne sont pas limités ici. Ils viennent des premiers êtres et de leurs vertiges apparentés au mien. Il s’agissait d’éprouver la poésie comme moyen de connaissance, au même titre que la paléontologie, grâce à l’imagination créatrice qu’a évoquée Einstein entre autres dans des déclarations dont on a encore fait trop peu de cas. »
Chez Hélène Dorion, l’inscription scripturaire, l’image, sont à la fois un commencement et une résonance ininterrompue à travers les générations passées et à venir. C’est peut-être pourquoi, rattrapant l’écho de préoccupations sans âge précis, elle atteint à une proximité indéniable avec celui qui écoute, se faisant le catalyseur d’une voix à ce point étrangère qu’elle retrouve le chemin du familier. « Cela » parle, tout bonnement, inépuisable et, comme elle le dit, définitif : plus question d’oublier la mince brèche effectuée par le poème dans notre dérive quotidienne. L’attitude poétique, depuis toujours chez les humains confrontés au manque et à l’inconnu, est donc à la fois répercussion et recherche, phrase envahissante et habitation de la phrase. Dans la caverne où est située notre conscience et que parsèment les faits bruts et les faux pas de l’histoire, la création est réponse à une exigence de vérités incarnées, d’une nécessité qui paradoxalement sera pressentie par une liberté qui la modèlera.
« Le seul fait d’être poète et d’écrire de la poésie revient à s’opposer au monde tel qu’il est, déclare Hélène Dorion, mais la poésie est aussi un travail de lucidité […] Lorsqu’on vit trop dans la certitude et dans l’absence de questionnement, on perd sa capacité à aimer ; parce qu’aimer c’est être dans ce tremblement, cet ébranlement, cette capacité à questionner. » Rarement voit-on se conjuguer ainsi rigueur et fragilité, désir de savoir et besoin de sentir. « Ce n’est pas si facile d’être fragile », tient-elle d’ailleurs à souligner. Devenir en quelque sorte une autorité dans le champ poétique tient tout entier dans cette complexité, celle d’un ton où l’assurance modulée de la prêtresse se trouve, au détour, hachurée par l’angoisse d’une enfant devant le souffle glacé de l’inconnu à défricher. C’est pourquoi, si le caractère intime de ses textes ne les rend jamais strictement personnels, l’exhortation ouvertement collective qui pointe dans les derniers écrits d’Hélène Dorion s’accompagne inversement d’une humilité qui tient à la précarité du pouvoir poétique. « Précarités du jour » aussi, comme Jean Tortel titrait un de ses livres en 1991, puisqu’il ne s’agit somme toute pour le faiseur de vers que de ces « Noces de l’absolu et du passager3 » où le risque s’immisce.
Une sagesse de l’amour
Sans bord, sans bout du monde, le précédent recueil d’Hélène Dorion, traduisait déjà plus vigoureusement que jamais cette quête d’équilibre au cœur du fourmillement chaotique des choses. Elle décrit ce livre comme un « chemin de réconciliation entre limites contradictoires, entre fini et infini, jusqu’à un commencement sans commencement ». En fait, c’est à un véritable recommencement à l’intérieur de son œuvre que l’on assiste depuis Un visage appuyé contre le monde, paru en 1990, mais écrit postérieurement aux États du relief (1991) qui présentaient un choix de textes inédits plus anciens. Depuis, l’importance accordée au quotidien, inspirée entre autres par Michel Beaulieu, a diminué, et le combat contre le non-sens et l’improbabilité d’une direction solide a été recouvert par un vent d’espérance à l’instinct sûr, au-dessus des tourments, qui dorénavant se prêtent à la maîtrise. Cette sorte de « paix dans les brisements », selon un titre d’Henri Michaux, doit sa sérénité à une incarnation encore plus grande, dont les racines rejoignent le passage qu’elle effectua autrefois de la philosophie à la littérature, à l’instar de nombreux écrivains ou artistes. « J’étudiais la philosophie, et la rencontre indirecte avec Bonnefoy m’a révélé toute une partie inactive de moi-même. En sa compagnie j’ai mis plusieurs années – et quelques livres ! – à découvrir qu’on ne résout pas une absence au monde : on l’habite. J’ai cessé de rechercher un pourquoi pour travailler dans un comment. »
On saisit là, du moins, la raison des références faites aux philosophes grecs et du positionnement du poète en un lieu où les concepts ne cessent de naître et où la moindre constatation émotive fait force d’universel, dans une sorte de berceau commun des diverses facultés de l’esprit. Pour Hélène Dorion, nul besoin de séparer de façon exclusive l’inspiration, le travail, les sens, la raison. Plutôt : les intégrer dans l’alternance et dans un projet de retour aux accès premiers de la conscience à elle-même dans le monde, et mener le regard critique vers une pureté amoureuse difficile à atteindre, mais dont il ne saurait se passer. « À ce stade-ci l’humanité a besoin de choses comme la poésie, entre autres pour nous restituer notre capacité à aimer, souvent oubliée, qui est le fondement, sous toutes les formes qu’elle peut prendre, de notre présence au monde. »
L’édition comme poésie
Depuis qu’elle fait partie des éditions du Noroît comme directrice littéraire, Hélène Dorion s’est imposée comme une personnalité incontournable de l’édition québécoise de poésie ; on lui reconnaît une vision large, non limitée dans l’espace ni dans le temps et une influence considérable sur les jeunes auteurs et certains de leurs devanciers. Chez les poètes du Noroît d’ailleurs, toutes générations confondues, se reflète l’importance de la quête du sens, l’abstraction et l’ironie ne comptant guère chez eux parmi les ingrédients du poème. La poésie métaphysique des Rainer Maria Rilke, René Char et Yves Bonnefoy trouve ici ses continuateurs, ce qui comporte un risque, un certain manque de relief. Il est toutefois rare que la cohérence éditoriale soit poussée aussi loin, qu’elle rallie autant de voix sans se rigidifier à outrance. Cela tient, explique Hélène Dorion, à un travail d’équipe rigoureux : les manuscrits sont étudiés en commun et soumis à une épuration qui vise l’honnêteté la plus stricte. « J’essaie de faire en sorte que mon travail d’édition et mon travail de poète s’entre-nourrissent, souligne Hélène Dorion. Ça a été, depuis sept ans, dans une continuité naturelle avec mon engagement en poésie. » Comme quoi une activité aussi solitaire que l’écriture peut déboucher sur la participation au travail d’une confrérie, non dogmatique, mais féconde en échanges. Les contacts avec l’étranger, la coédition, les traductions ont permis à une optique plus universelle de se développer. « La poésie québécoise est très appréciée dans la francophonie. On a cette capacité d’être lus ailleurs, de déborder des frontières, qui n’existent pas de toute façon. Je pense que la poésie doit travailler en dehors des frontières. Je n’accorde pas une importance centrale à la France par exemple. »
Si elle apprécie chez La différence un milieu chaleureux et vivant malgré la taille de l’entreprise, Hélène Dorion n’a cessé de multiplier ses contacts avec d’autres éditeurs. Pour elle, publier inclut la responsabilité d’assumer un constant métissage de perspectives, ce que les traductions de son œuvre lui ont aussi apporté. « C’est très important pour moi de rencontrer des poètes de langue étrangère. Être traduite évidemment ouvre des avenues intéressantes. En plus de l’espagnol et du roumain j’ai été traduite en finnois en 1997, dans un ouvrage collectif, et en portugais. La traduction aide à voir comment la misère humaine, la solitude peuvent être les mêmes partout. »
Le résultat de cette ouverture, de la création d’un espace propice à l’élaboration d’un chant détaché des aspects trop circonstanciels ou anecdotiques, a attiré ou conservé au Noroît des auteurs chevronnés. L’accompagnement, la complicité qu’ils y retrouvent sont aussi recherchés. Complice d’importance pour la poétesse, Paul Bélanger, codirecteur littéraire et fine plume (il faut lire Fenêtres et ailleurs !), avec qui se poursuit une interaction qui semble capitale : « On a un rapport à la poésie qui est le même. On se relance, s’interroge mutuellement, on s’échange des doutes et des certitudes, ce qui est extrêmement fécond. Ensemble, on veut créer un lieu où les auteurs soient en confiance et sentent l’amour qu’on a pour la poésie et le désir qu’on a de la servir ; car c’est cela en fait, faire de l’édition, de la même façon qu’un auteur sert la poésie. »
Un des fruits de cette collaboration est la pertinente collection d’essais littéraires « Chemins de traverse », à laquelle sont venus contribuer par leurs réflexions des poètes aussi importants que Jacques Brault, Fernand Ouellette et Pierre Ouellet. Dans un style imagé et libre, l’écriture et l’art, repensés de l’intérieur, s’expriment dans une réflexion qui devient à son tour œuvre d’art. Hélène Dorion, qui au cours des années a accumulé de tels essais, pense-t-elle participer à cette collection un jour, y devenant la première voix féminine ? « Pour moi ça doit dormir longtemps, mais… » Il sera sans doute intéressant de voir cet esprit nous livrer sa conscience d’une pratique dont on sait qu’elle a pu la hisser à la hauteur de ses propres lectures.
Publier, taire
C’est en conjuguant la fraîcheur d’invention et une attentive observation de la création poétique, ici et à l’étranger, qu’Hélène Dorion a su se frayer un chemin jusqu’à la particularité de son chant. Issue de l’écriture féministe et d’un recentrement sur le vécu quotidien et personnel, elle est devenue une de ces voix hors des courants et des modes, une voix qu’on veut imiter dans ce qu’elle a d’inimitable et d’inédit. Car elle a en quelque sorte répondu à l’exhortation de Claude Gauvreau de rechercher « l’imprévisible et l’inimitable », pour lesquels « il n’existe pas d’indications4 ».
« Je crois que la poésie témoigne du pouvoir du silence. Elle travaille dans ses bords. La parole et le silence ensemble, c’est peut-être ce qui fait ce qu’on appelle le chant de l’être : sa parole nourrie de son silence. Écrire c’est écouter. C’est-à-dire avoir à faire silence. Pas un isolement, mais une autre dimension de la parole. » C’est d’ailleurs en deçà du silence que se situent les descriptions que l’on aimerait faire d’une poésie qui s’est trouvée. « Et plus inexprimables que tout sont les œuvres d’art, ces êtres secrets dont la vie ne finit pas et que côtoie la nôtre qui passe », disait encore Rilke dans ses fameuses Lettres à un jeune poète.
Collaboratrice de longue date à de multiples revues – elle a fait ses débuts avec l’équipe d’Estuaire alors à Québec –, Hélène Dorion cherche à contribuer à toutes les actions qui construisent des passerelles entre les divers niveaux du poétique, entre les écrivains et le public. Elle se plaît particulièrement à exploiter le médium de la « lecture-spectacle », surtout depuis ses récitals avec Denise Desautels, ramenant le texte vers l’oreille dans des lieux aussi contrastés qu’une église et un centre d’incarcération.
Alternances, enregistrement réalisé en compagnie de Denise Desautels et de Violaine Corradi, est un des moments forts de la collection « Poésie / Musique » du Noroît, un autre de ses enfants chéris. C’est d’ailleurs grâce à ce volet que nous avons pu entendre Jacques Brault lire ses œuvres, de même que des poètes dits de la relève. Plus récemment, des voix venues de toutes les maisons d’édition y ont élaboré Autour du temps ; pour ce disque compact, une quinzaine d’auteurs ont fait cadeau d’un texte inédit sur le thème du temps, une manière différente de comprendre la poésie québécoise moderne. Ils sont nombreux depuis quelques années ces disques qui tentent de rapprocher la poésie de l’oralité et de la musique ; il est clair que des attentes nouvelles existent à cet égard. Hélène Dorion mise plutôt sur les médiums où un contact assez direct et plus chaleureux est maintenu. L’autoroute électronique, la télévision, lui semblent secondaires pour diffuser une activité qui demande à la fois une présence forte, mais discrète, et une retenue féconde, un espace où le poème peut se recomposer. Si on l’interroge sur le critère selon lequel le nombre d’acheteurs et de consommateurs viendrait obligatoirement valider une pratique culturelle et si l’on suggère que, dans la profusion actuelle, les effets indirects de certains champs restreints ont leur importance, Hélène Dorion répond : « Il y a une liberté et une rigueur qui peuvent surgir de la petite échelle à laquelle le poète doit souvent travailler. Le pouvoir de la poésie est là : dans une personne vraiment atteinte, qui s’en retourne changée et va même diffuser cet effet, qui est durable, profond et irréversible. » Peut-être serait-il donc temps de jauger l’écriture, les œuvres et les événements en fonction de leurs répercussions plutôt que de leur composante spectaculaire, souvent assimilable à de la publicité ou à un orgasme vite fait.
Éloge de l’imprévu
Véritable vigneron de l’âme, le poète conjugue patience et fulgurance, sachant construire une juste densité de l’attente. Cette préparation attentive du terrain, Hélène Dorion s’y adonne avec générosité, dans un projet qui dépasse les limites de ses sentiers personnels. À l’écoute de ses mots comme de ceux des autres, elle tâche d’atteindre cette zone de contact où ils partagent l’émergence d’un regard neuf, ouvert largement sur l’avenir. « Je crois à l’inspiration. Mais il y a différents types de travaildans l’écriture : avant et après. L’inspiration est aussi une forme d’accomplissement, d’arrivée d’un travail. Marcher, écouter de la musique, visiter une galerie, un spectacle, toutes des choses qui peuvent faire que l’inspiration, sorte d’écoute, peut être possible. Ensuite, c’est vraiment cela, une écoute. Sentir ce que veut un texte, où ça veut aller. »
Reste à apprendre à entendre à notre tour cette écoute du poète qui remonte aux gestes picturaux du paléolithique. Ce qui ne peut être qu’une interprétation des héritages de sources diverses dont chaque pensée, chaque geste sont issus, que le poème y soit en acte ou dans une de ses nombreuses et nécessaires latences.
1. Titre de sections de Sans bord, sans bout du monde.
2. Titre emprunté à un recueil d’Yves Roy, paru aux Herbes rouges en 1992.
3. Les murs de la grotte, p. 84.
4. Claude Gauvreau, « Lettre à un fantôme », La Barre du jour, no 17, juillet-août 1969, p. 344-362.
Hélène Dorion a publié :
L’intervalle prolongé / La chute requise, Le noroît, 1983 ; Hors champ, Le noroît, 1985 ; Les retouches de l’intime, Le noroît, 1987 ; Les corridors du temps, Écrits des Forges, 1988 et 1991 ; La vie, ses fragiles passages (épuisé), Le dé bleu, 1990 ; Un visage appuyé contre le monde, Le dé bleu / Le noroît, 1990, 1991, 1993 et 1997 ; Le vent, le désordre, l’oubli, L’horizon vertical, 1991 ; Les états du relief, Le dé bleu / Le noroît, 1991 et 1993 ; L’issue, la résonance du désordre, Prix de la Société des écrivains canadiens et Prix du Festival international de poésie de Roumanie, L’arbre à paroles, 1993 et Le noroît, 1994 ; Sans bord, sans bout du monde, Prix Alain-Grandbois de l’Académie des lettres du Québec, La différence, 1995 ; Les murs de la grotte, La différence, 1998.