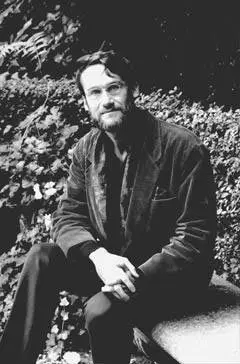Un magnifique coucher de soleil glisse lentement derrière la ligne d’horizon. Les quelques îlots de neige durcie qui persistent encore par endroits, en cette fin mars, confèrent au paysage en bordure de l’autoroute 20 un air d’irréalité et je ne peux m’empêcher de penser qu’il doit en être ainsi dans la Sibérie natale d’Andreï Makine à qui Le testament français aura valu, coup sur coup à l’automne 1995, le Prix Médicis (avec Vassilis Alexakis) et le Prix Goncourt, prodiguant, là aussi, un éclairage étincelant sur la nouvelle gloire du paysage littéraire. Andreï Makine a consenti à livrer ici quelques réflexions sur son aventure d’écrivain.
Andreï Makine est né en Sibérie en 1957, en ce temps où le monde avait encore des repères spatio-temporels bien définis : d’un côté, il y avait le bloc de l’Est ; de l’autre, celui de l’Ouest. Entre les deux, une vaste incompréhension garantissait aux forces en présence l’immunité dans leurs propres rangs. Jusqu’à ce qu’une fissure apparaisse, et ce qu’on croyait jusque-là immuable s’avéra au contraire poreux, friable. L’écroulement de la baliverna allait se renouveler. Du jour au lendemain, des milliers de vies s’en trouvèrent transformées, sans pour autant qu’on pût mesurer l’étendue, l’importance des changements qui s’amorçaient.
Bartavelles et ortolans
Le testament français, c’est avant tout l’extraordinaire récit de la vie d’une femme, Charlotte Lemonnier, témoin incomparable du siècle qui s’achève. Véritable héroïne des grands romans russes, Charlotte Lemonnier traverse le siècle en tentant d’opérer l’impossible réconciliation entre l’Est, dont elle ne parviendra jamais à s’arracher, et l’Ouest, qu’elle léguera pour ainsi dire à son petit-fils par le biais de souvenirs sans cesse remodelés par le jeu fascinant de la mémoire et par le pouvoir d’évocation des mots ; bartavelles et ortolans truffés rôtis, de simples sonorités d’une langue étrangère échappées d’un menu, deviennent pour le narrateur non seulement sa langue grand-maternelle, mais un espace imaginaire à découvrir, un univers à conquérir. L’immense pouvoir conféré à la langue relève ici d’une formidable entreprise d’appropriation du réel. Au sujet de ce parcours, Andreï Makine, dont on sait qu’il a largement puisé dans ses propres souvenirs pour écrire Le testament français, n’hésitera pas à parler de détachement, de mort incontournable afin de mieux retrouver cette vie qui sourd entre chaque ligne de son roman, et d’être ainsi à même de lui conférer son véritable rôle dans l’univers du roman : un matériau stylistique.
Écrivain discret, réservé, la renommée subite ne semble nullement affecter Andreï Makine, si ce n’est qu’elle lui facilite maintenant certaines démarches officielles (l’obtention d’un passeport français après huit années de résidence en France, par exemple). Se considère-t-il comme un écrivain russe écrivant en français ou comme un écrivain français d’origine russe ? Andreï Makine se montre plutôt perplexe lorsqu’il est question de son identité, non qu’il renie ses origines, mais seul compte pour lui le fait qu’il soit écrivain, qu’il ait décidé de consacrer sa vie à l’écriture. La question même de la langue lui paraît jusqu’à un certain point secondaire, accessoire. À ses yeux, la langue ne représente pas vraiment le prisme qui modèle et module notre vision du monde, notre façon d’être et d’agir. « Seule la poésie, la poétique, prendra-t-il soin de préciser, joue véritablement ce rôle. À la rigueur, j’aurais même pu écrire mes romans en russe. Cela aurait bien sûr donné des œuvres différentes, mais pas tant à cause de la langue que de la force poétique qui se serait manifestée autrement. »
L’importance du style pour Andreï Makine est corrélative d’une autre nécessité pour l’écrivain : créer un univers poétique. Tout le reste est secondaire à ses yeux, prétexte. Son écriture n’a rien de minimaliste. Au contraire, elle entraîne le lecteur dans un mouvement qui s’amplifie et qui reproduit la vastitude, l’intensité des grands espaces que requièrent ses personnages pour donner leur véritable mesure. Lui-même issu d’un milieu où le message conditionnait la forme, Andreï Makine s’évertue aujourd’hui à inverser les forces en présence, à rappeler la préséance de la forme, l’importance du style.
Les confessions d’un écrivain déçu
Le parcours d’Andreï Makine relève presque de l’image mythifiée que l’on se fait souvent d’un écrivain. Ses premières expériences dans le monde de l’édition sont à ce titre des plus révélatrices. Ainsi se présente-t-il un beau jour chez un éditeur avec un manuscrit sous le bras, « pour éviter les coûts de la poste », précisera-t-il avec un large sourire. Lui qui espère toujours remettre en mains propres son manuscrit au directeur littéraire s’en retourne le plus souvent sans même l’avoir entrevu, avec pour seule promesse de réponse le sourire discret d’une réceptionniste. Cela m’a rappelé Jack Kerouac qu’on avait littéralement fait poireauter une journée durant dans l’antichambre de son éditeur parisien parce qu’il ressemblait davantage à ses personnages qu’à l’écrivain reconnu qu’il était devenu. Cliché que tout cela, bien entendu, mais les clichés sont aussi coriaces, sinon plus, que tous les symboles qui modèlent la vie d’un peuple.
Andreï Makine accumulera ainsi les refus avant de recourir au subterfuge que l’on sait : dès lors qu’il affuble ses manuscrits d’une traduction fictive, voilà qu’ils suscitent l’intérêt. Le roman d’un jeune écrivain russe francophile écrivant en français se présente tout à coup sous les traits d’un roman russe traduit en français par Albert Lemonnier (ah ! les charmes inexpliqués de l’exotisme ). Mais les premiers romans se vendent mal et le subterfuge ne suffit pas à lui seul à assurer la publication des œuvres qui suivent. « Je demeurais toutefois convaincu que mon écriture finirait par être reconnue, par s’imposer par sa seule force. Aux éditeurs qui hésitaient jusque-là à me publier, je répétais qu’ils avaient tort de ne pas me soutenir, que d’ici deux ou trois ans je serais un écrivain reconnu. J’ai même proposé à certains de ne pas me verser de droits d’auteur : il ne leur en coûterait ainsi que le prix du papier si le livre se vendait mal » On connaît aujourd’hui la suite.
De ses débuts dans le monde littéraire parisien, Andreï Makine ne garde toutefois aucune aigreur. Tout au plus déplore-t-il la légèreté et l’inconsistance des rapports de lecture de certains éditeurs (Le testament français a même été refusé sous prétexte que le roman n’avait pas véritablement d’intrigue ni de personnage principal !), le fait qu’on accorde davantage d’importance à la personnalité de l’auteur qu’à la qualité de son manuscrit. Mais, ces reproches faits, il s’empresse aussitôt de saluer le courage et l’excellence du travail de certains autres éditeurs qui n’hésitent pas à prendre des risques, à proposer autre chose que la facilité même s’ils savent qu’ils ne pourront le plus souvent espérer vendre plus de quelques centaines de copies du roman d’un jeune auteur même talentueux. « La littérature, poursuit-il, ploie sous la facilité, le goût du jour. N’importe qui peut écrire un roman en quelques mois, mais cela donne des livres qui croulent sous les procédés, les recettes, des livres où les fils pendent de partout. La littérature ressemble de plus en plus à une forêt envahie de promeneurs insouciants qui laissent davantage de traces de leur passage que les marques d’une œuvre véritable. »
Peu de livres répondent à de véritables exigences littéraires, selon Andreï Makine. Aux écrivains qui cherchent à transmettre des messages qu’il qualifie de ponctuels, il préfère ceux qui entraînent le lecteur dans la cadence et la fougue de leur prose. Aussi, ne s’étonnera-t-on pas qu’il affectionne davantage des écrivains pour qui le style compte plus que tout : Proust, Nerval, Le Clézio, Gracq, Alain-Fournier, et Bounine, cet écrivain russe exilé en France qui s’est mérité le Prix Nobel de littérature en 1933 et à qui il a consacré une thèse de doctorat.
Pour Andreï Makine, le style, et uniquement le style, définit véritablement le travail d’un écrivain. Par dépit, ou pour mieux illustrer l’importance qu’il accorde à son propos, il avoue même aimer les films dans lesquels joue Arnold Schwarzenegger « pour la pureté du style, pour l’honnêteté de la caricature, pour cette poétique du biceps qui s’étale à la grandeur de l’écran. De la même façon a-t-on pu maintes fois se moquer du style pro-révolutionnaire communiste, qui ne versait pas non plus dans les nuances, mais au moins il y avait un respect de la forme, un style. » Ou, pour reprendre ses propres termes, « une pénétrante harmonie du visible » qu’il poursuit d’un livre à l’autre.
Andreï Makine a publié, entre autres :
Confession d’un porte-drapeau déchu, traduit du russe par Albert Lemonnier, Belfond, 1992 ; La fille d’un héros de l’Union soviétique, traduit du russe par Françoise Bour, Robert Laffont, 1990 et 1995 ; Au temps du fleuve Amour, du Félin, 1994 ; Le testament français, Prix Médicis 1995 et Prix Goncourt 1995, Mercure de France, 1995.