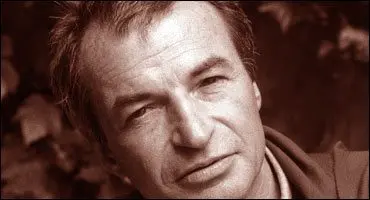Certains livres renferment en eux des mondes qui ne vous quitteront plus, des mondes qui, paradoxalement, vous demeureront à jamais étrangers. Ces livres exigent davantage que le temps consacré à leur lecture, font du lecteur plus qu’un lecteur. Méroé, roman d’Olivier Rolin, appartient à ces livres qui échappent à toute mode, à tout courant littéraire, qui s’imposent par la seule force de leur écriture. Et qui nous rappellent, si besoin est, que la littérature demeure l’une des plus fortes expressions de la liberté, l’objet le plus articulé de sa quête.
Méoré, c’est l’histoire d’une obsession amoureuse, d’un homme dont la vie vole en éclats dès lors que l’être aimé se soustrait à sa vue, à sa vie, et qui ne cherche plus qu’à reconstituer les parcelles de son existence passée pour pouvoir enfin s’en libérer. Le narrateur, dont on ignorera le nom jusqu’à la fin du roman, évolue dans sa propre histoire comme un fantôme au milieu des décombres de ce qu’il faut bien appeler une vie, la sienne. « L’amour, disais-je à Harald ce jour où j’allais faire la connaissance du doktor Vollender, est comme la terreur : une puissance énorme dans le voisinage de laquelle on passe toute sa vie, même si on a le malheur de n’avoir jamais été vraiment amoureux, ni terrifié1. »
Au moment où s’amorce le roman, le narrateur s’est réfugié dans un hôtel de Khartoum où il attend que la police vienne l’y chercher pour des raisons qui ne nous seront connues qu’à la fin du roman. C’est de sa chambre qu’il entreprend le récit des événements qui l’ont conduit en ce lieu, davantage pour tenter d’y comprendre quelque chose que simplement pour relater une histoire. Mais qu’y a-t-il à comprendre à l’amour ? Comment traduire avec des mots ce qui justement vous échappe ? « Dire qu’on a aimé un livre plus que tous les autres, c’est de la foutaise. Parce que, c’est pareil, il n’y a pas UN livre, mais une puissance orageuse des lettres qui vous plante de temps en temps son éclair dans la couenne, et c’est tel ou tel livre, mais tout ce qu’on peut dire après c’est que ça vous a collé une foutue décharge, qu’il y a là une force qui vous la coupe, qui vous dépasse infiniment. Et qui a cette propriété bizarre, comme l’amour, etc., de vous désintégrer mais aussi, et contradictoirement, de vous concentrer, quelques très courts instants, en un point d’intelligence et de sensibilité absolues que vous n’atteindriez jamais sans cela2. »
Avec pour seul interlocuteur un échassier posé sur le rebord de la fenêtre de sa chambre d’hôtel, le narrateur fouille sa mémoire, tel un prédateur déchiquetant sa proie. « J’ai sûrement moi aussi, enfoui en moi, un texte indéchiffrable, une fresque obscure et martelée, défigurée comme mes souvenirs3. » Pour reconstituer le souvenir de l’être aimé, le narrateur n’a plus à sa portée que les mots, dont l’étendue et la limite équilibrent le pouvoir qu’on veut bien leur conférer. Le narrateur en mesure en effet l’immense pouvoir et l’implacable réalité qu’ils lui renvoient : « Je ne me souviens pas du corps d’Alfa. Je parle de ses cheveux et je n’en sais plus rien, que des choses mortes, des noms de couleurs, des qualités abstraites. Je ne connais plus cette beauté qui fut la bascule, le sommet et la guillotine de ma vie, autrement que celle de la reine Nefertiti. Si on écrit autour du souvenir d’une femme, c’est justement qu’il n’est plus rien, ombre chinoise, lettres mortes, notre centre vide4. »
L’obsession amoureuse illustre ici l’étendue de la défaite du narrateur à se réapproprier la part de lui-même que lui a ravi l’amour d’une femme. Si les mots s’avèrent impuissants à combler le vide, ils se révèlent d’une redoutable efficacité à en tracer les contours. Cette obsession de la défaite, qui amènera le narrateur à se demander s’il n’a pas lui-même amené Alfa à le quitter, trouve dans le roman des échos dans le récit des épisodes du siège de Khartoum au XIXe siècle, lorsque le général anglais Gordon attendit en vain l’arrivée des secours qui lui auraient permis de sauver et la ville et sa tête, et de l’acharnement d’un archéologue allemand à mettre au jour les vestiges d’une civilisation aujourd’hui disparue. Dans un cas comme dans l’autre, les personnages sont confrontés à une image d’eux-mêmes qui les renvoie à leur propre folie, qui les pousse inexorablement à accélérer le processus qui entraînera leur fin. La poursuite insensée du projet qui anime chacun des protagonistes ne trouve en effet de résolution que dans l’anéantissement, la défaite. Que ce soit en cherchant à nier l’absence de l’être aimé, ou à reconstituer facticement sa présence, comme tente de le faire le narrateur, que ce soit dans la folle entreprise de préserver un monde voué à l’écroulement, comme s’efforce de le faire courageusement le général Gordon, ou à en tirer un autre de l’oubli tel que s’y consacre le doktor Vollender, l’issue est chaque fois la même : la défaite. Sans doute est-ce l’aspect du roman qui s’avère le plus troublant, cette fatalité qui marque implacablement le destin de chacun des protagonistes. Et qui semble inscrite dans le paysage même.La signature des domaines de l’enfance.
Dans les romans d’Olivier Rollin, les repères spatio-temporels sont non seulement bien définis, les personnages évoluent dans une trame romanesque minutieusement développée, pourtant ils vous échappent, comme le sable du désert dès lors que le vent se lève. L’idée du désert serait-elle plus forte, plus étendue que sa réalité même ? En écrivant Méroé, Olivier Rollin a ainsi eu cette intuition, à savoir que « les lieux des années d’apprentissage devaient émettre, à travers toute l’œuvre d’un écrivain (et bien au-delà de leur image explicite), quelque chose de comparable à ce qu’on nomme je crois, en astrophysique, un – rayonnement fossile – » : une sorte de signature de l’origine. Et c’est à la recherche de cette signature qu’il se consacre dans Paysages originels, un ouvrage paru à la fin de 1999. Olivier Rollin, le temps d’une série de six articles qui paraîtront dans Le Monde au cours de l’été 1999, nous entraîne dans l’univers romanesque de cinq écrivains, Hemingway, Nabokov, Borges, Michaux et Kawabata, qu’il nous convie à revisiter, en y accordant cette fois une attention particulière pour retracer le rayonnement fossile qui émane de chacune de ces œuvres.
De sa ville natale, Oak Park, Hemingway ne gardera que le souvenir propret d’une localité sans histoire, voire sans âme. Il résumera ainsi sa vision du lieu qui l’a vu naître et qu’il s’efforcera plus tard d’oublier : les pelouses y étaient larges et les esprits étroits. C’est davantage du côté des paysages lacustres du Michigan que nous entraîne Olivier Rollin pour reconstituer l’imaginaire du jeune Hemingway. À la relecture des récits de pêche à la truite, Olivier Rollin souligne la charge érotique qui s’en dégage et donne à l’œuvre sa véritable portée. À titre d’exemple, la récurrence des aiguilles de pin dans certaines nouvelles, et leur valeur symbolique, serait chaque fois le signe précurseur de l’amour, les aiguilles évoquant les cheveux coupés des jeunes filles et illustrant ici la confusion des sexes. « Si l’on considère qu’Hemingway est un écrivain, écrit Olivier Rollin, c’est-à-dire pas un type qui écrit à la va-comme-je-te-pousse, il faut donc s’intéresser à ces aiguilles de pin comme on s’est intéressé aux truites. Et on constatera vite qu’elles sont toujours, très systématiquement, les émissaires des grandes heures de la vie, et spécialement de l’amour5. »
Des lieux nabokoviens, Olivier Rollin écrit qu’ils « sont inextricablement réels et fantaisistes, reflets d’une réalité sans cesse déformée, remaniée par les puissantes gravitations de l’imaginaire, de la mémoire, du désir, du jeu6 ». D’un univers dont il avait sans doute anticipé la fin, Nabokov en retiendra l’importance du détail qui seul délimite la frontière entre la réminiscence et l’oubli. L’œuvre de Nabokov repose sur cet acharnement à soustraire de l’oubli ce qui a été, ce qui hier fut réalité pour le jeune homme ayant dû quitter un pays dont il savait qu’il serait à jamais le tombeau de sa propre enfance. Le rôle dévolu à l’écriture, rappelle Olivier Rollin, en sera dès lors profondément marqué : « Ce qui compte dans l’écriture, c’est la précision, la tyrannie du détail7. »
« Sans d’abord me le proposer, écrit Borges dans l’Éloge de l’ombre, j’ai consacré ma déjà longue vie aux lettres […], à la pratique mystérieuse de Buenos Aires et aux perplexités qui non sans quelque présomption se donnent le nom de métaphysique. » Dans les pages consacrées à Borges, Olivier Rollin tente d’élucider ce que revêt la pratique mystérieuse de Buenos Aires et les pistes qu’il propose sont tout aussi intéressantes que dans les cas précédents. À la dualité linguistique de Borges (de culture anglaise par sa mère, et dont le père jouera un rôle majeur dans sa formation, et ce, bien qu’il ait vécu la quasi-totalité de son existence avec sa mère), Olivier Rollin oppose une seconde dualité, également omniprésente dans l’œuvre de Borges : l’espace dans lequel se déroulent les contes. « Dans une large mesure, écrit-il, l’opposition entre la maison et le quartier recoupe celle entre l’anglais, langue de la culture la plus raffinée, et l’espagnol, âpre parler des conquistadors et des voyous. […] Il est presque incroyable de voir la place qu’occupent dans son œuvre qui passe pour éminemment – intellectuelle – les récits de duels à l’arme blanche, d’étripages, d’égorgements8. » La maison paternelle était certes un lieu protégé, souligne Olivier Rollin, mais cette dernière n’était pas pour autant entièrement soustraite à ce qui se déroulait à l’extérieur de son enceinte. Tout au plus jouait-elle son rôle de frontière entre deux mondes, celui de la rue et l’autre, celui de la mère et de la bibliothèque paternelle qui deviendra d’ailleurs l’un des lieux mythiques par excellence de l’œuvre. L’œuvre entière de Borges évoque le passage d’un état de conscience à un autre, d’un lieu à un autre. « Il y a chez Borges, écrit Olivier Rollin, une thématique de la limite, du passage de la plaine (ou de la forêt) à la ville, c’est-à-dire aussi de la sauvagerie à la civilisation, ou l’inverse…9 » Jamais nous ne saurons avec certitude ce que revêtait pour Borges la pratique mystérieuse de Buenos Aires, mais la lecture qu’en fait Olivier Rollin redéploie un horizon de lecture des plus stimulants.
Bien sûr, les paysages originels qui ont marqué les années de formation des cinq écrivains dont il est ici question ne peuvent à eux seuls expliquer leur parcours et, ultimement, leur œuvre. Mais telle n’était pas l’intention d’Olivier Rollin. Il ne cherchait pas à établir une corrélation entre le thème d’une œuvre et le lieu qui l’a vu naître, à voir, par exemple, dans les observations d’ethnographie chimérique que l’on retrouve chez Michaux une volonté manifeste d’échapper au plat pays, à ces « paysages pour abolir les cris, paysages comme on se tire un drap sur la tête ». D’établir, chez Kawabata, la correspondance entre l’omniprésence de la mort dans l’enfance de l’écrivain et l’inclination morbide dans l’œuvre. L’intention est ici tout autre, plus littéraire que socio-psychanalytique. « Les enfers intimes des écrivains, rappelle Olivier Rollin, n’appellent pas de rationalisation, mais une compréhension plus modeste, une intelligence diffuse et qui progresse comme par capillarité10. »
Voilà qui nous ramène à Hemingway, aux aiguilles de pin et à l’importance des paysages où vaque et joue la mémoire. Aucune œuvre ne peut être comparée à une autre, rappelle Olivier Rollin, aucune ne peut être réduite à la seule lecture que nous en faisons. « La littérature, écrit-il, est une pensée, la plus vaste qui soit, puisqu’il lui arrive même d’être pensée de ce qu’elle ne prétend pas penser11. » Les paysages dont il est ici question appartiennent davantage à ces espaces sentimentaux qui disputent aux vrais paysages leur prétention d’être les seuls à être réels. « Aucune œuvre digne de ce nom ne se laisse enfermer dans un déterminisme de terroir. […] On n’écrit pas parce qu’on est d’ici ou de là, on écrit parce qu’on est – né troué –12. »
1. Méroé, par Olivier Rolin, « Fiction & Cie », Seuil, Paris, 1998, p. 18.
2. Ibidem, p. 24-25.
3. Ibidem, p. 233.
4. Ibidem, p. 42.
5. Paysages originels, « Fiction & Cie », Seuil, Paris, 1999, p. 28.
6. Ibidem, p. 48.
7. Ibidem, p. 52.
8. Ibidem, p. 68, 69.
9. Ibidem, p. 74.
10. Ibidem, p. 110.
11. Ibidem, p. 86.
12. Ibidem, p. 150.