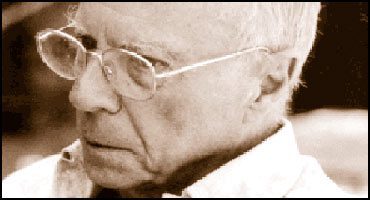Mireille Calle-Gruber a rencontré Claude Simon, en 1997, alors que paraissait son plus récent roman, Le Jardin des plantes. À partir de ce livre, ils ont fait un retour sur l’oeuvre riche et variée de l’écrivain, Prix Nobel de littérature 1985.
Nuit blanche : Ce qu’un lecteur qui entre dans Le Jardin des plantes1 peut se demander tout d’abord, c’est : à quel « genre » d’ouvrage a-t-on affaire ? Certes, on comprend vite qu’il ne s’agit pas de l’autobiographie monocorde et « personnelle » à laquelle le canon littéraire nous a habitués. Cependant, en couverture, il y a la mention « roman » comme pour les autres livres. Et la belle formule de « portrait d’une mémoire », en quatrième, reste un peu mystérieuse. Quels rapports – ou quels refus – l’écriture du Jardin des plantes marque-t-elle vis-à-vis des formes répertoriées ?
Claude Simon : « Portrait d’une mémoire » ne me paraît pas tellement mystérieux. Cette formulation qui m’est venue à l’esprit indique bien, me semble-t-il, qu’il s’agit d’un tableau et non d’une chronique. Il y a dans tout portrait (du moins dans la peinture occidentale) des lumières et des ombres, des parties éclairées et d’autres non. De même qu’une peinture, Le Jardin des plantes ne « raconte » pas. Ce qui importe, ce n’est pas la chose « représentée » ou « racontée », mais la façon dont elle l’est. Toute œuvre d’art ne « témoigne » qu’au second degré.
D’autre part : « Qu’est-ce qu’un roman ? » s’interrogeait Maupassant (si je ne me trompe dans la préface de Pierre et Jean) en énumérant le Quichotte, La princesse de Clèves, Les liaisons dangereuses, Le père Goriot, Les misérables, etc À quoi on pourrait ajouter aujourd’hui L’idiot, Le château, Ulysse, Les jeunes filles en fleurs, Voyage au bout de la nuit, etc., etc. Connaîtrais-tu la réponse ?
Il me semble qu’avec Le Jardin des plantes tu as dépouillé, comme jamais auparavant, le récit de certain élément de la littérature romanesque. N’est-ce pas, notamment, l’absence de personnage fictionnel, ce liant littéraire par excellence, qui se matérialise dans les blancs du texte, et qui souligne ainsi l’incontournable différence que fait l’écriture ?
C. S. : Je ne sais que répondre. Dans mes autres livres aussi, avec ou sans blancs, l’écriture fait la différence.
Ce travail de montage qui caractérise ton œuvre se trouve exhaussé dans Le Jardin des plantes du fait de la composition parcellaire. Quels effets t’importent le plus dans ce dispositif : l’interruption ? la surprise ? la mise à plat ? la mise en regard de ce qui n’a, semble-t-il, rien à « voir » ? l’enjambement ?
C. S. : Tu réponds en partie toi-même : interruptions, surprises, mises en regard, enjambements et toutes autres façons de travailler au livre et à sa composition.
D’autre part, ne pas oublier cette parole de Barthes (je cite de mémoire) : « le propre de la littérature est d’apporter des questions ; jamais, en définitive, de réponses. » Si je satisfaisais à toutes tes interrogations j’irais au rebours. Règle (me semble-t-il) : suggérer mais ne jamais expliciter. D’où mon laconisme.
Les questions, c’est notre lot. « Nous sommes tous de lopins », écrit Montaigne dont tu places la citation en exergue. Nous sommes tous, aussi, cela me frappe dans ton livre, différés : en différé et pas « en direct ». Est-ce qu’écrire est voué à cela : courir après nos retards, nos incompréhensions.
C. S. : Oui, en un sens. Mais aussi autre chose : faire.
Est-ce que, par ce faire, ce n’est pas l’assemblage plus que le témoignage qui fait la vérité du récit ?
C. S. : Assemblage plutôt. Entrelacement de thèmes dans un présent écrit. Encore une fois: témoignage au second degré.
Le second degré relève en majeure partie du montage. Et le montage qui organise Le Jardin des plantes paraît d’une extraordinaire complexité. As-tu eu recours, comme pour La route des Flandres, à un plan avec repères de couleurs ?
C. S. : Pas de plan de montage avec repères de couleurs : bandes de carton sur lesquelles étaient écrits ou résumés (comme pour La route des Flandres) le contenu d’une ou plusieurs pages et qui pouvaient être changées de place, leurs extrémités coulissant entre deux fentes parallèles pratiquées dans une autre feuille de carton.
Est-ce que les changements de place des fragments ont entraîné l’écriture de passages nouveaux, ou est-ce que tout était écrit d’abord, composé ensuite ?
C. S. : Tout cela à la fois.
Cette infinité de possibilités dans les déplacements et la mise ensemble, c’est ce que signale l’exergue au chapitre II : « On a recensé 367 démonstrations différentes du théorème de Pythagore » ?
C. S. : 367 démonstrations différentes du théorème de Pythagore = autant de relations possibles d’un même événement
L’événement, dans Le Jardin des plantes, est souvent lié à la peur. La peur aussi a une infinité de nuances. Est-ce le motif du livre ? Et d’abord l’expérience du cavalier, certain d’aller sur la « route des Flandres » à la mort ? Écrire la peur, écrire avec la peur c’est donner à voir le monde avec le regard du survivant ?
C. S. : La peur n’est pas le « motif » du livre. C’est un de ses éléments. J’ai essayé de décrire la peur. Je n’ai pas écrit avec la peur.
Pourquoi lui substituer le mot de « mélancolie » ? Parce que c’est écrire en connaissance de perte ?
C. S. : Ce n’est pas une substitution. « Mélancolie » est le sentiment éprouvé (du moins celui que j’ai éprouvé) lorsqu’on pense qu’on va mourir d’un instant à l’autre et à ce qu’on va perdre.
La mort – la vie c’est : « maintenant » ? C’est « Ora zero » comme titre une toile de Gastone Novelli ?
C. S. : Peut-être.
Est-ce que c’est de « mélancolie » que te vient la capacité de colère, l’énergie qui constitue l’inépuisable vitalité de ta narration ?
C. S. : Ce que tu appelles « l’inépuisable vitalité » de ma narration est simplement l’envie (le terme « besoin » est trop dramatique) d’écrire, de faire.
À propos de faire : décrivant la géométrie du Jardin des plantes, tu notes que « l’homme s’est appliqué là à domestiquer, asservir la nature, contrariant son exubérance », ce que tu compares aux règles du théâtre classique qui « enferment le langage dans une forme elle aussi artificielle ». Est-ce que c’est ta conception du travail d’écriture : un montage rigoureusement calculé ?
C. S. : Non, ce n’est pas ma conception de l’écriture. Quant au montage, il est naturellement réfléchi. Mais c’est encore au lecteur (ou au critique) de dire s’il l’est « rigoureusement ».
« Dans une langue que nous savons, nous savons substituer à l’opacité des sons la transparence des idées. Mais dans une langue que nous ne savons pas » Ce passage de Proust que tu cites ne cesse de faire écho dans Le Jardin des plantes. Est-ce à dire que le travail de l’écrivain est de nous restituer ce que nous n’entendons pas, ce que nous ne savons pas dans « la langue que nous savons » ?
C. S. : L’incipit du livre est : « m’efforçant dans mon mauvais anglais » Il pourrait être aussi : « m’efforçant dans mon mauvais français »
Oui, le premier mot de l’incipit est « m’efforçan », cependant que le dernier mot du livre a un sens presque contraire : « S’en abstenir ». Entre ces deux mouvements opposés se tend tout l’arc du livre ?
C. S. : Dans l’arc du livre il y a toute la corde.
La formule est belle ; elle fait mieux comprendre peut-être les mots que tu cites de Kirilov au sujet de la feuille d’arbre qui, « vue » les yeux fermés, est plus réelle que la réalité de l’hiver. Et sa réponse à Stavroguine : « Ce n’est pas une allégorie. C’est une feuille, tout simplement. » Est-ce une mise en garde contre la naïveté qui consisterait à ne croire qu’à une réalité pragmatique ? et ne ferait pas jouer toutes les tensions de la corde ?
C. S. : Rimbaud à sa mère (qui l’interroge sur le « sens » de je ne sais plus lequel de ses écrits) : « Cela veut dire ce que ça dit, littéralement et dans tous les sens ».
Cela nous reconduit aux questions d’interprétation. En fait, pour la première fois, tu fais jouer dans le roman le registre de la critique littéraire, notamment par le biais d’une mise en scène d’entretien avec un journaliste. Tu reportes aussi, sans commentaire, un fragment du colloque de Cerisy sur le « Nouveau Roman » et cette scène d’excommunication fait par elle-même un effet dérisoire aujourd’hui ; effet souligné par le montage car c’est un paysage urbain de Suède – on ne peut s’empêcher de penser aujourd’hui : la Suède du Prix Nobel – qui suit. Que penses-tu, à présent, de cette époque « Nouveau Roman » ?
C. S. : Ce que je pense de l’époque du « Nouveau Roman » ? L’extrait d’une discussion du colloque de Cerisy que je reproduis intégralement illustre on ne peut mieux, me semble-t-il, certain aspect de ce « mouvement ». Par ailleurs, je me suis trouvé à Göteborg plusieurs années avant de recevoir le Nobel. Ce n’est donc pas « la Suède du Prix Nobel », mais la description de cette ville qui m’a paru convenir à cet endroit.
Par le biais du journaliste, le narrateur prend ironiquement le contre-pied de la distinction auteur-personnage qui fut un des grands principes du « Nouveau Roman ». « Stendhal caracolant gaiement sous les boulets de Waterloo. Il m’a dit Pas Stendhal : Fabrice. J’ai dit Mais si Mais Si Fabrice suivait lui dans les fourgons de l’intendance vous pensez bien que Stendhal n’a pas manqué cette occasion de montrer son courage. » Tu veux bien préciser la question que tu soulèves ainsi ?
C. S. : En dépit de rapports évidents, le narrateur n’est pas l’auteur (moi) hors du livre. Comment pourrait-il l’être puisqu’il l’écrit ?
Il le met aussi en scène : je veux parler de la dernière partie du Jardin des plantes et de l’écriture du découpage plan par plan pour l’adaptation cinématographique du livre que nous venons de lire. La sélection, d’abord, m’intrigue. Notamment, la place que prennent des scènes très secondaires du zapping télévisuel. Pourquoi ? Est-ce que le choix des images du petit écran de la vie ordinaire est une façon de ne pas monumentaliser la mémoire ? de la garder vive en en faisant une séquence du temps au présent ?
C. S. : Pour moi les scènes du zapping télévisuel ne sont pas « très secondaires ». Aucun événement, que ce soit un bombardement, un match de tennis, une chevauchée, le récital d’un « crooner », un personnage qui « longtemps se couche de bonne heure », une rafale de mitraillette, etc., n’est secondaire. Mais c’est là, bien sûr, une façon de voir les choses absolument subjective.
Subjective aussi la façon dont l’image à l’écran est décrite comme une toile de peintre : plages de couleur, notations de lumière et de « valeurs ». Faut-il lire à la lettre l’expression « porter à l’écran », c’est-à-dire y voir la conception d’un récit jouant avec les effets d’écran qui lui sont constitutifs ? Visibilité, cadre, cache, découverte, recouverte ?
C. S. : Oui : prendre et lire à la lettre l’expression « porter à l’écran ».
Il y a aussi, pour moi, l’énigme du personnage de la « femme-éléphant » : anonyme, infirme à béquilles, désignée comme la voisine du premier, cette figure très épisodique est tout de même celle qui a le mot de la fin ! Qui est-ce ? Que représente-t-elle ? La marche (du temps) ? La vie (encore) ? La mort (en cours) ? Un retour d’opacité, puisqu’elle obstrue la vue et finit par faire écran ? C’est la feuille d’arbre de Kirilov ?
C. S. : Tout l’intérêt d’une énigme, c’est de le rester. Toutefois, à titre indicatif, on peut remarquer que lorsqu’on entend le bruit de la balle frappée par la raquette du joueur de tennis, la forme noire de la femme-éléphant vient au même moment obstruer tout l’écran.
Voilà de quoi nous remettre au travail d’interprétation ! Écriture et montage de séquences d’images paraissent si proches pour toi, et relever si aisément des mêmes impératifs esthétiques : as-tu eu, ou as-tu le projet de porter à l’écran un de tes livres ?
C. S. : J’ai écrit, il y a environ trente ans, un scénario tiré de La route des Flandres. Aucun producteur ne s’y est intéressé, sauf un qui se proposait récemment de faire le film pour la télévision avec un budget de deux millions (il en faudrait au minimum cinquante – et encore ).
Pour revenir au titre « Le Jardin des plantes », cela évoque aussi son autre nom de « jardin d’acclimatation » c’est-à-dire le lieu des transplantations, changements de climats, voisinages, adaptations. Cela dit bien sûr, on ne peut mieux, les mouvements qui travaillent ton livre. Mais est-ce que cela ne désigne pas, en fait, le principe même d’une œuvre d’écrivain en ce qu’elle est le terrain de cette expérience vitale : transformations et adaptation sans fin ?
C. S. : Je ne sais pas ce que tu suggères par « l’adaptation sans fin ». J’ai déjà eu l’occasion de dire (et de redire) que je considère le roman comme un art, au même titre que la peinture ou la musique. D’où les mêmes lois de composition. Par exemple : associations, contrastes, harmonies, oppositions, répétitions, échos, rappels, ruptures, accélérations, ralentissements, fortissimo, pianissimo, assonances, dissonances, clair-obscur, à plats, etc., etc., etc., etc.
1. Le Jardin des plantes, Minuit, 1997.
Claude Simon a publié :
Le tricheur, Sagittaire, 1946 ; La corde raide, Sagittaire, 1947 ; Gulliver, Calmann-Lévy, 1952 ; Le sacre du printemps, Calmann-Lévy, 1954 ; Le vent, tentative de restitution d’un retable baroque, Minuit, 1957 ; L’herbe, Minuit, 1958 ; La route des Flandres, Minuit, 1960 ; Le palace, Minuit, 1962 ; Femmes, Sur vingt-trois peintures de Joan Miró, Maegh, 1966 ; Histoire, Minuit, 1967 ; La bataille de Pharsale, Minuit, 1969 ; Orion aveugle, Skira, 1970 ; Les corps conducteurs, Minuit, 1971 ;Triptyque, Minuit, 1973 ; Leçon de choses, Minuit, 1975 ; Les Géorgiques, Minuit, 1981 ; La chevelure de Bérénice, Minuit, 1984 ; Le discours de Stockholm, Minuit, 1986 ; Album d’un amateur, Rommerskirchen Verlag, 1988 ; L’invitation, Minuit, 1988 ; L’acacia, Minuit, 1989 ; Photographies, Maeght, 1992 ; Le Jardin des plantes, Minuit, 1997.