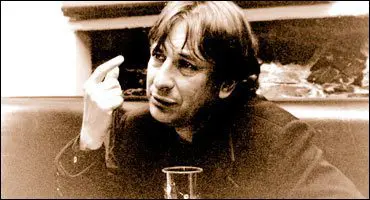Jean Rouaud a signé à ce jour quatre romans1 qui lui ont valu un éloge unanime de la critique. Détenteur d’un diplôme de lettres et ex-vendeur de journaux, le romancier sait aujourd’hui exactement où il va. L’écrivain est sûr de lui et l’homme, d’une sympathique simplicité.
Notre conversation, sur fond de brouhaha d’un café animé, s’est naturellement amorcée sur les circonstances particulières de sa participation au Goncourt en 19912.
Nuit blanche : Est-ce que vous étiez nerveux ?
Jean Rouaud : Non, je ne savais pas que mon livre était en lice. C’est Hervé Bazin qui avait demandé à Minuit d’envoyer Les champs d’honneur pour le Goncourt. Après, il était inquiet de la suite, parce qu’il avait mis toute son influence dans la balance et qu’il y avait la crainte toujours présente de l’auteur couronné pour un premier livre, qui ne donne plus rien Je me souviens de l’avoir vu au Salon du livre de Montpellier, j’étais allé le saluer ; le second livre allait paraître à la rentrée, et je le lui dis. Il était assez réservé et j’ai bien vu qu’il était totalement paniqué à l’idée que je puisse le décevoir. Et quand Des hommes illustres est paru, il a écrit un article dans Le Figaro pour dire que si je ne l’avais pas déjà eu il me donnait le Goncourt.
Valoriser la forme
Mais Bazin n’était-il pas un peu sous-estimé par ce que l’on peut appeler le milieu littéraire français ?
J. R. : Je ne crois pas que Bazin soit un écrivain majeur, ce n’est pas Proust. Mais c’est juste après. Il fait partie de ces écrivains solides qui ont une œuvre dense avec laquelle ils ont quand même balayé toute une partie de leur temps, et qui trouveront une place bien plus haute que celle qu’on leur a donnée de leur vivant. J’en suis persuadé. Simplement, depuis la Deuxième Guerre, on a vécu avec l’idée que la forme, c’était du sens. C’est-à-dire qu’on a tellement privilégié la forme, que ceux qui continuaient à raconter des histoires, on les prenait pour des demeurés. L’après-guerre, c’est quand même la défaite de la France, l’Occupation, c’est la collaboration, c’est la découverte des camps, et c’est l’épuration, qui ne s’est pas passée d’une manière très élégante. Donc les gens du nouveau roman se sont dit, comme Adorno en fait, qu’on ne pouvait plus faire de poésie après Auschwitz. L’humanisme, dont le roman est un avatar, ayant abouti à Auschwitz, du coup, on ne pouvait pas continuer à écrire des romans comme si rien ne s’était passé. On ne pouvait plus se raconter d’histoires. On se contentait d’un état des lieux. Qu’est-ce qui reste alors ? La mise en forme, le travail, non pas sur la beauté de la langue, mais une espèce de mise en garde contre le plaisir du texte, contre les beautés de la langue, contre son pouvoir de séduction. Au lieu de choyer la forme, on la brisait, on la mettait en morceaux. Et ceux qui comme Bazin ont continué malgré tout à raconter des histoires, comme si effectivement rien ne s’était passé, ceux qui n’avaient pas observé cette période de deuil, ont été méprisés. Ça n’a jamais été formulé comme ça, mais le fond de l’affaire c’est ça, j’en suis persuadé.
Vous êtes publié chez Minuit, la maison associée au nouveau roman. Est-ce que c’est circonstanciel ou vous identifiez-vous aux écrivains qui publient chez Minuit aujourd’hui ?
J. R. : Pour moi, ce qui était important, c’était d’être publié dans une maison d’édition à haute valeur littéraire ajoutée. Être publié pour être publié, ça ne m’intéressait pas. Je voulais la reconnaissance d’abord, par un éditeur. C’est l’éditeur qui, dans un premier temps, par la couverture du livre, place ce livre dans une certaine catégorie. Il se trouve que c’est surtout valable en France où il y a un distinguo entre les couvertures où vous avez un dessin, une photo, qui donnent tout de suite l’impression d’avoir affaire à un livre plus romanesque, au sens littéral, et puis de l’autre côté, les couvertures uniques, toujours sur le même type, chez Gallimard, au Seuil ou chez Minuit, et qui placent ces livres-là dans la catégorie littéraire.
Sans renoncer à raconter des histoires
Les champs d’honneur sont publiés en 1990. Est-ce que c’était le premier roman que vous écriviez ?
J. R. : Non. Il y avait eu un long travail avant cette mise au point. Et puis, pour en revenir à ce que je disais tout à l’heure, le roman (disons style Bazin) était un genre méprisé quand je faisais mes études littéraires. Quand vous êtes jeunes, vous vous identifiez aux gens qui font l’époque, pas à ceux qu’on balaye d’un revers de la main. Et les gens qui faisaient l’époque, c’étaient Foucault, Derrida, Lacan, Barthes. Les grandes figures de l’époque étaient tous des penseurs et pas des romanciers. C’était une nouveauté quand même, parce qu’avant la guerre les grandes figures c’étaient Malraux, Sartre, Céline, qui étaient tous des romanciers. Gide aussi était romancier. Donc pour la première fois sans doute depuis bien longtemps, les romanciers étaient considérés comme des sous-littérateurs. Et moi, arrivant dans ces années-là, je n’ai pensé que très tardivement à écrire des romans. C’est seulement à la fin des années 70 que je me suis dit que si je voulais publier, il fallait écrire des romans. Et j’étais pas fait pour ça, j’étais pas doué. Faire des phrases, j’ai toujours su, mais écrire un roman voulait dire apprendre à raconter des histoires, apprendre à planter un décor, à faire que des personnages s’incarnent, qu’on les sente bien, ça voulait dire être au monde et j’avais beaucoup de mal à y arriver. J’ai passé cinq ans sur un long roman d’apprentissage du roman. Je l’ai d’abord donné au Seuil. C’était volumineux, il faisait huit cents pages. Le Seuil m’a demandé de le réduire, une première fois, une deuxième fois, puis au final on n’en a pas voulu. Après, le livre a circulé un peu, il est arrivé chez Denoël qui l’a accepté, mais du coup c’est moi qui ne voulais plus parce qu’il avait tous les tics, tous les défauts d’un premier roman.
Par la suite, j’ai écrit un tout petit texte qui s’appelait Préhistoire que j’ai envoyé chez Minuit. Et cet éditeur, qui a quand même le plus beau catalogue de la littérature française de la seconde moitié du siècle, m’a convoqué pour me dire qu’il ne prenait pas mon livre, mais que j’étais écrivain. Alors il a pointé dans le texte tout le maniérisme. Parce que, quand vous voulez être édité, vous cherchez à vous distinguer, donc vous avez tendance à en faire plus. C’est un péché de jeunesse, le maniérisme, c’est juste un moyen de se faire remarquer. Donc il m’a pointé ça. Et quand je suis sorti de son bureau, j’avais ma première vraie reconnaissance. À partir de là, je me suis mis à écrire ce qui allait devenir Les champs d’honneur. Je savais ce que j’allais faire, et surtout qu’il n’y aurait plus jamais dans mes textes d’éléments extérieurs au roman. Et donc je me suis dit (à une époque où le roman était souvent porteur de sa propre théorie) : je vais juste raconter des histoires, rien d’autre. Mais qu’on les sente bien. Et que si je parle de la pluie, qu’effectivement, on la sente bien tomber.
Et on la sent bien tomber.
Vous racontez des histoires, mais en même temps, et ce n’est pas qu’on sente vraiment un travail sur la forme, car tout semble couler de source, il n’y a pas un détail de trop, pas une boucle qui ne soit bouclée : la forme est donc très choyée.
Travaillez-vous avec un plan très précis ?
J. R. : Non. Au petit bonheur la chance. C’est-à-dire que j’ai une vague trame, que je sais à peu près par où ça va passer. Pour Le monde à peu près, je voulais raconter les années de collège, mais pas selon le récit traditionnel. Je voulais une scène qui synthétise l’esprit de ces années-là. Et puis, en opposition à ce monde clos du collège, le monde ouvert de la faculté et qui correspondait en plus avec l’ouverture des mSurs du temps, l’ouverture de la pensée. Donc, comme point de départ, ces deux milieux-là : fermé et ouvert, et je voulais faire un livre sur le désespoir. Alors, j’ai songé à la fois où j’ai pensé que je ne pouvais pas descendre plus bas, quand je me suis retrouvé sur un terrain de foot à 20 ans. Je me disais : « Mais c’est pas possible que j’en sois là ». Je suis donc parti de cette scène. Après, je sais pas trop comment ça va se goupiller, mais les choses s’organisent toutes seules. Vous savez, il faut absolument faire confiance à son inconscient. De lui-même, il va mettre en relation les éléments, de lui-même, il va vous apporter toute une thématique, que vous voyez apparaître sans que vous l’ayez consciemment voulue. Donc les choses se mettent en place et mon but, c’est qu’à chaque phrase, il se passe quelque chose. Je ne veux pas m’ennuyer en écrivant. J’ai toujours le plaisir de la découverte, de l’invention, parfois ça s’écarte du fil rouge, parfois il y a des petites gymnastiques pour retrouver le fil du récit. Mais maintenant je ne m’embête même plus avec ça. J’enchâsse carrément entre deux tirets ; je peux enchâsser un élément complètement exogène et puis que la phrase reprenne vingt lignes plus loin, sans même ces précautions que l’on trouve d’habitude : « disais-je », « donc », « nous en étions ». Non, non.
Moi, ça m’amuse beaucoup.
J. R. : Hein, c’est marrant ça ! Bon on l’enlève, c’est-à-dire que le lecteur, il fait comme moi, il revient au début de la phrase et puis il repasse après par-dessus. Ça donne une lecture moins linéaire et puis, bon, ça marche. J’ai reçu quand même quelques lettres me disant : « Faites moins d’incises. » Mais c’est comme ça, et ça permet de ramener tellement d’éléments, les incises. C’est formidable.
Justement cette première partie du Monde à peu près, pleine d’incises, où le narrateur décrit longuement sa technique, son style un peu solitaire pour cause de myopie, m’a donné l’impression que c’était peut-être une métaphore de votre façon de travailler.
J. R. : Exactement. Et ça été voulu comme ça. Quand vous êtes jeune et que vous passez votre temps à dribbler sans passer la balle, on vous dit tout de suite que vous êtes personnel. Et moi ce que je voyais dans cette image du dribble, qui mène à rien souvent, c’était simplement le plaisir de la phrase. C’est-à-dire que ce plaisir du type qui dribble ne participe pas au résultat de l’équipe, mais son bonheur immédiat est là, exactement comme pour l’écrivain : le bonheur immédiat de la phrase qui fait des tours, qui prend son temps, qui revient en arrière.
Et qui se dit : si on pouvait garder le ballon…
J. R. : Voilà. En fait, la morale de l’histoire c’est que, quand vous êtes écrivain, vous gardez le ballon jusqu’au bout. Il y a ainsi un art poétique, qui court dans tout le livre. Il y a donc la phrase, avec le dribble ; il y a le passage de la myopie, où je fais allusion au fait qu’on a beaucoup parlé de l’art du détail à mon propos Et puis il y a un autre passage, la scène de la copie corrigée : c’est pour l’éditeur, qui veut toujours intervenir.
Un narrateur très discret
Il y a une chose aussi qui me frappe dans vos romans, c’est ce narrateur qui parle à la deuxième personne.
J. R. : Qui s’adresse au lecteur.
Oui, qui s’adresse au lecteur, mais toujours pour raconter les choses les plus intimes, les plus fortes. Par exemple dans Des hommes illustres, la scène où le père meurt.
J. R. : Oui. Ce que j’ai fait de plus beau, formellement, c’est ce chapitre-là. L’enjeu était grave pour moi. J’avais, avec Les champs d’honneur, mis beaucoup de gens dans la confidence. Donc ceux-là, qui avaient fait un bout de chemin avec moi, je voulais tous les amener, mais comme le joueur de flûte de Hamelin. Je ne voulais pas aller me noyer seul dans la rivière. Donc, avec cette musique de la phrase, je les conviais tous. Effectivement, quand le père meurt, quand on est devant la mort, on a envie que toute l’humanité se noie dans la rivière. Avec la mort d’un homme, c’est la mort de toute l’humanité. L’avantage du vous c’est qu’il est à la fois multiple, pluriel, et qu’il s’adresse aussi à celui-là qui lit : c’est vous que je choisis.
J’ai immédiatement pensé à Michel Butor, à La modification, qui n’était pas aussi prenant pour le lecteur.
J. R. : Non, puis ça faisait très formaliste, puisque le procédé était tenu de bout en bout du livre. Au lieu que là, c’était de jouer sans arrêt. Je m’amuse à le faire aussi en parlant. Par exemple là, on va se parler en se disant vous, puis à un moment lever les épaules et puis : « tu parles que tu crois » Vous voyez ? soudain, ce truc, cette petite expression qui va introduire une intimité. Puis on revient au vous protocolaire. Mais là, c’est pointé pour dire : ça se passe bien. Je fais ça aussi dans les textes, quand ça se passe bien avec le lecteur Tu m’étonnes.
De la madeleine à Vanité de Duluoz
Est-ce que vous vous reconnaissez des influences littéraires ?
J. R. : Je sais ce que j’ai cherché à imiter. Je viens de cette histoire de la littérature française telle qu’elle a été enseignée en France, c’est-à-dire quelque chose de très lourd, de très rigide et surtout d’empesé. Et donc pour retrouver une liberté d’esprit, je me suis inspiré de Henry Miller dans un premier temps et de Kérouac après ; mais vraiment, quand je les ai découverts, je les ai lus avec avidité et avec émerveillement. Je rêverais d’écrire The Subterraneans par exemple. Je suis trop raide pour écrire The Subterraneans, mais j’aurais aimé écrire des trucs parfaitement libres. J’ai pris plein de choses à Kérouac. Par exemple, le foot. Dans Vanité de Duluoz, son dernier livre, il parle du football américain ; à un moment, il dit qu’il récupère le ballon, qu’il va marquer un but formidable et puis il fait une incise, il dit – en parlant de ses copains qui jouent avec lui – : « si machin et machin sont pas d’accord, de toute façon pour l’instant c’est moi qui ai la plume ». C’est ce genre de liberté qu’on trouve dans les textes de Kérouac. Par moments, il est sérieux, il se lance dans une grande formule d’analyse philosophique, et puis ça se termine par : « et bla, bla, bla, et bla, bla, bla » Il se rend compte du ridicule, et au lieu de refaire son texte, il nous le laisse ; c’est-à-dire qu’il a cette honnêteté de nous laisser le texte en l’état et de dire, bon, là je me suis gouré, mais c’est pas grave, on continue. Ç’a été une leçon formidable, Kérouac, je connais vraiment bien son œuvre.
Et puis j’ai une vraie tendresse pour Stendhal et pour Chateaubriand quand même.
Et Proust ?
J. R. : Ce que j’ai appris chez Proust, c’était qu’il fallait jamais lâcher le morceau. Tant qu’il y avait à ronger sur l’os. C’est-à-dire que Proust va aller jusqu’au bout, et n’hésitera pas à refaire encore une proposition, une subordonnée quelconque, circonstancielle, pour approfondir encore un peu plus la question. Quand il lâche le morceau, il y a même plus l’os. Et c’est chez Proust que j’ai appris ça : il faut aller jusqu’au bout, il faut se perdre jusqu’au bout.
J’ai cru voir des clins d’œil à Proust dans Les champs d’honneur.
J. R. : Ah oui, l’histoire de la madeleine.
Mais il y avait déjà le goût du fromage rapporté par le grand-père, qui m’a fait penser à la madeleine avant qu’elle n’arrive dans le récit…
J. R. : Proust dit, dans Contre Sainte-Beuve, que ce n’est pas l’intelligence qui permet de partir à la recherche du temps passé. Ce qu’on a tous observé. Vous marchez dans la rue et puis, soudain, une odeur comme ça et vous vous retrouvez quinze ans en arrière. Proust a théorisé cette idée que c’est par les sensations qu’on retrouve et non pas par la mémoire. Mais vous avez déjà ça dans Chateaubriand ! Chateaubriand est ambassadeur à Londres, il entend la grive dans le jardin, et tout de suite il se retrouve à Combourg. Et chez Rousseau aussi : il cueille une petite pervenche, il herborise, il est âgé, il devait être à Ermenonville, je crois, et puis la pervenche le ramène aux Charmettes et à madame de Warens. Enfin, c’est quelque chose qui avait déjà été utilisé. Et Proust en a fait un procédé. Donc après, il faut le récupérer, mais pas innocemment ; d’abord en étant bienveillant avec celui qui vous a fourni le procédé, et c’est bien le moins que de mettre sa signature dans un coin !
Les lapins du chapeau
Est-ce que vous travaillez de façon très disciplinée, à heures fixes par exemple ?
J. R. : Pratiquement tout le temps ! Je n’ai pas de jour de congé, je suis tout le temps corvéable quand je suis à la maison. La journée type : je me lève à huit heures, j’accompagne ma fille à l’école, je reviens avec Libération, je lis le journal et je me mets au travail. J’ai une pièce avec mon portable sur un bureau, et un petit lit à une place, et je passe mon temps entre le lit et le portable. Le lit, c’est pour me permettre de décanter, pour que d’autres choses surviennent. Je pense à tout et à rien. Pas forcément au texte en cours. Après un moment, je me lève, je me remets à l’ordinateur et ça repart. Je ne connais pas l’angoisse de la page blanche, c’est quelque chose qui m’est complètement étranger. Ce qui est extraordinaire, c’est ce qu’il y a à dire. Il y a toujours des choses à dire mais vous ne savez pas encore vraiment quoi, vous êtes le premier spectateur de ce qui sort. Cela dit je suis dans une période comme je n’en ai jamais connu, où j’écris plein de trucs, c’est comme les lapins du chapeau. Je sais aussi que c’est une période qui va peut-être durer cinq ou dix ans maximum, et qu’après ce sera la pioche. Si on se revoit dans cinq ans je vous dirai peut-être : chaque fois que j’ouvre l’ordinateur, c’est l’horreur, je ne sais pas quoi mettre. Mais je n’ai jamais connu ça. Tout simplement parce que j’ai un projet littéraire, mon projet romanesque qui court sur encore cinq ou six livres.
Est-ce qu’on peut en avoir un avant-goût ?
J. R. : Mon prochain livre va s’appeler Travailler c’est trop dur. C’est sur l’univers des petits boulots, ce fourvoiement de toute une génération qui a sacrifié, au nom d’une éthique de vie, ses années futures. Parce qu’il y a un moment où vous êtes rattrapé par le temps, et ça se passe assez difficilement. Après il y aura un livre sur la période où j’ai tenu un kiosque à journaux, et un autre livre sur le Goncourt. À ce moment-là, pour en revenir à Proust, la boucle sera bouclée. C’est-à-dire que la scène primitive, chez Proust, c’est le baiser de la mère à l’enfant, vers 10 ans. Pour moi, la scène primitive, c’est à 11 ans. C’est important l’âge parce que dix-onze ans, c’est la vraie prise de conscience. Chez Proust, donc, la scène primitive c’est le baiser de la mère et le narrateur se demande tout le temps comment il va faire pour retrouver ça. Quand, à la fin du livre, il se propose d’écrire, on sait qu’il va écrire le livre qu’on vient de lire. Et pour moi, la scène primitive, à 11 ans, c’est la mort du père, le lendemain de Noël ; et ce qui s’est passé pour pouvoir un jour en arriver à écrire cet événement en l’exorcisant. C’est-à-dire en gros Les champs d’honneur. Donc, mon projet s’inscrit entre la mort du père et le récit de la mort du père. Tout autour il y a des textes annexes aussi. J’ai une pièce qui va être jouée l’année prochaine. À Paris.
On peut savoir le titre ?
J. R. : Les très riches heures. Et après je vais écrire une pièce sur ma mère, qui est morte au mois de juin3 . Elle était très critique, comme toutes les mères évidemment, vous trouvez jamais grâce à leurs yeux Je lui aurais ramené trois Prix Nobel que ça aurait été : « Mon pauvre garçon ! » Dans la pièce, elle sera morte, et elle fera une critique des Champs d’honneur. Parce qu’elle disait toujours : « Mais ça s’est pas passé comme ça ! mais pourquoi il a raconté ça ? » Elle fera donc une espèce de monologue, puisqu’elle ne pourra pas communiquer avec les autres personnages qui, eux, seront vivants. Il y aura un discours, et elle interviendra pour démonter le mécanisme de la création tout en le renouvelant. Enfin il y a vraiment de quoi s’amuser encore pendant longtemps.
Comment vous situez-vous par rapport au caractère autobiographique de vos romans ?
J. R. : Vous connaissez la succession d’autoportraits de Rembrandt ? Quand Rembrandt se déguise, qu’il se met un turban invraisemblable, on sait bien qu’il se baladait pas comme ça. Alors voilà, l’élément romanesque, c’est le déguisement, mais le portrait c’est bien le mien. Il y a une construction qui fait que ce sont des romans, il y a des éléments parfaitement autobiographiques, comme la mort de mon père. Au total, ça compose vraiment une série d’autoportraits.
1. Les champs d’honneur, Minuit, Paris, 1990 ; Des hommes illustres, Minuit, Paris, 1993 ; Le monde à peu près, Minuit, Paris, 1996 ; Pour vos cadeaux, Minuit, Paris, 1998.
2. Voir dans Nuit blanche, no 64, l’entrevue de Jean-Pierre Tusseau avec Hervé Bazin.
3. Le projet de pièce est entre temps devenu le dernier roman paru : Pour vos cadeaux.