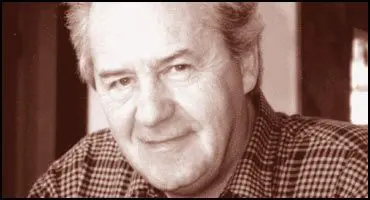Il est aisé, si l’on n’a lu que Le vierge incendié (1948), de confondre l’art de Paul-Marie Lapointe avec le militantisme esthétique d’avant la Révolution tranquille qui s’est trouvé en convergence avec lui, notamment pour ce qui est du célèbre manifeste Refus global publié la même année.
Si l’on se penche plus longuement sur cette personnalité discrète et qu’on étudie en profondeur son œuvre multiforme, la difficulté de saisir l’ensemble du phénomène apparaît. On se trouve alors entraîné dans une recherche sur la nature même de la poésie, résistante à la définition d’autant plus qu’elle est toujours l’aventure singulière d’un poète.
Rejet farouche
C’est une colère sacrée (ou une sacrée colère, à votre guise) qui donne naissance aux premiers poèmes d’un jeune homme de dix-huit ans confronté à une atmosphère culturelle étouffante pour les créateurs. Colère traduite en mots qui ne peut se comparer dans notre littérature qu’à l’œuvre de Claude Gauvreau, à l’origine d’ailleurs de la première publication de Paul-Marie Lapointe et déterminé comme lui à saborder les bienséances et l’hypocrisie de la fin des années 40. « Pour un adolescent qui s’interrogeait sur la nature de la vie, son avenir, remarque Paul-Marie Lapointe, c’était une période assez noire. J’avais un besoin fondamental de m’interroger sur cette société-là et de voir comment on pouvait devenir un homme dans ce contexte. Pour moi la poésie, Le vierge incendié, a été une façon de m’interroger sur la manière d’être libre dans ou hors de cet univers-là. » Cette façon ne fut rien de moins qu’un retour au chaos générateur d’où est issue cette centaine de textes qui ont fait l’effet d’une bombe à retardement des années plus tard, alors qu’une autre génération se découvrait des parentés avec ce courage solitaire. Éclatement syntaxique aux frontières de l’intelligible, esthétique flirtant volontiers avec le terrorisme verbal, contamination de la prose, cette attaque libératrice peut encore aujourd’hui se lire comme un catéchisme de l’esprit libre, une incantation faisant table rase et permettant tous les départs, au prix d’un risque maximal. Car une invective et une déconstruction de cet ordre contiennent toujours une part de promesses proportionnelle au chambardement qu’elles effectuent.
On comparera à juste titre l’incursion de ce jeune fauteur de troubles dans le paysage culturel avec celle en France d’Arthur Rimbaud, pour la fulgurance et la suspension totale des certitudes qu’ils inspirent. Au moment où l’on décide de le publier, Paul-Marie Lapointe récrira en une semaine le recueil auquel il avait consacré presque une année. Il donne un rythme et une forme définitifs à ce détonateur dont il charge l’inconscient québécois. Car celui que Gaston Miron considérait comme le plus grand de nos poètes travaille en amont de l’oralité, au point de surgissement de la force imaginaire. « Oui, c’est dans la nature même de la poésie que je souhaite et réussit parfois à faire d’établir ce genre d’ouverture à l’examen du monde et de soi-même qui appartient à toute époque, tout comme pour moi Rimbaud incite constamment à s’interroger, me nourrit constamment. Je souhaite que ma poésie puisse, que ce soit avec Le vierge incendié ou la Nuit du 15 au 26 novembre 1948, permettre à un lecteur de s’exercer à la liberté, à tout ce qui nous permet de nous situer dans le monde, ceci justement parce qu’elle n’est pas datée. Un vrai poème ne doit pas vieillir, d’ailleurs. » Il n’y a en effet pas plus d’obstacles – ni d’aisance – pour le lecteur d’aujourd’hui que pour celui d’hier à se remettre en question, entraîné dans le tumulte de ces premières œuvres, qui s’attaquent autant à la Grande qu’à de multiples « petites noirceurs ».
La part d’agressivité qui marque les débuts de Paul-Marie Lapointe dans l’écriture ne s’atténuera, pendant la pause de douze ans qui se termine par Choix de poèmes, qu’au profit d’un chant novateur, fait d’improvisation et d’audace mais qui ne se prive pas d’enlacer le monde dans son mouvement. Y subsiste l’esprit d’indépendance qui correspond bien à la formule d’Yves Bonnefoy pour qui « [é]crire la poésie, c’est vouloir se défaire de l’autorité des systèmes de représentation » ; autrement dit, ne se permettre l’écriture poétique qu’une fois purgées les tendances au durcissement imprimées par l’usage tant dans la langue que dans la culture. Ce qui explique en partie la note conflictuelle fréquemment présente dans le sillage de l’art. « L’exercice de la poésie, selon Paul-Marie Lapointe, en est un sur les mots, qui représentent le monde et traduisent la vraie réalité. C’est ici qu’il est intéressant de se questionner sur le rapport entre poésie et prose. Valéry disait que dans la prose les mots disparaissent, sont détruits à mesure que le sens se construit ; dans la poésie, chacun des mots est placé là pour lui-même et doit devenir l’élément le plus important de la lecture. Cela différencie le langage de la poésie d’un usage servile ou qui vise l’utilité. C’est un face à face avec le monde tel qu’il est à travers les mots qui l’expriment plutôt qu’une construction intellectuelle. C’est ce qui fait que la poésie est un art de création, comme la peinture et les autres arts. De plus, c’est un des seuls lieux où l’on peut exploiter la colère sans pour autant verser le sang, se remettre en question sans se détruire. »
Présence de la poésie
Que cinq décennies après Refus global, la poésie tout comme la philosophie connaissent une certaine remontée dans l’estime des jeunes générations, de même que des sursauts d’attention occasionnels dans les médias, n’étonne pas outre mesure Paul-Marie Lapointe. Conscient de la difficulté de mettre des mots sur un malaise contemporain aussi puissant que dissimulé par l’entrechoquement de tant de discours et d’images, il n’en manifeste pas moins certaines inquiétudes. Poète en temps de détresse, il connaît bien les ruses de la poésie qui arrive à détourner la névrose, à bâtir dans la parole des lieux de transformation potentielle. « Peut-être les gens sentent-ils le besoin d’aller plus loin dans leur réflexion sur le monde et vont se pencher sur l’étude ou l’exercice de l’écriture poétique pour essayer de trouver des motifs à l’univers dans lequel ils sont placés et qui ne les satisfait pas. Même chose pour la philosophie, qui est très près selon moi de la poésie, encore que le philosophe construise des machines se voulant des explications du monde tandis que le poète cherche avant tout à s’y situer. Lire les philosophes m’intéresse souvent plus que le roman ; lire un philosophe est pour moi aussi important que de lire Rimbaud ou un autre poète, car il s’y trouve une réflexion qui s’associe à la recherche d’autre chose que des contingences. »
Ironie sainte
Pourtant Paul-Marie Lapointe déroute lorsqu’il présente son plus récent projet, d’un ludisme inégalé, mais qu’encadrent toujours une rigueur, une épuration absolues. Il ne faut pas s’y tromper, puisque Le sacre est une œuvre synthèse où on reconnaît la dérive contrôlée, l’ironie présentes dans plusieurs textes précédents, et où il poursuit de plus belle l’exploitation du calligramme amorcée avec le massif écRiturEs : deux volumes où les mots s’en donnaient à cœur joie dans une véritable « extase matérielle ». Seulement, au moment où plusieurs poètes retournent vers le métaphysique pur, lui quitte l’attitude plus austère qu’il conserva en temps d’euphorie pour rivaliser d’invention avec les concepteurs publicitaires les plus passionnés de figures de style.
Le manuscrit qu’il pose sur la table constitue une entreprise de forage sémantique à l’intérieur du juron le plus pesant, le plus complet, sonore et chargé de connotations du vocabulaire québécois. Voulant en prendre le contre-pied, le poète, après une introduction qui tient de l’anthropologie linguistique, profite de son occurrence en langue mexicaine, tabarnacos, et déroule une série d’acrostiches, d’anagrammes, paragrammes et autres tropes au sein desquels le dit sacre se trouve sans cesse utilisé, concassé, remembré, etc. Faisant osciller le discours entre l’émerveillement, la colère et le reste de la palette du juron, Paul-Marie Lapointe construit en symétrie des cartes géographiques mexicaines que reflètent en négatif des constellations, les lettres du mot sacré faisant toujours office de points reliant les formes.
Ce jeu avec les attentes du lectorat et de la critique souligne bien la conception que le poète se fait de l’acte de lecture d’un texte : la lecture doit être déstabilisante, exiger qu’on s’y investisse, ne pas se réduire à la simple observation ou à une satisfaction facile. « Le poème est fait de ‘trous’ dans l’espace et exige la participation du lecteur. Beaucoup de gens aiment la poésie, mais beaucoup moins savent la lire, c’est-à-dire profiter du poème pour faire un exercice de création et de liberté. La lecture d’un poème est un peu le contraire de la télévision, devant laquelle on est complètement passif, tel un ‘récipient’, au lieu d’apprendre à fabriquer des images comme on le fait en situation de lecture. »
Poète dans la cité
Paul-Marie Lapointe ne s’enferme pas pour autant dans une tour d’ivoire que lui aurait construite la critique au fil des décennies. Il participe à l’occasion à des soirées poétiques, on l’a entendu au Festival de Trois-Rivières édition 97, puis, pour une seconde année, à Québec, aux événements Les Poètes de l’Amérique française, dont il a lancé la saison en octobre avec la lecture intégrale du long poème « Arbres » , moment d’une grande intensité. Mais, répétons-le, il s’agit avant tout du poète par excellence de la page lue en solitaire, dans le contact visuel et plastique avec le texte. Ne nous étonnons d’ailleurs pas de son goût pour les arts visuels : il a fait dans sa prime jeunesse de courtes études aux Beaux-Arts, et dans certains recueils textes et matériau pictural se répondent. « Ce fut pour moi une carrière avortée, la peinture. Je croyais y avoir du talent, ce n’était pas vraiment le cas. Côté écriture, le livre Tableaux de l’amoureuse fut inspiré par l’œuvre de Gisèle Verreault, ma femme. Ce sont des traductions poétiques de tableaux que j’aimais. Pour Bouche rouge nous avons travaillé différemment : nous nous sommes donné une thématique générale pour réaliser un livre d’artiste, soit l’histoire de la féminité et de l’image de la femme à travers les époques. Dans écRiturEs, les calligrammes et les jeux typographiques viennent d’un goût particulier pour l’imprimerie qui remonte aux temps où j’ai travaillé pour des journaux entre autres comme maquettiste. Ma poésie est d’ailleurs plus visuelle qu’orale, elle est conçue comme une application de traits noirs sur une feuille blanche d’abord, non comme substrat destiné à être lu. Je suis un peu mallarméen sur ce plan. »
Peu inquiet de l’avenir de la poésie au Québec, il constate la renaissance d’une écriture plus exigeante, de moins en moins tributaire de débats et de clichés qui ne peuvent que réduire ses manifestations à des biens de consommation plus ou moins durables. Il ne faut pas oublier en effet que sous une apparence de détachement le poète travaille la structure même de notre perception des choses, tâche ingrate car, disait Roland Giguère du poète, « on oublie trop à quelle profondeur il circule » et on prend satisfaction de la première excuse venue pour ne pas le lire. Infatigable spéléologue de toutes les strates du réel, Paul-Marie Lapointe n’a peut-être pas, quant à lui, fini d’accumuler les transformations assumées et rassemblées par sa signature, et, ne fût-ce qu’une fois par décennie, serons-nous menés au-delà de nous-mêmes par les déplacements qu’il fait subir au regard dans ses livres.
Paul-Marie Lapointe a publié, entre autres :
Le vierge incendié, Mithra-Mythe, 1948 ; Choix de poèmes / Arbres, l’Hexagone, 1960 ; Pour les âmes, l’Hexagone, 1964 et « Typo » , l’Hexagone, 1993 ; Le réel absolu, Poèmes 1948-1965, Prix David 1972 et Prix du Gouverneur général 1972, « Rétrospectives » , l’Hexagone, 1971 ; Tableaux de l’amoureuse / Une, Unique / Art égyptien / Voyage et autres poèmes, l’Hexagone, 1974 ; Bouche rouge, L’obsidienne, 1976 ; The terror of the snows, l’Hexagone, 1976 ; Arbres, Erta, 1978 ; Tombeau de René Crevel, L’obsidienne, 1979 ; écRiturEs, L’obsidienne, 1980 ; Le sacre, l’Hexagone, 1998.