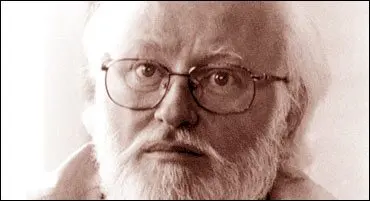Un des bonzes de la poésie actuelle, Werner Lambersy se situe au croisement du patrimoine et de la modernité. Partisan d’une nouvelle ritualisation de l’existence humaine, c’est méthodiquement qu’il transcende les méthodes et accueille la complexité du monde dans son langage.
Les amours de l’ordre et du désordre sont une source d’inspiration pour le poète comme pour le scientifique depuis des millénaires. Le chaos, lieu du possible et de la vie, peut-être même la dernière divinité qu’il nous reste, est cependant à (com)prendre avec des pincettes. Menaçant ou bien inaccessible à la subjectivité, c’est avant tout un aliment et un moteur incontournable pour l’artiste.
Ce caractère à la fois primordial et insuffisant du chaos peut être vu comme un des vecteurs qui orientent l’écriture de Werner Lambersy. Religieux sans religion, classique sans recette préétablie, ce poète se démarque des tics éditoriaux et traverse les structures sans se défaire de son essentielle barbarie.
C’est, il l’a bien compris, l’Éros qui fonde notre rapport au monde, dans l’intuition sauvage qui précède et permet l’application de toutes les méthodes : « Il est une chose, dit Werner Lambersy, dont j’espère que nous la connaîtrons tous, c’est l’amour, la rencontre entre deux êtres. Que cette chose se soit bien passée, pas passée ou mal passée, dès qu’on l’a connue cela devient vous-même et c’est ça qui donne source au poème et à notre rapport au monde. »
Parlant au rythme effréné d’une locomotive, l’homme en impose, à la manière d’un poète national. Mais c’est moins sa belgitude qui le propulse que son élan vers l’universel. Plus de trente ans de poésie derrière lui, et la même interrogation vibrante au sein d’une civilisation qui hésite toujours à embrasser la complexité du réel.
« Chaque homme a un devoir de catastrophe. Même en mathématique, il est désormais prouvé que dans chaque équation il y a ce qu’il faut pour la déséquilibrer, pour arriver à un autre type d’adéquation afin que la vie continue. Le côté enfantin de la poésie accomplit cela en profitant du don de l’émerveillement, don d’accoucher du monstre qu’est l’autre jamais épuisé. »
Pour un temps rituel
Avec les Jacques Crickillon, William Cliff et Madeleine Van Oudenhove, Werner Lambersy compte parmi ces poètes belges actuels aux noms bizarres qui prennent le mieux le relais de Michaux, et qui lui feraient peut-être regretter un peu le rejet de sa nationalité, s’il était toujours là. Mais qu’est-ce qu’être Belge, et poète de surcroît ?
Né à Anvers il y a une soixantaine d’années, l’homme est le fruit de nombreux virages abrupts où il a souvent risqué sa raison. Quelques constantes cependant : obsession pour le verbe poétique, volonté de redonner sa place au rituel, refus de la forme tout autant que de l’expression sans règles auto-imposées. C’est pourquoi l’équilibre numérique a une très grande place dans ses livres, où, jamais de la même façon, il propose des architectures rigoureuses qui nécessitent des centaines de brouillons dans lesquels il soupèse le parcours du lecteur à venir. Participant à toutes les étapes de la production, il va souvent jusqu’à choisir la typographie et collabore à la conception graphique de ses livres. « C’est un vrai travail, s’exclame-t-il. La poésie, c’est cinquante mille ans, plus un jour. »
Cette recherche radicale, Werner Lambersy l’a autrefois payée de sa propre raison, quand ses proches ont dû le faire interner lors d’une période de secousses délirantes. C’est par la poésie même qu’il a répliqué, en composant un livre troublant où il cerne le chaos d’une nouvelle façon. La première édition du Déplacement du fou (1982) se présente sous la forme de pages littéralement découpées en trois, dont les séquences peuvent être librement permutées pour donner lieu à des assemblages instables. Sur certains fragments, c’est un visage désarmé qui apparaît entre des persiennes, où se cristallise l’effort pour se délivrer intérieurement. Mais la lutte contre l’aliénation s’inscrit aussi dans une lutte pour une recrudescence du symbole : « Aussi désespéré soit le poème, vous écrivez toujours pour quelqu’un. Même si c’est pour l’insulter, un seul mot sur une page témoigne d’une confiance persistante en l’humanité. Toute cette tentative en est une de ritualisation, de situation dans le temps et l’espace. La ritualisation, c’est le fait d’échapper au temps linéaire pour installer un temps circulaire, afin de sauver la mise. À la question Quelle heure est-il, la poésie répond Il est midi. »
Ce renouveau de la fonction symbolique, par une transfiguration de l’expérience personnelle, Werner Lambersy l’effectue depuis le début des années 1970 dans des recueils qui s’apparentent à la cérémonie, où tout concourt à l’extase par le fait de scruter méticuleusement le quotidien. 33 scarifications rituelles de l’air, Maîtres et maisons de thé, Noces noires (magnifique suite composée à travers le prisme du deuil de sa mère), tous ces livres témoignent d’un questionnement par étapes, qui aboutit maintenant à la création d’une trilogie en prose sur l’impuissance de l’homme moderne à symboliser, à s’approprier son environnement par le langage.
La prose, il l’a déjà visitée à plusieurs reprises, encore qu’il affectionne le motif de la répétition : « Il n’y a pas de raison pour que l’on soit répétitif de façon monotone ! », se plaît-il à dire. « Mais bien que j’aie souvent écrit en prose, je ne crois pas qu’il s’agisse d’autre chose que de poésie. J’ai par exemple écrit une conversation avec un arbre, ce qui se situe assez loin du témoignage ! »
Le creuset du chaos
En 1999, à la suite d’une rencontre avec le peintre et poète Gabriel Lalonde, Werner Lambersy répond favorablement à une invitation des éditions Le Loup de Gouttière, de Québec, à publier un recueil ici, D’un bol comme image du monde. Livre qui est en fait le dernier maillon d’une longue chaîne de coéditions québécoises depuis une décennie, notamment au Noroît et aux Écrits des Forges. Le résultat est un court texte qui fournit un excellent condensé de l’esprit dans lequel Werner Lambersy use de la parole. À partir d’un simple objet, le chaos et la création sont mis en dialogue et des interrogations vitales s’enclenchent.
« J’ai voulu partir de l’anecdote, qui dissimule toujours davantage, en prenant comme objet un bol chinois retrouvé lors de fouilles. L’artiste qui l’a fait il y a huit cents ans l’avait vraisemblablement jeté, parce qu’il l’avait trop chauffé ou que les couleurs lui semblaient déséquilibrées. Pourtant, ce bol prétendument raté a su provoquer l’émerveillement chez moi. Je ne désespère donc pas de trouver dans les détritus du monde le plus beau poème qui soit. »
Alchimiste, le poète insiste pour être en prise sur son temps, avaler la réalité qu’il juge corrompue pour la recracher sous une forme plus productive. C’est pourquoi Werner Lambersy passe la majeure partie de son temps en voyage, se mettant au diapason des écrivains chinois, hindous, africains, chez qui la poésie semble moins figurer comme une incongruité sociale.
Le vide de sens, consécutif aux excès de pensée pure des totalitarismes, devient ainsi le matériau d’une épopée à venir. « Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il n’y a plus qu’un critère : l’argent. En architecture par exemple : je fais partie de la première génération qui n’a pas inventé de style, en abandonnant la fonction symbolique jusque dans la structure des immeubles. Mais c’est en train de changer, je crois. À chacun son épopée, mais nous avons la nôtre. Se trouver devant le vide de l’espace, c’en est une épopée ! Nous avons trop de mémoire individuelle et nous avons presque perdu la mémoire collective depuis Auschwitz. Pour que nous puissions inventer un réel, vivre dans l’espace où nous sommes, nous avons besoin de symboles, et pour cela de références. Revisiter les grands textes est une façon de restituer cette mémoire collective, pour éviter l’hémorragie du sens qui se révèle entre autres par l’omniprésence de la langue de bois. »
Jamais à court d’anecdotes ni d’hypothèses, Werner Lambersy est aussi vorace que généreux dans son appréhension des faits. Multipliant les observations, il tient à ce que sa poésie soit située puis qu’elle agisse sur sa situation, renouant ainsi avec les forces ancestrales soulevées par le conteur. Ses romans poétiques, qui s’annoncent volumineux, semblent s’apparenter à une artillerie lourde où le contemporain pourra puiser bien des remèdes. En attendant, Werner Lambersy suit les traces des Miron, Césaire et Aragon comme ambassadeur du poème en milieu public.
S’il peut être faussement confondu avec ces gourous verbeux ne recherchant que leur propre satisfaction dans une apparence d’altruisme, Werner Lambersy étonne à certains moments par la grande fragilité qui perce de son discours vigoureux et de sa stature de colosse : « Si nous vivons une fin de siècle où l’impuissance devient phénoménale, il reste qu’un petit homme de la rue comme moi peut encore se questionner. »
Werner Lambersy a publié entre autres :
33 scarifications rituelles de l’air, Henri Fagne, Bruxelles, 1976 ; Noces noires, La table noire, Cesson, 1987 ; Maîtres et maisons de thé, Labor, Bruxelles, 1988 ; Volti subito, Dé bleu/Les Écrits des Forges/L’arbre à paroles, Chaillé-sous-les-Ormeaux/Trois-Rivières/Amay, 1992 ; Architecture nuit, Phi/Les éperonniers/Le Noroît, Luxembourg/ Bruxelles/Montréal, 1992 ; Anvers ou Les anges pervers, Les éperonniers, Bruxelles, 1994 ; Journal d’un athée provisoire, Phi, Luxembourg, 1996 ; Chroniques d’un promeneur assis, Cadex, Montpellier, 1997 ; Pays simple, Cadex, Montpellier, 1998 ; D’un bol comme image du monde, Le Loup de Gouttière, Québec, 1999.
EXTRAITS
« Alors ceci,
puisque tu es un arbre
enraciné de mort.
[…]
« Pluie,
et la vitre
n’abrite plus que nous.
[…]
« Montagnes,
où la mer a laissé
des coquillages pour le retour. »
Le déplacement du fou (fragments)
« Qu’ils se retirent de moi »
dit le néant
« Des nouveau-nés
l’un fut le temps
qui coule
« Et l’autre
le bol de l’univers
qui jamais ne déborde
« Sauf peut-être
quand la mort les bouscule »
D’un bol comme image du monde, p. 10.
« C’était encore
la langue qui dit
et la langue qui est
« Puis il a vu
la main qu’on appelle
beauté
« Lâcher ce qui est fait
pour essayer
de toucher ce qui manque »
D’un bol comme image du monde, p. 35.
« Ainsi j’irai, me souvenant
du verbe et de l’âme dont il est dit a
ussi : le roi s’est éveillé, son sperme
est dans la reine comme
les étoiles dans la nuit, et l’armée
campe joyeuse dans son corps
comme un bonheur d’abeilles joue
dans lagéométrie lumineuse
des rayons du soleil »
Architecture nuit, p. 29.
« J’ai donné la vie
mais pas
sans donner la mort
« j’ai laissé l’éternité
à ce qui devait
mourir
« mais pas
sans renoncer d’abord
à soi
« j’ai promis l’aisance
au vieux
désir de disparaître »
Volti subito, p. 11.