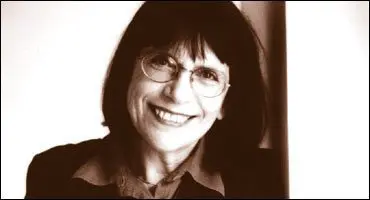Euphorisant, voilà comment nous pourrions qualifier le plus récent roman de Leslie Kaplan, Le psychanalyste, paru à l’automne 1999, et qui clôt une trilogie baptisée Depuis maintenant, publiée chez P.O.L. Ce roman très remarqué, et remarquable, entraîne son lecteur dans le mouvement de la pensée et de la vie de personnages qui visitent Simon Scop, un psychanalyste fin lecteur de Freud et de Kafka. Résultat ? On accède à la jubilation, celle que procure la circulation de la parole, une ouverture qui nous permet de croire que vivre en état de liberté est encore possible. Vivifiant.
De l’usine à l’écriture
Si Leslie Kaplan est née à New York, c’est à Paris qu’elle vit, et c’est en français qu’elle écrit. Bien que ses romans soient publiés depuis 1982 (L’excès-l’usine), son uvre demeure trop peu connue (ici du moins) même si son roman Le pont de Brooklyn est édité en format de poche, preuve d’un certain succès en librairie. L’écriture dépouillée de ce roman rappelle très très légèrement celle de Marguerite Duras, avec qui elle discutera d’ailleurs d’un thème qui lui est cher : l’usine1. Le mot traverse l’uvre et la vie de Leslie Kaplan, puisqu’elle y a travaillé en 1968. Cette expérience de la réalité, elle en témoigne dans tous ses livres, à commencer par L’excès-l’usine, livre de vies presque mortes, qui s’usent à la chaîne. Un livre qui s’ouvre toujours sur les mêmes lieux : des coins d’usine, des pièces en morceaux, des murs, le café où on fait la pause avant de reprendre le travail. Un lieu pauvre parce que vide de désir. Un grand vide de vie, voilà ce que le livre fait voir. Il n’y a rien d’autre que « la grande usine univers ». Et au-dessus de l’usine, le ciel, comme un espace impossible à habiter.
Miss Nobody Knows
La trilogie Depuis maintenant s’amorce avec Miss Nobody Knows. L’oncle de Marie vient de se suicider, laissant cette note derrière lui : « J’ai menti toute ma vie. » Pourtant, même si nous sommes en mai 1969, peut-être à cause de ce suicide, le roman parle de mai 68. Comment expliquer l’importance de cette période ? « Quand je pense à cette époque, j’ai l’impression que c’est un moment où l’on voit tout, où l’on peut tout voir, dans tous les détails, parce qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les choses. Il y a un sens, mais il flotte, il plane, il existe sans être là. Ou peut-être il rebondit ailleurs, autrement, il peut se rejouer plus loin, être repris, recommenté par d’autres2. » Miss Nobody est une errante, sans domicile fixe. Elle écrit ce qu’elle voit dans un calepin, le plus souvent des questions. C’est une femme libre, qui arrive dans la vie de Marie par hasard et part sans dire où. On la retrouve brièvement dans Les prostituées philosophes, un roman où le jeune Thomas tente d’exister malgré son père. Il devra, pour y parvenir, recourir à la violence. Ce père qui empêche la vie, on le retrouve encore dans Le psychanalyste, surtout chez Eva qui, après avoir tué un homme, erre dans Paris avec pour seul secours un exemplaire de la Lettre au père de Kafka. Ces deux premiers volets de la trilogie sont un peu moins accessibles que Le psychanalyste, mais ils demeurent essentiels au déploiement du troisième tome parce qu’ils contiennent les motifs de l’écriture de Leslie Kaplan : comment devenir (ou demeurer) vivant à soi-même, ouvert au monde, à l’Autre, disponible au hasard ?
Leslie Kaplan anime aussi des ateliers d’écriture, souvent en banlieue de Paris, dans des lieux de réinsertion sociale. Elle ne prétend pas vouloir former des écrivains. Elle croit plutôt que la liberté de tout individu passe par l’expression ; elle insiste sur l’importance du travail de la pensée et conçoit ces ateliers comme un lieu où on réfléchit sur ce que l’on pense. Cette conviction est parfaitement mise en action dans Le psychanalyste. Comment a-t-elle pu rendre cette enivrante sensation de liberté dans son dernier roman ? Elle l’explique avec une générosité tout aussi perceptible que dans son écriture. « Je voulais à la fois tenir compte de ce qui est, donc de tout ce qui se présente, et de ce qui advient. C’est pourquoi la référence à Freud, et à ce qu’il appelle l’attention flottante, est tout à fait importante. En écrivant, il faut toujours se placer du point du vue de l’ouvert, du possible, du suspens, donc sans fermer. Du point de vue des personnages, c’est certainement une radiance qui me guide ; je me demande comment ils sont, mais aussi ce qu’il peut leur arriver. Il y a aussi la référence au hasard. Je crois que c’est ce qui est dynamisant dans le récit, et dans la vie. »
La lecture de ce roman réjouit, car nous y côtoyons des personnages qui, au départ, sont pris dans leur carcan (souvent familial) et qui réussissent, par la parole, à s’en extirper. Il ne s’agit pas de changer pour devenir un autre, mais d’aller vers ce que l’on est, fondamentalement. Dans ce sens, la psychanalyse offre une possibilité de transformation pour les hommes. Mais veut-on seulement connaître nos vérités ? « Tous les personnages de mon livre sont des héros parce qu’ils affrontent un conflit, qui est un conflit universel, et qui date. Il n’y a qu’à regarder la tragédie d’dipe. Les personnages de Sophocle sont pris par leur désir de vérité et leur passion pour l’ignorance. Parce qu’au fond, personne ne veut savoir. Et pourtant, si. Je crois que ça se situe là, entre les deux. Cette passion pour l’ignorance, elle est chez tout le monde. Dans l’uvre de Kafka, on voit très bien comment cette passion pour l’ignorance génère des conflits. On voit dans ses écrits, son Journal, comment au fond il était au milieu de ça, au maximum, très exemplairement. »
Hasard et liberté
Dans Le psychanalyste, la littérature n’est pas matière à discours ; elle offre la possibilité de comprendre ce que nous vivons. Prenons Eva. Elle lit intensément Kafka, et cette lecture, parce qu’elle l’accompagne et nourrit sa réflexion, devient presque échange, ce livre la sauvera. La littérature aide-t-elle à vivre ? « Oh oui, je crois. Elle peut aider à penser. Et penser est déjà essentiel pour vivre de façon vivante. « L’art est la vie vivante. » C’est une phrase de Dostoïevski que n’importe quel écrivain pourrait reprendre. Si j’ai pris Kafka pour Eva, c’est parce que je l’aime, parce qu’il parle de la malédiction. Et puis Kafka, tout le monde peut le lire en livre de poche. Il est accessible. Eva se raccroche à ça. La Lettre au père l’a aidée à s’ouvrir. Elle a un rapport à ce texte. Elle l’a traversé d’abord avec résistance, avec fureur. Son héros, pense-t-elle, est si lamentable par rapport à son père. Et je crois qu’ensuite elle comprend que le fait qu’il écrive la lettre, même s’il ne l’a pas envoyée, l’a fait se déplacer. Je crois que c’est une chose que tout le monde peut comprendre. Il y a là un espace de liberté. »
Un autre aspect stimulant et qui contribue sans aucun doute à cette sensation de liberté tient à la présence archi-discrète de la narratrice, et de l’écrivaine, dans l’histoire. Cette distance narrative n’a rien à voir avec la froideur. On l’associerait plutôt à un commentaire de Simon Scop, le pyschanalyste du roman : « L’important était de maintenir que la maladie et le sujet ne sont pas confondus, toujours garder la distinction, ne pas enfermer quelqu’un dans sa maladie. » Distinction que la narratrice s’empresse d’approuver, du point de vue de la narration : « Moi, ça me plaisait parce que je me disais : c’est comme une narration, est-ce qu’une narration est racontée du point de vue de ce qu’on sait, comme un « cas » qui se déroule en ligne droite, ou du point de vue de ce qu’on ne sait pas à l’avance. Et ça ne veut pas dire : improvisation. Mais c’est une question de point de vue. » Maintenant, qu’en pense l’écrivaine ? « C’est dans la droite ligne de Freud. La psychanalyse n’est pas une médecine. La psychanalyse s’intéresse au sujet, pas à la maladie. On peut dire qu’elle s’intéresse à séparer le sujet de sa maladie, de ses symptômes, de ce qui ne va pas. Un psychanalyste ne doit pas penser qu’il sait ce qu’a la personne. Il écoute. Il faut bien entendre ou essayer de tout entendre à égalité. Le sujet n’est pas un cas, il n’est pas enfermé dans une catégorie donnée, mais à entendre dans toutes ses contradictions. Je crois qu’il y a une éthique là-dedans qui me convient, même du point de vue de la narration. Un point de vue naturaliste, qui explique, ça ne m’intéresse pas. Je crois que c’est comme ça depuis le début. Quand j’ai voulu écrire sur l’usine, ce n’était pas à la Zola. Zola, c’était très bien quand il l’a écrit, mais ce n’est plus ça du tout. Donc si on n’adopte pas un point de vue d’explication, de cas, de catégorie, on se place autrement par rapport à ce qui advient, à ce qui peut advenir, peut changer. Ça demande peut-être une certaine disponibilité à ce qui arrive. Je trouve ça plus intéressant du point de vue de l’écriture. Écrire ce que je sais déjà, ça ne m’intéresse pas beaucoup. » On a d’ailleurs dit, en parlant de son dernier roman, que sa narration était démocratique… « Il n’y a pas de Dieu tout puissant qui contrôle tout. Effectivement, chacun peut avancer à sa façon. La question qui fait avancer le livre, c’est : et alors que va-t-il se passer ? C’est la même chose avec les films de Chaplin : qu’est-ce qu’il va faire, qu’est-ce qu’il va inventer ? J’adore Chaplin. »
Réalité et pouvoir
Simon Scop pense que la réalité, c’est le pouvoir. Qu’en pense Leslie Kaplan ? « La réalité sociale est certainement déterminée par le pouvoir. La question est : comment le déjouer, comment on se situe par rapport à ça, comment on peut déplacer des choses, comment on peut en instaurer d’autres. Ça, c’est aussi la référence à Chaplin. On est dans un monde… où on retrouve le pouvoir, l’inertie, la répétition. Qu’est-ce qu’on en fait ? Tout le monde est confronté à ça. » Simon dit aussi que la religion, c’est la mortification… « Toutes les religions, dans la mesure où elles posent une autre vie en dehors de celle-ci, sont une façon de nier ce qui se passe ici, maintenant. On peut tout penser. On ne peut pas tout faire. Ça, c’est absolument primordial. C’est le moteur de la psychanalyse et c’est le moteur de ce qui permet de se débarrasser de la culpabilité fausse. Par exemple, ceux qui disent : je suis raciste parce que j’ai pensé que… Mais on s’en fiche de ce qu’ils ont pensé ! Ce qui importe, c’est ce qu’ils font, ce qu’ils disent publiquement, s’ils se censurent ou non. La distinction entre la sphère de la pensée et celle de l’action, c’est très important, sinon, qu’est-ce qui se passe ? On banalise les actions. On se culpabilise sur ses pensées, moyennant quoi on excuse, on effiloche les actes. On se dit : moi aussi, j’aurais pu… Pas du tout ! »
Est-ce qu’il y a une déception par rapport à l’après-mai 68 ? « Je crois qu’on se débat avec le deuil, avec la désillusion, mais c’est comme pour l’usine : je n’ai jamais regretté d’y avoir travaillé. Même si ça a été très dur, même traumatique. Si j’avais des illusions, ça n’avait rien à voir avec ce que j’imaginais. D’avoir vécu une occupation d’usine laisse des traces. Il y a des choses qui restent. Des récits. Les récits, c’est fondamental. Par exemple, une partie de Depuis maintenant a été mis en scène au théâtre. Après une représentation, les gens se sont regroupés dans un café et se sont mis à raconter, 29 ans après, leur mai 68. C’était fascinant parce que les récits étaient là. C’est essentiel, ça. C’est une autre façon de voir l’histoire. Mai 68, je ne le vois que de façon positive, et à transmettre, finalement. »
Nommer, faire exister. Est-ce que c’est ça, écrire ? « Oui, certainement. Trouver les mots, les mots ‘justes’ pour nommer ses sentiments, ses affects, sa façon de voir. Cézanne disait : ‘Je vous dois la vérité en peinture.’ On pourrait reprendre ça : qu’est-ce que c’est la vérité en littérature ? C’est certainement essayer de dire de la façon la plus juste son rapport au monde. Mais ce rapport est lui-même un écart entre soi et le monde. C’est essayer de nommer ça. Ne pas penser le monde tel qu’il est, ce serait une vision… de Dieu lui-même, mais essayer d’être juste par rapport à cet écart entre soi et le monde. »
Ce roman est une mise en action… « Un livre, c’est une réponse au monde, c’est un objet. Un objet proposé qui peut augmenter le monde, l’agrandir. C’est ce qu’on souhaite. Ce n’est pas une explication, ni un discours. C’est autre chose. »
Ne ratez pas Le psychanalyste, ni les romans qui l’ont précédé.
1. Entretien publié dans la deuxième édition de L’excès-l’usine, P.O.L., 1987.
2. Leslie Kaplan, Miss Nobody Knows, Paris, P.O.L., 1996, p. 16-17.
Leslie Kaplan a publié :
Les romans de Leslie Kaplan sont tous publiés chez P.O.L., sauf la première édition de L’excès-l’usine (1982), publié chez Hachette, repris chez P.O.L., en 1987 : Le livre des ciels (1983) ; Le criminel (1985) ; Le pont de Brooklyn (1987) ; L’épreuve du passeur (1988) ; Le silence du diable (1989) ; Les mines de sel (1993) ; Depuis maintenant 1, Miss Nobody Knows (1996) ; Depuis maintenant 2, Les prostituées philosophes (1997) ; Depuis maintenant 3, Le psychanalyste (1999). Plusieurs de ces textes ont été adaptés pour le théâtre. Retenons qu’elle est aussi l’auteure de nombreux essais publiés en revues.
EXTRAITS
« Tenir le hasard pour indigne de décider de notre destin, ce n’est rien d’autre qu’une rechute dans la conception pieuse du monde. »
Le psychanalyste, P.O.L., p. 231.
« Les assassins, contrairement à ce qu’on pourrait croire, sont ceux qui restent dans le rang, qui suivent le cours habituel du monde, qui répètent et recommencent la mauvaise vie telle qu’elle est. »
Le psychanalyste, P.O.L., p. 456.
« […] il pensait à ce qu’on peut attendre d’une psychanalyse, d’après Freud : « aimer et travailler », et à un commentaire qu’il venait de lire : Pas une réconciliation avec la réalité, mais avec ses propres capacités. Vouloir ce qu’on veut, pouvoir ce qu’on peut. Pas vouloir ce qu’on peut, aplatissement devant la réalité, ni pouvoir ce qu’on veut le croire , figure une toute puissance. Mais qu’on puisse jouer sa partie, dire son récit, répondre au monde à sa façon. Aimer et travailler… »
Le pyschanalyste, P.O.L., p. 214.
« Penser librement, disait Simon, penser dans toutes les directions possibles, est un des grands plaisirs que l’on peut avoir, parfois c’est même de la joie… alors quand on veut vous l’interdire, vous en empêcher, vous censurer, pas explicitement, mais vous mortifier… en rendant mort ce qui vous arrive, ce que vous éprouvez, en vous disant, ce que vous faites, pensez, vivez, ce n’est rien… alors là non, disait Simon, non. »
Le psychanalyste, P.O.L., p. 408.