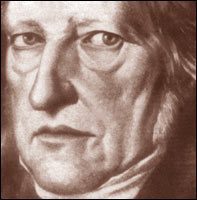Georg Wilhelm Friedrich Hegel vécut à cheval sur deux siècles. Né à Stuttgart le 27 août 1770, il mourut présumément (?…?) du choléra à Berlin, capitale de la Prusse, le 14 novembre 1831.
Il connut donc, outre la Révolution française et la naissance puis la chute de l’Empire napoléonien, le traité de la Sainte-Alliance de 1815 (Autriche-Hongrie, Russie, Prusse) et les accords consécutifs de Carlsbad en 1820 – lesquels devaient mater pour un temps toute velléité de protestation face au régime politique et social européen issu de la Restauration (au moins jusqu’à la Révolution de 1848, en dépit des effervescentes Journées de juillet 1830).
Bien que des biographies importantes aient été publiées à ce jour en allemand (dont celle de Rosenkranz dès 1844), voici coup sur coup les deux tout premiers ouvrages1 du genre désormais disponibles en langue françoise. Nous avons lu ces mille et quelques pages, qui nous ont fait voyager dans les méandres de sentiments contradictoires. Plus de 165 ans après la mort du penseur, il devenait gênant sinon indécent qu’une véritable biographie française du Herr Professor ne fût toujours pas accessible. C’est chose faite, et deux fois plutôt qu’une. Saluons l’événement. D’emblée, le connaisseur regrettera toutefois l’absence de nouvelles révélations eu égard aux travaux déjà parus. Il faudra donc ici chercher l’originalité dans le style et la manière propre des auteurs recensés.
On retrouvera dans ce foisonnement d’informations les ingrédients habituels du genre, de l’anecdote aux grandes décisions prises ou subies par le personnage principal. Une première particularité, notable, réside dans le caractère tout à la fois biographique et théorique des deux titres. On alterne du détail événementiel à l’analyse circonscrite de textes, par ailleurs souvent difficiles, du philosophe. Horst Althaus abusera singulièrement du procédé, compte tenu de ses assises philosophiques moins établies que celles de Jacques D’Hondt, lequel est un spécialiste français bien affirmé de l’œuvre hégélienne. En effet, s’il réussit à donner une idée assez claire de certains travaux, le biographe allemand ne parvient que fort laborieusement à nous entretenir des œuvres majeures de Hegel (dont la Phénoménologie de l’Esprit, la Logique et l’Encyclopédie). En revanche, c’est avec un réel bonheur qu’il entre dans le détail journalier. En outre, le lecteur aura même l’occasion, en quelques pages ici et là, de se familiariser avec les plus marquants épigones du maître (ou pourfendeur comme Schopenhauer), tels Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, David F. Strauss ou Karl Marx.
Le politique
Les deux biographies insistent largement sur la « stature politique » du philosophe, et ce dans son œuvre comme dans sa vie personnelle et sociale. De tout temps, depuis que l’on interroge sa réflexion, cette dimension de l’individu nourrit sans désarmer la discussion et les débats chez les hégéliologues et hégéliens de toutes tendances. Or il faut bien admettre qu’en la matière Althaus dérape vers une interprétation qui relève assez nettement du préjugé. De bout en bout de son ouvrage « [l]a perspective conservatrice qui caractérise les vues politiques de cet universitaire prussien […] » (p. 13), « l’homme de la Restauration monarchiste de stricte observance, adversaire du libéralisme […] » (p. 556) se voit ainsi distillée l’image d’un Hegel « serviteur avéré de la couronne » (p. 300). Les formules assassines se répètent inlassablement. À marteler le même clou dans un pareil nœud de chêne, on tombe hélas dans la caricature. Triste. Pour le moins.
L’approche « détective » de D’Hondt se révèle non seulement beaucoup plus nuancée, parce que mieux étayée, mais il parvient à des conclusions carrément symétriques à celles d’Althaus. On n’a pas idée, avec nos yeux contemporains d’Occidentaux démocrates [?], du risque que représentait à l’époque, dans la patrie de Luther, de se déclarer tout bonnement athée ou républicain… Aussi fallait-il pour l’esprit critique et ou frondeur se montrer extrêmement rusé avec les autorités, de quelque ordre ou niveau qu’elles fussent. D’où chez Hegel des textes qu’il a préféré ne jamais publier de son vivant, ainsi que le tissage d’un réseau privé d’amitiés et de relations de personnalités parmi les plus critiques et contestataires, voire subversives, de l’ordre dit établi de son temps. Sa correspondance personnelle se montre à cet égard très éclairante (nonobstant les passages inexplicablement expurgés par Jean Carrère dans sa traduction française des Briefe). Il en est de même de ses cours (notamment aux universités de Heidelberg et de Berlin), qui « complétaient » oralement les œuvres éditées dans lesquelles il ne pouvait, sinon en l’emballant soigneusement dans des formulations sibyllines pour contrer la censure, communiquer en toute transparence le fond de sa pensée. Loin du philosophe thuriféraire de l’État, il faut plutôt voir en Hegel l’un des très rares grands esprits du moment à être allés aussi loin dans la dénonciation du « réel concret » de son pays. Dans ses actes comme depuis l’encrier.
Du particulier à l’universel
Une biographie, c’est aussi le quotidien d’un homme et donc la mise en perspective d’éléments d’ores et déjà (assez bien) connus, mais sous un faisceau d’informations pour leur part beaucoup moins publiques. Sur ce plan, les deux auteurs se rapprochent considérablement. On y dévoile un Hegel d’origine modeste sinon fruste et qui, somme toute, n’a jamais connu une vie facile ou aisée. Si les soucis financiers ne l’ont jamais quitté totalement, il eut également à supporter un assez lourd bagage existentiel. Il perdit sa mère très jeune, sa sœur Christiane Louise perdit pour sa part la raison en 1815, alors que son frère Ludwig trouva la mort (sous les couleurs françaises) dans la dramatique Campagne de Russie de 1812. Le philosophe de l’abstraction… eut par ailleurs un fils naturel avec sa logeuse des années d’Iéna (Ludwig, né en 1807, année de parution de la Phénoménologie). Il le reconnut sans ambages, mais l’enfant resta pour lui sa vie durant une source de tracas (et réciproquement, vraisemblablement). Il épousa Maria von Tucher le 16 septembre 1811 à Nuremberg, où elle lui donna deux fils, en 1813 et 1814 : Karl et Immanuel (comment ici ne pas penser à Marx et à Kant qui portèrent respectivement ces mêmes prénoms, et entre lesquels incidemment comme faucille entre marteau et enclume… se loge historiquement et intellectuellement son œuvre ?). À ses noces, l’homme de 41 ans avait déjà deux fois l’âge… de sa moitié. Dans ces années fort riches en événements privés, le professeur enfantait simultanément (1812-1816) les trois tomes de l’une des œuvres philosophiques les plus difficiles et les plus pénétrantes de tous les temps : Die Wissenschaft der Logik (Science de la Logique).
Hegel n’est pas de ces hommes dont on dit qu’ils furent dès le berceau bénis des dieux. Travailleur acharné, il fréquenta l’école dès l’âge de trois ans pour bientôt y maîtriser le latin, le grec, le français et même l’hébreu. Tite-Live et les Tragiques grecs occupaient déjà son esprit à l’âge où, aujourd’hui encore, on sait à peine lire. Contrairement à Schelling ou à Goethe, par exemple, qui semblaient réussir tout ce qu’ils entreprenaient sans avoir l’air d’y toucher, le succès n’est jamais venu simplement à ce philosophe que d’aucuns, et non sans de solides raisons, estiment plus incontournable encore que Platon, Aristote ou Kant.
Bref s’il est opportun et à vrai dire essentiel pour un connaisseur de l’œuvre hégélienne de se mettre à la lecture d’une biographie du penseur, reste que pareille activité peut susciter également l’intérêt du non-hégéliologue, voire du non-philosophe. Car en filigrane c’est à l’histoire générale d’une époque, extraordinaire au demeurant, on l’a dit, que nous nous voyons finalement conviés ici.
Je chipote
Par-delà quelques rares erreurs (toutes mineures, notamment de dates), en particulier chez D’Hondt, et même des imprécisions de syntaxe quelquefois, il faut en outre regretter dans les deux bouquins l’absence d’un tableau synoptique et chronologique. Pour qui n’est pas vraiment instruit ou familier des acteurs sociaux, des œuvres et des événements principaux de la période concernée, une initiative de ce genre aurait été grandement appréciée. Pour tout autre lecteur aussi, du reste. Dommage enfin que Horst Althaus se soit abstenu de donner les références précises des très nombreuses citations qui émaillent son texte (hormis qu’il s’agisse d’une décision malheureuse de la traductrice et ou de la maison du Seuil). Ainsi et comme par surcroît, il eût été plus aisé pour le lecteur de ne pas se voir abusé par des extraits tronqués ou cités hors contexte qui, comme c’est le cas en page 590, dénaturent littéralement le libellé original. Au paragraphe 342 de la Philosophie du droit de Hegel, il faut plutôt lire en effet que « l’histoire mondiale n’est pas la nécessité abstraite et irrationnelle d’un destin aveugle »…
Merci tendre Odile.
1. Hegel, Naissance d’une philosophie, Une biographie intellectuelle, par Horst Althaus, trad. de l’allemand [1992] par Isabelle Kalinowski, Seuil, Paris, 1999 ; Hegel, Biographie, par Jacques D’Hondt, « Les vies des philosophes », Calmann-Lévy, Paris, 1998.