Les mots de l’orage si souvent prononcés
Haine et attachement se chevauchant nuit et jour
Dans la perversité incomprise
Joyce qui rit
Joyce qui pleure
Jekyll et Hyde enfin réunis
Qui réveillent les Dublinois
Nageant à la surface de leur Guinness
Le prince et le pauvre vivant dans la galère du feu
Je suis née dans une famille où posséder une étagère avec des livres était la preuve irréfutable d’une grande vie intellectuelle.
Intellectuels, mes parents ne l’étaient pas. Toutefois, ma mère était abonnée au théâtre avec Gisèle, la femme du juge Lessard, et il devenait impératif pour elle de lire, de s’intéresser à l’histoire de l’art, d’adopter quelques expressions inusitées empruntées à cette ancienne comédienne, amie de Béatrice Picard. Ma mère était abonnée au Cercle du livre de France et recevait par la poste un livre par mois. Elle devait les lire parce qu’après avoir tranché les pages au coupe-papier, elle les classait sur les rayons de son étagère qui trônait dans le salon de notre petit quatre pièces et demie à Verdun. J’avais remarqué qu’elle portait certains titres sur le dessus de sa grande armoire, coincés entre deux appuie-livres, et d’un regard sévère, elle me faisait comprendre que ces livres n’étaient pas pour une jeune fille bien élevée. Du haut de mes douze ans, je pouvais apercevoir, tout en étant empêchée de les lire, Mémoires d’une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, Le temps des jeux de Diane Giguère, Adrienne ou La vie de Mme de Lafayette d’André Maurois, et Doux-amer de Claire Martin. Pierre Tisseyre (CLF), qui est devenu mon éditeur puis mon employeur, avait beaucoup de flair pour les livres écrits en français. Il puisait au cœur d’une littérature riche des titres qu’il faisait traverser en bateau jusqu’à la petite étagère de ma mère.
Mine de rien, je commençai à lire certains titres licites, ceux qu’elle mettait à ma disposition, mais aussitôt que mes parents s’absentaient, je m’enfermais dans la salle de bains, libre de ma gardienne, pour lire les romans qui autrement m’étaient interdits.
Je m’efforçais de comprendre des propos trop matures pour moi qui venais à peine de quitter la comtesse de Ségur et les romans de Magali. Je relisais les phrases plusieurs fois, je consultais souvent un vieux Larousse en lambeaux, je me vantais auprès de mon cousin quand j’allais le visiter au Grand Séminaire de Montréal que je lisais, moi aussi, les œuvres de Claudel ou de Daniel-Rops.
Je voulus faire mon cours classique. Absolument. J’étais la seule fille parmi toutes mes cousines qui allait devenir une intellectuelle, échappant du coup aux sciences à tout prix et m’assurant une étagère porteuse de livres, dans ma chambre.
Je me rendis ainsi jusqu’au Collège Sainte-Marie où les jésuites avaient nettoyé le terrain pour nous le rendre propice à la lecture. À cette époque, aucun auteur québécois dans la liste de Maximilien Laroche. Des auteurs classiques, des vieux, des morts, des plates, des prétentieux, mais des auteurs qui allaient « faire » plusieurs écrivains parmi une faune hétéroclite de premiers cégépiens et universitaires uqamiens.
Un de nos enseignants avait toujours le même livre entre les mains. Du début de l’année jusqu’à la fin, il tenait la traduction d’Ulysse d’un certain James Joyce, livre aussi lourd qu’un dictionnaire. Il le posait sur un rebord de fenêtre ou sur le pupitre d’un élève quand il n’en pouvait plus de le porter. Parfois, il remontait ses lunettes, ouvrait son bouquin à la page désirée grâce aux douzaines de signets, découpés dans de vieilles photos au carton rigide et coloré, se raclait la gorge pour surtout attirer notre attention, et se mettait à nous lire un extrait avec une admiration exagérée. Nous avions baptisé ce professeur Mister Bloom. Bloom comme dans Leopold Bloom, l’absent tel que l’était Ulysse, parti en voyage pendant que les souris dansaient dans sa maison.
plus de le porter. Parfois, il remontait ses lunettes, ouvrait son bouquin à la page désirée grâce aux douzaines de signets, découpés dans de vieilles photos au carton rigide et coloré, se raclait la gorge pour surtout attirer notre attention, et se mettait à nous lire un extrait avec une admiration exagérée. Nous avions baptisé ce professeur Mister Bloom. Bloom comme dans Leopold Bloom, l’absent tel que l’était Ulysse, parti en voyage pendant que les souris dansaient dans sa maison.
Je le soupçonnais d’aimer se promener en robe de chambre jaune dans toute la maison, de recevoir des amis, d’ouvrir au facteur, tout en se barbifiant, comme le Buck Mulligan de son Ulysse. « Vous savez, messieurs et mesdemoiselles, le génie de Joyce, c’est d’avoir écrit près de mille pages sur une seule journée dans la vie de personnages multiples avec un style éclaté. »
Jamais ne m’était-il arrivé de vouloir lire Ulysse ou toute autre œuvre de Joyce. Je trouvais l’auteur dépravé, axé sur sa petite personne, pompeux, fat ; il m’était de toute façon résolument antipathique. Je me suis rendue jusqu’à un âge tardif sans l’avoir lu. Puis, un jour, j’ai acheté Ulysse pour épater mon ami Laforest qui voue à Ulysse un culte inextinguible. Qui a même mémorisé le premier chapitre en entier et qui se fait une gloriole de le réciter à ses étudiants du secondaire. « Majestueux et dodu, Buck Mulligan parut en haut des marches, porteur d’un bol mousseux sur lequel reposaient en croix rasoir et glace à main. L’air suave du matin […]. » Je l’ai d’abord acheté en anglais, moi qui m’endors en lisant le Time Magazine à cause de ma semi-incompréhension de cette langue. L’année suivante, j’ai acheté Ulysse en traduction française,  décidée enfin de devenir une adepte des voyages intérieurs d’un auteur dublinois juif-protestant qui avait pour les femmes une outrageante opinion, et pour lui-même, un amour égoïste sans bornes, un pervers qui prenait son pied à passer aux urinoirs avec un de ses personnages afin d’y comparer le jet de leur engin respectif.
décidée enfin de devenir une adepte des voyages intérieurs d’un auteur dublinois juif-protestant qui avait pour les femmes une outrageante opinion, et pour lui-même, un amour égoïste sans bornes, un pervers qui prenait son pied à passer aux urinoirs avec un de ses personnages afin d’y comparer le jet de leur engin respectif.
J’ai lu une centaine de pages, quand même ! Et j’ai rangé mon livre. J’écoutais, sans entendre, mon ami Laforest, exalté, glorifier l’œuvre de cet auteur irlandais qui m’intriguait, mais ne m’attirait pas. Cela a duré plus de trente ans. J’ai déménagé trois fois les livres de mes bibliothèques après avoir soulagé ces dernières de tous les romans que je ne relirais pas. Jamais n’ai-je songé à me défaire des deux Ulysse, car j’avais l’impression que j’avais quelque chose à prouver en m’y attelant une fois pour toutes. Il y a quelques années, mon éditeur Victor-Lévy Beaulieu a publié James Joyce, l’Irlande, le Québec, les mots. Depuis Je m’ennuie de Michèle Viroly, roman que j’avais détesté, je n’avais rien lu du verbomoteur littéraire qu’est VLB. Cette fois, j’ai lu son ouvrage sur Joyce. Et j’ai été séduite, emballée, flabbergastée. En même temps, je n’ai pas pu m’empêcher de lui écrire que lui et James Joyce n’étaient en fait qu’une seule et même personne. Je croyais que VLB n’allait plus m’adresser la parole ; il a été, au contraire, très touché. Lui et Joyce violemment pervers, masochistes et misogynes. L’ego torturé, les châsses ouvertes sur le monde, curieux, impliqués politiquement, le risorius à l’affût, de la révolte et de la vigueur dans le propos. Joyce et Beaulieu.
J’allais me servir du traité joycien de Beaulieu pour arriver à apprivoiser Ulysse. C’était décidé. Laforest n’allait pas ensuite rapporter partout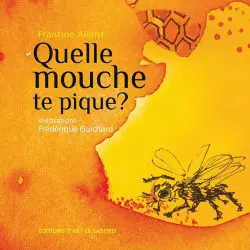 que je suis une inculte. Je ferais partie des disciples de Joyce.
que je suis une inculte. Je ferais partie des disciples de Joyce.
J’ai finalement relu les mêmes cent pages d’Ulysse. Et je n’ai pas davantage apprécié. Rien retenu. Et je ne recommencerai pas. Combien de fois ai-je affirmé que ce n’est pas parce que je n’ai pas le bon pas que je ne fais pas partie de la parade ? J’ai assez appris sur James Joyce en lisant l’ouvrage de VLB, assez appris sur son talent d’écrivain et son sens inné de la poésie pour m’éviter la souffrance qu’occasionnerait la lecture d’Ulysse. J’ai lu la biographie de Joyce et je lui ai même écrit un poème. Et j’en sais suffisamment pour savoir quel zig il était. Et de quoi traite son livre. Et, ô combien il y a des tas de James Joyce qui nous assomment à vouloir nous impressionner. Quand on sait d’un écrivain où il est né, ce qu’il pense de ses semblables, toute l’affection qu’il a pour sa mère, toute la haine qu’il a pour les femmes rencontrées, nul besoin de s’assécher les iris sur les pages d’un livre immensément complexe. Puisque, tant qu’il y aura des Laforest pour s’en souvenir à notre place, nous pouvons dormir tranquilles.
Ah, James ! Que ne fus-je point
de ton époque
Où l’écrivain flottait
en détruisant tout sur son passage
Docteure ès lettres, Marie-Lise Allard a soutenu en novembre 2010, à l’Université de Franche-Comté, une thèse intitulée « Anna de Noailles entre prose et poésie ».










