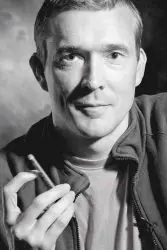C’est un bien curieux objet littéraire que viennent de faire paraître en traduction les éditions Alto. En effet, le roman, de confection fort jolie, nous arrive en reliure rigide, au papier grossièrement tranché, conférant à l’ouvrage un caractère vieillot résolument charmant.
Entreprendre la lecture du magistral roman de David Mitchell Les mille automnes de Jacob de Zoet1, c’est accepter, quelque sept cents passionnantes pages plus tard, de devoir ultimement renoncer à un imaginaire dont on est à la fin positivement imprégné. Plonger dans ce projet ambitieux, c’est accepter de porter désormais en soi une œuvre marquante, qui s’impose comme un jalon nouveau dans son histoire personnelle de lecteur.
Baie de Nagasaki, au Japon. L’île artificielle de Dejima, un des ports d’attache de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, a pour fonction principale l’hébergement des commerçants des Pays-Bas. Ce lointain pays des mille automnes, comme on se plaît à le surnommer si poétiquement, sert de trame de fond à bon nombre de tractations commerciales et politiques. Reportons-nous à l’époque, en 1799 : les perspectives lucratives et promesses d’enrichissement sont pour le moins significatives. Un marché économique florissant reste à conquérir…
Les mille automnes de Jacob de Zoet raconte l’ascension d’un jeune clerc de Dombourg venu au Japon dans une mission commerciale pour y jouer finalement un rôle diplomatique délicat. Cette œuvre s’inscrit dans une généreuse tradition de romans d’apprentissage, où un personnage ingénu parvient à gravir envers et contre tous les échelons sociaux. De Zoet aura fort à faire pour tirer son épingle du jeu à travers toutes ces rivalités qui gangrènent les associations initiales : le jeune homme devra composer au cours de son exil prolongé avec des gens avides, pouvant s’avérer cruels et intransigeants, constamment en train de fomenter des manigances corrompues. Sans compter que Jacob devra absorber le fracassant choc des cultures : le quotidien d’un Européen en terre nippone est forcément ponctué de rencontres qui comportent leur lot d’étonnement, de malentendus et de malaises involontaires.
Mais ce qui marquera davantage au fer rouge son séjour en Orient, c’est la rencontre avec Orito Aibagawa, dont il ne se remettra jamais tout à fait. L’attirance de de Zoet pour cette femme se nourrira de son souvenir au point qu’il ne pourra plus se défaire de son image, qui bientôt l’habitera, le grugera telle une obsession formidable.
David Mitchell déploie son imaginaire comme s’il avait tout son temps, lui qui a le souci évident de tout décrire dans le menu détail. Cette prolixité savamment calculée sert non seulement la cause du réalisme historique, mais elle lui permet surtout de longuement mettre la table pour des scènes d’une tension dramatique déchirante pour Jacob. L’auteur excelle à tisser des intrigues politiques ou sentimentales inextricables, des dilemmes insolubles. Tout concourra à éloigner cruellement le modeste clerc de Zoet de ses objectifs, qu’ils soient professionnels ou sentimentaux.
De bonne famille, promise à un avenir lumineux, la belle Orito Aibagawa est quant à elle sauvagement soustraite du corps social quand le seigneur-abbé Enomoto fait sommairement son acquisition, pour la tenir captive entre les murs du couvent où il impose son joug. Son nouveau destin forcé l’amènera à constater à la dure les pratiques abominables ayant cours dans ce couvent-prison, tant cette injuste incarcération d’Orito rappelle le sort réservé aux bagnards.
Ces considérations nécessitent que le tort soit réparé et la belle, libérée… La quête, déjà noble, prend alors des proportions chevaleresques : un complot est ourdi, un plan échafaudé grâce au concours d’un commando de mercenaires œuvrant pour libérer Orito de cette forteresse imprenable. Les circonstances ici relatées font emprunter au roman un sentier inattendu pourtant bien connu des aficionados de nos thrillers contemporains les mieux construits : l’histoire finit par adopter par la force des choses les codes du genre, sans toutefois sacrifier à la rigueur érudite de la saga historique.
Mais au-delà d’un scénario savamment mis au point, de nombreuses raisons rallient le lecteur exigeant à la cause des Mille automnes de Jacob de Zoet.
Ce n’est peut-être pas seulement parce que, le souffle coupé, l’on ressort béat d’admiration de la lecture de certaines pages.
Ce n’est peut-être pas seulement en raison de la pénétration stupéfiante de la conscience des personnages, même des plus secondaires.
Ce n’est peut-être pas tant pour ses personnages mémorables, à la verve éclatante et aux traits d’esprit singuliers.
Ce n’est peut-être pas seulement pour cette sensibilité aux atmosphères les plus délicates.
Ce n’est peut-être pas tant parce que l’on est plongé dans un bain d’érudition stimulant, sans la fâcheuse arrogance vaniteuse de celui qui l’étale.
Ce n’est peut-être pas spécialement pour la connaissance intime des traditions et de la culture japonaises de l’auteur, qui a séjourné lui-même longtemps au Japon.
Ce n’est peut-être pas tant en raison du portrait de cette époque économiquement glorieuse de l’Europe coloniale, portrait pourtant saisissant de réalisme.
Ce n’est peut-être pas non plus seulement pour cette innovation langagière, qui consiste à faire inhabituellement se scinder les répliques, divisées chez Mitchell par une incise intercalaire, conférant aux dialogues la précision presque scénique de didascalies.
Tant de motifs pour lesquels il faut lire Les mille automnes de Jacob de Zoet. Mais il y a plus important encore…
Oui, comme dans ces merveilleux romans d’aventures qui nous ont happé et que l’on a fini, effet de réciprocité oblige, par investir plus intimement, c’est aussi et surtout parce que l’on s’infuse, tout entier, dans le monde absolument fascinant de David Mitchell. Un monde qui ne consent à vous recracher qu’une fois les sept cents pages achevées. Et là encore, le voyage intérieur continue un certain temps…
1. David Mitchell, Les mille automnes de Jacob de Zoet, trad. de l’anglais par Manuel Berri, Alto, Québec, 2012, 712 p. ; 34,95 $.
EXTRAITS
Pour chaque geisha accomplie dont les riches protecteurs se disputent les faveurs, il y a cinq cents filles mâchées, remâchées et recrachées qui finissent par mourir de maladies contractées dans les bordels. C’est sans doute un piètre réconfort pour une femme de ton rang, car je sais que tu as perdu une vie bien meilleure que le reste d’entre nous, mais sache que le Couvent est une prison seulement si tu te dis que c’en est une.
p. 336
La douleur lancinante dans le nez de Jacob semble caractéristique d’une fracture. Mais la substance poisseuse sur ses mains et genoux n’est pas du sang. De l’encre, comprend le clerc qui peine à se relever.
De l’encre échappée de son encrier fracassé, dessinant des ruisselets indigo et bavant des deltas…
De l’encre, absorbée par le bois assoiffé, coulant entre les fêlures…
Encre, pense Jacob, toi, le plus fécond des liquides…
p. 25
Tandis qu’il ramasse des limaces sur les choux à l’aide de baguettes, Jacob remarque qu’il a une coccinelle sur la main droite. Avec la gauche, il fait un pont que l’insecte, diligent, traverse. Jacob réitère l’exercice plusieurs fois. La coccinelle doit croire qu’elle accomplit un long voyage alors qu’elle ne va nulle part, songe-t-il. Il se représente une succession infinie de ponts reliant des îles de chair flottant dans le vide, et se demande si une force invisible ne se joue pas de lui de façon analogue…
p. 189