J’ai lu. J’ai beaucoup lu. D’une certaine manière j’ai bien trop lu. Il fut un temps où j’apprenais la vie dans les livres. Le virtuel ne remplace pas le réel, ou du moins ce qui passe pour tel – une autre histoire que nous nous racontons, collectivement, mais avec des conséquences parfois plus graves que celle de la lecture. Pas toujours : certains livres ont changé ma vie.
J’ai lu par plaisir, j’ai lu par devoir. Ma chance est que mon devoir a presque toujours été mon plaisir ou l’est devenu, en particulier dans les écoles, lieux essentiels des devoirs de lecture où j’ai bénéficié de profs enthousiastes de la littérature. Quelle tristesse irritée lorsque j’entends des gens se dire dégoûtés de la littérature parce qu’ils avaient, tout simplement, de mauvais profs, le genre théoricien-décortiqueur que je soupçonne de ne pas aimer, voire de craindre l’imaginaire : il faut l’exorciser, Sainte Théorie à la rescousse ! Comme si la compréhension d’un texte devait en détruire la magie ! Au contraire, on m’a appris qu’elle la multipliait…
J’ai lu et j’ai lu et j’ai lu, et puis un jour, le syndrome de la bibliothèque de Babel a frappé : on ne peut pas tout lire. C’était il y a une vingtaine d’années. Il y a eu, en fait, deux périodes : avant et après ma  découverte de la science-fiction, à quinze ans. J’ai continué à dévorer la littérature ordinaire, mais peu à peu sa place a diminué à mesure que je m’adonnais à la lecture de plus en plus massive des littératures des genres dits populaires (« parce qu’on les lit ») : toute une littérature à découvrir ! Ces lectures-là sont peu à peu devenues ma lecture principale, parce que je m’étais mise à écrire de la science-fiction et que, dans le domaine des genres, il faut se tenir au courant. Pas pour des raisons de mode, mais pour le boulot ; ce sont des littératures collectives, où la discussion-collaboration entre les œuvres est bien plus poussée que dans la littérature ordinaire. On peut écrire un bon roman ordinaire sans avoir lu le dernier Goncourt, on ne peut pas écrire un bon roman de SF sans avoir lu les auteurs très contemporains.
découverte de la science-fiction, à quinze ans. J’ai continué à dévorer la littérature ordinaire, mais peu à peu sa place a diminué à mesure que je m’adonnais à la lecture de plus en plus massive des littératures des genres dits populaires (« parce qu’on les lit ») : toute une littérature à découvrir ! Ces lectures-là sont peu à peu devenues ma lecture principale, parce que je m’étais mise à écrire de la science-fiction et que, dans le domaine des genres, il faut se tenir au courant. Pas pour des raisons de mode, mais pour le boulot ; ce sont des littératures collectives, où la discussion-collaboration entre les œuvres est bien plus poussée que dans la littérature ordinaire. On peut écrire un bon roman ordinaire sans avoir lu le dernier Goncourt, on ne peut pas écrire un bon roman de SF sans avoir lu les auteurs très contemporains.
Comment, « on ne peut pas tout lire » ? Horreur et consternation. Et alors, des étapes, comme dans le  deuil. Incrédulité, dénégation (efforts pour continuer de lire, achats, accumulation sur les étagères de Non-lus au regard accusateur) ; honte, accompagnée de mensonges, car enfin, une universitaire patentée, ne pas avoir lu le dernier Machin ? Prise de conscience de l’imbécillité de la chose (paraître ?!? et aux yeux de qui, exactement ?) et donc passage à la revendication agressivement goguenarde : « Non, je n’ai pas lu, mais j’en ai beaucoup entendu parler » ; là encore, prise de conscience (« encore sur la défensive, sapristi ! ») et rationalisations de plus en plus approfondies : « Pas les moyens, les livres coûtent de plus en plus cher, pas de lib’ d’occaze à Chicoutimi, et la BM est trop loin d’où j’habite, pas de voiture, service de bus pourri, pas le temps » – et c’est vrai ; « Pas le temps, trop occupée à survivre » – et c’est tristement vrai ; « À peine le temps d’écrire mes propres machins, alors lire ceux des autres… » – et c’est atrocement vrai ; « Ennuyeux sentiment de déjà-vu, de déjà-lu » – et c’est extrêmement vrai : quand on a plus de cinquante ans de lectures dans le corps, il devient très difficile d’être surpris – ravi – non qu’on soit délibérément exigeant,
deuil. Incrédulité, dénégation (efforts pour continuer de lire, achats, accumulation sur les étagères de Non-lus au regard accusateur) ; honte, accompagnée de mensonges, car enfin, une universitaire patentée, ne pas avoir lu le dernier Machin ? Prise de conscience de l’imbécillité de la chose (paraître ?!? et aux yeux de qui, exactement ?) et donc passage à la revendication agressivement goguenarde : « Non, je n’ai pas lu, mais j’en ai beaucoup entendu parler » ; là encore, prise de conscience (« encore sur la défensive, sapristi ! ») et rationalisations de plus en plus approfondies : « Pas les moyens, les livres coûtent de plus en plus cher, pas de lib’ d’occaze à Chicoutimi, et la BM est trop loin d’où j’habite, pas de voiture, service de bus pourri, pas le temps » – et c’est vrai ; « Pas le temps, trop occupée à survivre » – et c’est tristement vrai ; « À peine le temps d’écrire mes propres machins, alors lire ceux des autres… » – et c’est atrocement vrai ; « Ennuyeux sentiment de déjà-vu, de déjà-lu » – et c’est extrêmement vrai : quand on a plus de cinquante ans de lectures dans le corps, il devient très difficile d’être surpris – ravi – non qu’on soit délibérément exigeant, mais on reconnaît trop, trop vite, et la quantité de lectures nécessaires pour trouver la perle rare augmente de façon exponentielle. Le même phénomène a d’ailleurs affecté ma lecture des genres…
mais on reconnaît trop, trop vite, et la quantité de lectures nécessaires pour trouver la perle rare augmente de façon exponentielle. Le même phénomène a d’ailleurs affecté ma lecture des genres…
La dernière rationalisation, qui n’en était pas une mais bien la raison profonde de mon détachement de la lecture ordinaire, c’est que les livres sont pour moi des amis, et qu’on n’a pas des milliers, ni même des centaines d’amis dans la vie – n’en déplaise à Fesse-bouc. Or ces amis, je les ai trouvés vraiment très tôt : à quinze ans. Ils étaient déjà tous là : Montaigne, Hugo-Pas-Hélas, Shakespeare, Diderot, Dostoïevski, Camus, Baudelaire, Rimbaud et les surréalistes. Les affinités électives ne dépendent pas de l’âge ni du nombre.
Et donc, enfin, acceptation sereine : on ne peut pas tout lire.
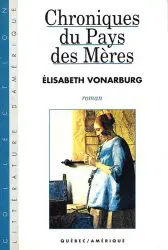
Bon, mais qu’est-ce qu’on devrait avoir lu ? (La question revient toujours).
Non. Je ne lis pas, je ne lis plus par devoir, et lorsque je le dois encore – chroniques de livres –, j’essaie de commenter uniquement ceux qui m’intéressent vraiment, même si, bien dressée, je suis capable de lire et de commenter n’importe quoi de manière relativement sensée. La dernière fois que j’ai lu par devoir… Les deux dernières fois : Proust, à vingt-six ans, juste après avoir passé l’agrégation de lettres, par principe, en tête-à-tête pendant une semaine, et je ne l’ai pas regretté. Mais aussi, ce n’était pas un pur devoir : comment un écrivain tournant autour de la mémoire comme autour d’une baleine blanche aurait-il pu ne pas avoir à me dire ? Et l’autre, c’était Joyce… Je suis allée assister en auditrice libre à un cours sur lui, à Chicoutimi, avec un excellent professeur, écrivain par ailleurs, Jean-Pierre Vidal pour ne pas le nommer, et il m’a apprivoisé Joyce. Ou du moins « L’Ulysse-de-Joyce ». Et là encore (ai-je compris ensuite), j’avais des motivations secrètes : comment un auteur qui écrit comme on fabrique de la 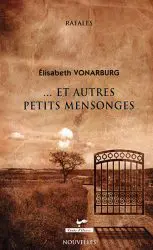 marqueterie (ou des millefeuilles, métaphore gastronomique qui me convient finalement mieux) aurait-il pu ne pas avoir à m’apprendre ?
marqueterie (ou des millefeuilles, métaphore gastronomique qui me convient finalement mieux) aurait-il pu ne pas avoir à m’apprendre ?
Proust, Joyce. C’est tout. J’en avais fini des devoirs – les vrais, ceux qu’on se donne à soi-même.
Je lis comme j’écris : par plaisir, par désir et par besoin. Et là, le goguenard « je ne l’ai pas lu mais j’en ai entendu parler » devient légitime ; les rumeurs superposées sont relativement fiables : le langage d’autrui est un code à saisir ; après un certain temps en ce bas monde, et écrivaine, créature de mots, j’y suis entraînée. Or, quand on a une certaine expérience de soi-même, on est capable de choisir. Il est quantité de livres dont on me dit et décrit le plus grand bien, mais je sais – je sens – très vite que « ce n’est pas pour moi » : on n’est pas le lecteur de tous les livres, comme on n’est pas l’ami de tout le monde. Si j’ai un doute, je vais voir ; dans la grande majorité des cas, mon intuition première était la bonne, et j’ai donc résolu de m’y fier.
Des livres non lus, il y en a encore sur mes étagères, même après la purge qui a suivi Les Grandes Rénovations (génial, les rénovations pour vous remettre toute une vie à l’heure). Parce que ces livres-là, achetés sous une impulsion, je sais que je les lirai ; un besoin se fera sentir – accidents de l’existence ordinaire ou nécessités de l’écriture –, et j’irai droit à ce livre, puisque c’est ainsi que je l’aurai aussi acheté.
Des livres jamais lus, et dont d’aucuns me disent « tu devrais », il y en a quelques-uns, mais ils ne sont pas dans ma bibliothèque, tout simplement. J’ai assez lu de morceaux de Tolstoï pour savoir que Guerre et paix ne m’intéresse tout simplement pas – y compris comme écrivaine, « pour la technique » : de ce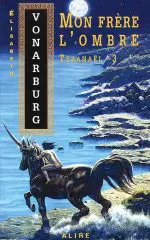 côté aussi j’ai rencontré tous mes inspirateurs et inspiratrices il y a assez longtemps –, et que je lui préfère de loin Dostoïevski (ou Tchekhov !) ; j’ai assez lu de Balzac pour savoir que c’est le Balzac illuminé para-spirite qui me parle, pas celui du Père Goriot… J’ai lu assez de Flaubert pour savoir que j’adore le flamboyant de La tentation de saint Antoine ou de Salammbô, mais que Madame Bovary m’ennuiera ; j’irai quand même peut-être faire un tour du côté de Bouvard et Pécuchet, si l’ami insistant que Je Dois me le met carrément dans les mains. Même chose pour Moby Dick – chacun ses baleines, et appelez-moi Curieuse – mais ce bouquin, l’image que je m’en fais, est tellement une métaphore que j’en suis épuisée rien que d’y penser. Au moins, Proust, sa baleine de mémoire, il ne voulait pas la tuer mais la réintégrer, et il l’a attrapée… Et puis, la folie obsessionnelle d’Achab, et la férocité de toute la chose (telle que je l’imagine), ça ne m’attire pas. L’écriture est pour moi une joute, certe , et le mystère de l’univers une question toujours ouverte et un peu saignante, mais l’une et l’autre sont aussi des joies, et non des affrontements mortels.
côté aussi j’ai rencontré tous mes inspirateurs et inspiratrices il y a assez longtemps –, et que je lui préfère de loin Dostoïevski (ou Tchekhov !) ; j’ai assez lu de Balzac pour savoir que c’est le Balzac illuminé para-spirite qui me parle, pas celui du Père Goriot… J’ai lu assez de Flaubert pour savoir que j’adore le flamboyant de La tentation de saint Antoine ou de Salammbô, mais que Madame Bovary m’ennuiera ; j’irai quand même peut-être faire un tour du côté de Bouvard et Pécuchet, si l’ami insistant que Je Dois me le met carrément dans les mains. Même chose pour Moby Dick – chacun ses baleines, et appelez-moi Curieuse – mais ce bouquin, l’image que je m’en fais, est tellement une métaphore que j’en suis épuisée rien que d’y penser. Au moins, Proust, sa baleine de mémoire, il ne voulait pas la tuer mais la réintégrer, et il l’a attrapée… Et puis, la folie obsessionnelle d’Achab, et la férocité de toute la chose (telle que je l’imagine), ça ne m’attire pas. L’écriture est pour moi une joute, certe , et le mystère de l’univers une question toujours ouverte et un peu saignante, mais l’une et l’autre sont aussi des joies, et non des affrontements mortels.
Je lis par plaisir, par besoin, par amour ; au pire, par curiosité – mais alors mes exigences sont extrêmes. Et surtout, surtout, je lis parce que j’en ai envie. Le bon Pennac a inscrit dans les droits des lecteurs celui de ne pas lire, n’est-ce pas ? Pourquoi ne parle-t-on jamais des droits des écrivains (sauf sur le plan légal, et ça fait mal) : « Les écrivains ont le droit d’écrire ce qui leur plaît… Les écrivains n’ont pas de comptes à rendre aux lecteurs »… Tiens, toé ! Et si, pour être écrivain, il faut… eh bien, pas nécessairement beaucoup lire, mais avoir beaucoup lu, j’ai fait mes devoirs, et j’ai passé l’âge. Qu’on me laisse donc le droit imprescriptible de ne plus lire si j’en ai envie.
Élisabeth Vonarburg est l’une des figures les plus importantes de la SF au Québec. Romancière et nouvelliste, elle est l’auteure d’une trentaine d’ouvrages, dont la série Reine de mémoire, parue chez Alire, qui lui a valu à deux reprises le prix Boréal. Son œuvre, maintes fois primée, est traduite dans de nombreuses langues. Née en France, elle vit à Chicoutimi depuis 1973. Quelques-uns des prix décernés à l’auteure : prix Boréal de la meilleure production critique 1980, 1981 et 1993 ; Prix spécial du jury au Philip K. Dick Award 1993 ; prix Femme et littérature du Conseil du statut de la femme (pour l’ensemble de l’œuvre) 1998 ; Prix à la création artistique du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2007…










